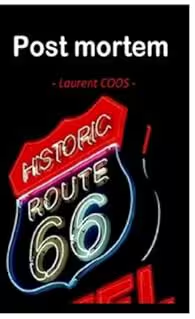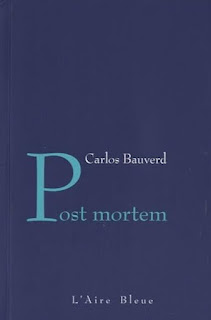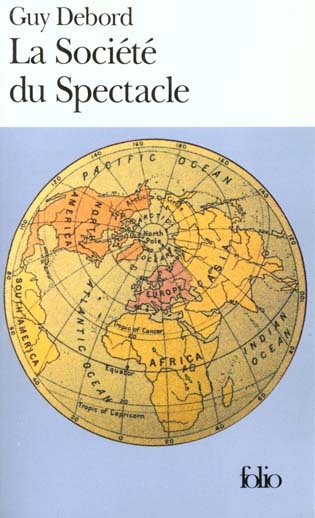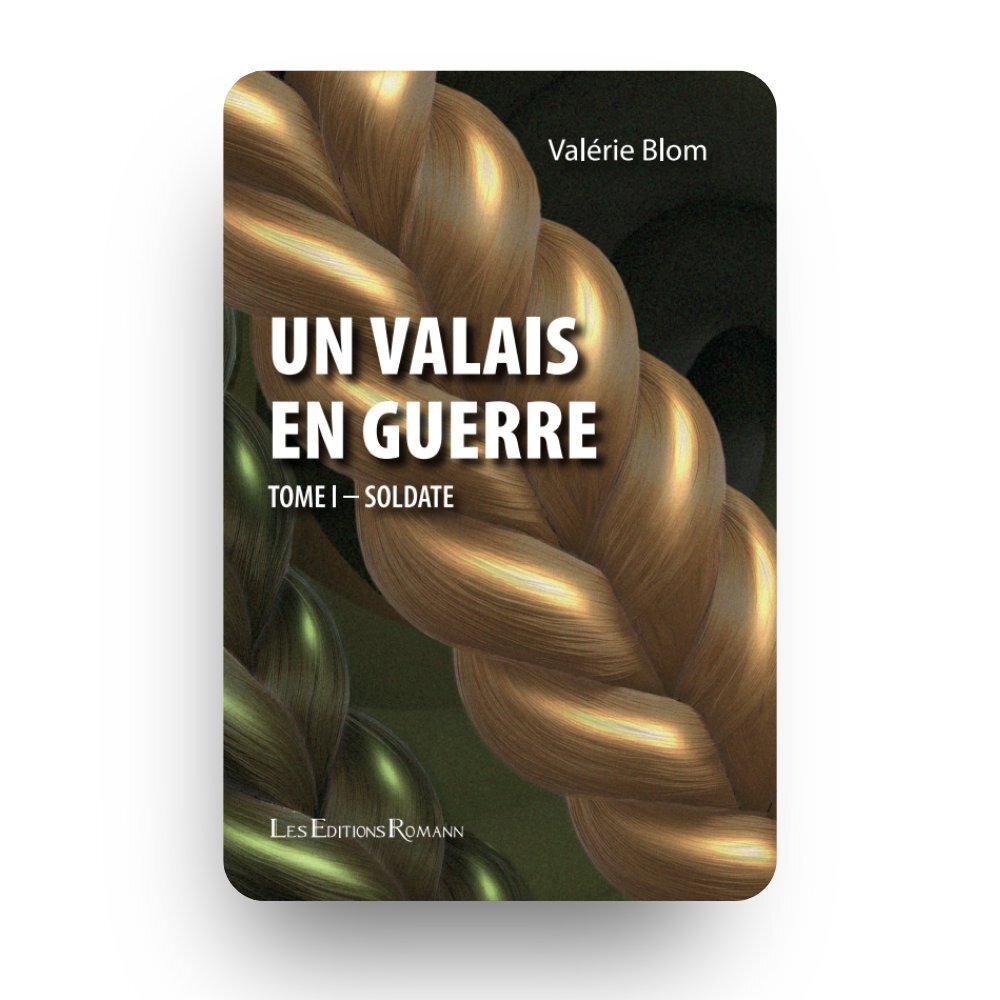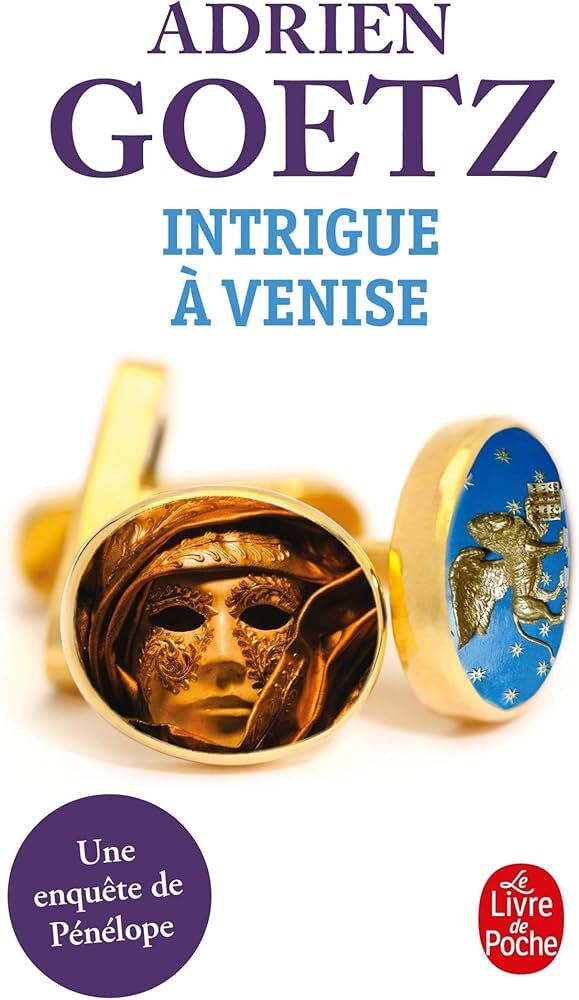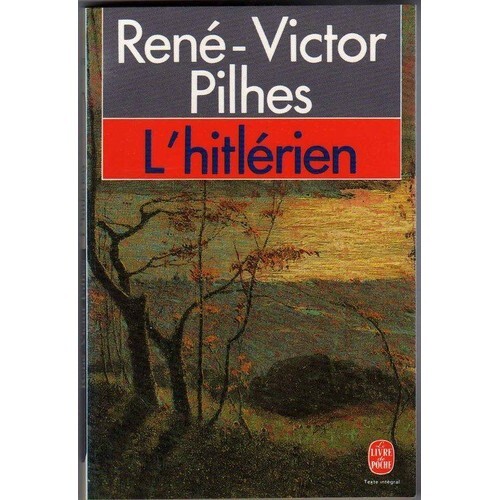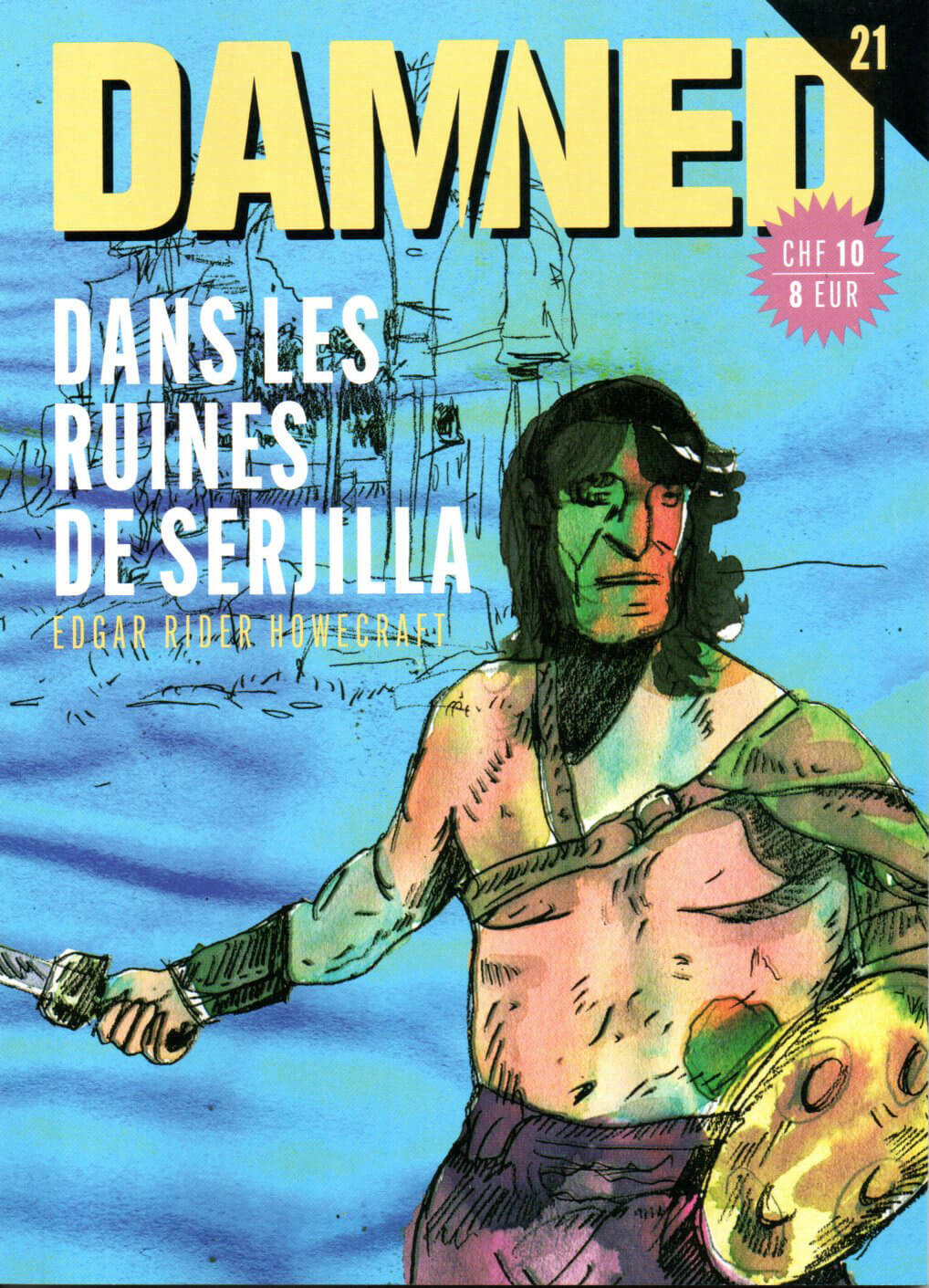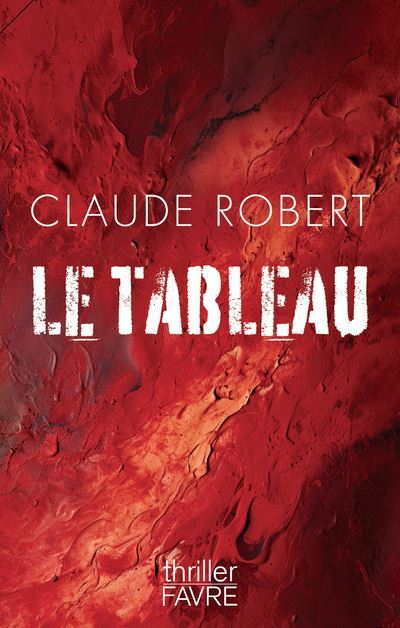Laurent Coos – Avant de se reconvertir dans le fitness et les livres consacrés au développement personnel à l'enseigne de Coos Gym et de LC Live Coach, Laurent Coos a développé une intense activité d'éditeur et d'écrivain spécialisé dans les genres du fantastique et de l'horreur. Cela lui a valu, de la part d'un de ses éditeurs, le surnom de "Stephen King suisse". L'intrigue de son roman "Post mortem" lui est venue à la suite d'un voyage qu'il a lui-même effectué le long de cette route américaine mythique.
Tout commence lorsque, pour fuir une audience de procès qui le concerne en qualité de prévenu, l'agent d'assurances Stanley Carlsons décide de quitter la Californie avec sa femme Betty pour refaire sa vie à Flagstaff, en Arizona. Pour ce faire, ils empruntent la Route 66 à bord d'une Plymouth de collection avec, à leur bord, une valise de billets de banque et, pour le côté grotesque décalé, un gros lapin rose en peluche surnommé Bugs Bunny.
Peu à peu, et c'est là que l'étrange et l'inquiétude s'installent, les personnages se demandent où ils vont vraiment. Pour construire une ambiance tendue et pesante, l'auteur place les bons ingrédients au bon moment: tensions entre les membres du couple, véhicule qui fait des siennes en perdant de l'huile, et soleil du désert qui cogne, pour faire bon poids.
L'analyse du fonctionnement du couple, en particulier, est réussie, tant pour ce qui concerne la situation initiale que pour la description de son évolution. On découvre ainsi un Stanley optimiste mais pusillanime, acceptant sans trop broncher les reproches trop vrais que Betty lui fait incessamment – elle ne manque pas de relever, en particulier, que si tous deux sont en fuite, c'est bien la faute de Stanley. Et peu à peu, curieusement, quelques mots plus doux s'installent, comme si l'amour, malgré les années et l'usure, refaisait surface pour reprendre ses droits.
Côté route, l'auteur décrit une Route 66 qui pourrait être vraie dans un monde parallèle: c'est un no man's land désertique où apparaissent parfois – mais toujours au bon moment, curieusement! – des garages et stations plus ou moins désaffectés. Qui tient la boutique à chaque fois, qui sont ces gaillards qui puent la mort et détestent les vivants? Et pourquoi Stanley a-t-il moins faim que son épouse, qui se jette avidement sur tout ce qui ressemble à un burger? En somme, Stanley est-il bien vivant?
Avec "Post mortem", Laurent Coos offre à son public un roman d'ambiances qui réussit à donner le frisson, inquiétant à souhait mais qui ne cède pas à une complaisance excessive lorsqu'il s'agit, et ça arrive au fil des pages, de regarder la mort en face. Ses personnages ne sont certes pas des plus attachants; mais on finit par apprécier la manière dont ils évoluent face à l'adversité. Une excellente lecture pour les longues nuits d'hiver... brr!
Laurent Coos, Post mortem, Charleston, SimpleEdition, 2008.