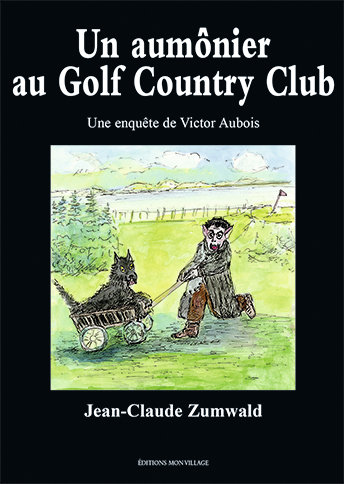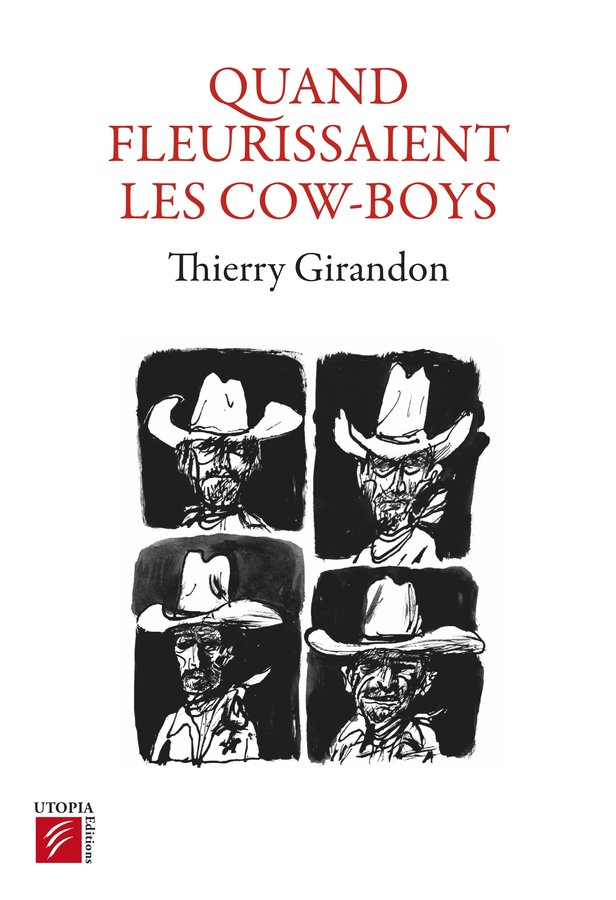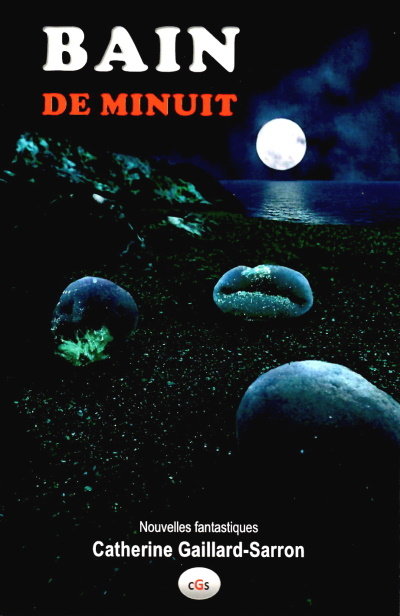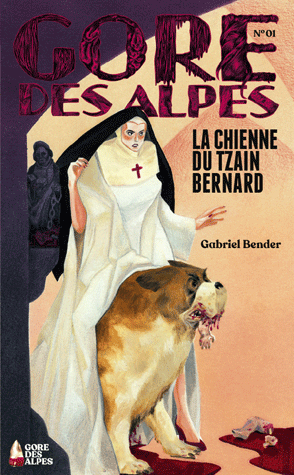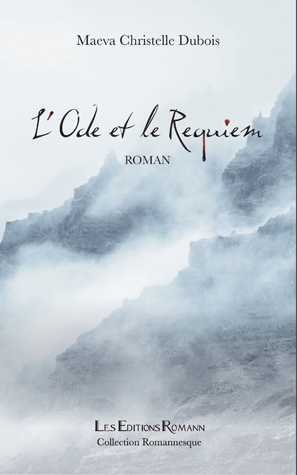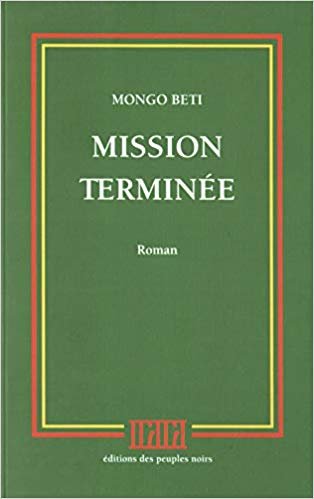
Mongo Beti – "Mission terminée", roman de l'écrivain camerounais Mongo Beti, a tout d'un roman d'apprentissage. Il met en scène un jeune homme qui vient de rater son bac, Jean-Marie Medza, et se voit chargé d'une mission essentielle, rituelle même: aller récupérer la femme d'un gars de sa tribu auprès d'une tribu voisine mais distincte.
Rien que dans cette rapide présentation, il y a beaucoup de choses, surtout dans le contexte où "Mission terminée" a été écrit: l'action se déroule aux temps où le Cameroun est une colonie française. En ratant son bac, Jean-Marie Medza se positionne illico comme un personnage qui n'est pas tout à fait acquis aux colons (ah, la sanction de la note, coup de fouet rituel!), mais déjà plus tout à fait Camerounais de tradition.
L'auteur précise certes que Medza est un bantou de souche. Mais jusqu'où est il prêt à l'assumer? L'été qu'il passe à aller récupérer la femme d'un autre s'avère révélateur. On peut se dire que Jean-Marie Medza doit vivre deux rituels d'entrée dans l'âge adulte: le rituel institutionnel du bac, raté, et celui de la tribu, qu'il lui faut réussir.
Cette double identité complexe qu'il faut gérer apparaît dès les premières pages, d'autant plus que Jean-Marie Medza est le narrateur de ce roman, un narrateur âgé qui se souvient de sa jeunesse. Nombreuses sont en effet les références aux mythologies européennes antiques qu'il évoque, sans parler des penseurs plus récents – qu'il a approchés dans le cadre de ses études pour obtenir tel ou tel diplôme. Valent-ils davantage que la sagesse africaine, camerounaise en l'occurrence? L'écrivain glisse dans "Mission terminée" quelques pages qui reflètent un débat nuancé qui, en définitive, se demande si le Blanc, colonisateur mais non dépourvu d'arguments, est supérieur au Noir, qui a pour lui sa culture et son art de vivre.
Écartelé entre la culture ancestrale et celle que l'école du colonisateur lui apporte nolens volens, Jean-Marie Medza doit vivre avec une image qu'il n'assume pas complètement, celle du gars à diplômes, celle de celui qu'on a envie de tester pour savoir si le colon est vraiment supérieur à l'indigène. On lui pose donc des questions, on lui demande ce qu'il a appris à l'école, ce que les diplômes décernés par les colons lui ont apporté. Jean-Marie répond comme il peut, et le lecteur ne peut que constater que Medza apparaît comme un demi-savant, conscient de l'être et qui s'en désole.
Et certes, les outils donnés par une éducation à l'européenne rendent Jean-Marie Medza incapable de répondre jusqu'au bout aux questions que lui posent des Africains bon teint, naïfs parfois – il est permis de voir dans son échec au bac une circonstance aggravante. Il n'empêche: poussé dans le système scolaire du colonisateur par une famille qui a considéré que c'était le mieux pour lui, Jean-Marie Medza apparaît comme un personnage au milieu du gué, ni vraiment formé à la culture du colon, ni vraiment à l'aise dans les us et coutumes tribaux pratiqués dans les régions reculées du pays.
On sent dès lors que l'expédition pour aller récupérer la femme de Niam est une plongée en terre inconnue pour Jean-Marie Medza – qui porte un prénom bien chrétien et français associé à un nom de famille du cru, ce qui souligne que ce personnage est le produit de deux éléments, pour ainsi dire le fleuve né de deux rivières. Medza va découvrir son propre pays, les sports méconnus qu'on y pratique localement (ce jeu de ballon où s'illustre le cousin Zambo, grand par la taille comme par la réputation), et y acquérir aussi des amis hauts en couleur que l'auteur surnomme de façon pittoresque. Jean-Marie Medza promène aussi un regard critique sur des traditions lourdes à vivre, faites de veillées et d'échanges de cadeaux, où il est impératif d'accepter de prendre son temps.
Reste que le lecteur se retrouve face à une société des forêts curieusement progressiste, ayant par exemple admis l'idée de divorce émise par le colonisateur, tout en conservant un attachement à ses traditions, si lourdes qu'elles soient, ou systémiquement discriminantes envers la jeunesse par exemple. Les idées du colonisateur font débat dans "Mission terminée", de façon raisonnée, comme si l'auteur recréait au fil des pages des débats courants.
Et si "Mission terminée" apparaît comme un roman de formation, c'est aussi au travers des rapports de Jean-Marie Medza aux femmes: lui-même débutant en la matière, il revendique le droit de commencer dans les plaisirs amoureux avec une fille aussi débutante que lui. Une première manière de se révolter contre une société trop prompte à lui jeter dans les bras, avec force arguments vendeurs, telle ou telle femme, en le supposant consentant. Mais en la matière, Edima, la jeune fille qui tourne autour de Jean-Marie pendant tout son séjour dans la brousse, n'est cependant elle-même ne sera qu'une étape... et en bon conteur, Mongo Beti dira le destin d'Edima dans un épilogue qui rappelle, sans passion exacerbée, qu'on en est là et pas ailleurs.
Mongo Beti, Mission terminée, Rouen, Editions des Peuples noirs, 2016/première édition Paris, Buchet-Chastel/Corrêa, 1957.
Le site consacré à Mongo Beti, les éditions des Peuples Noirs, la Librairie des Peuples Noirs.
Lu par Touhfat Mouhtare-Mahamoud.