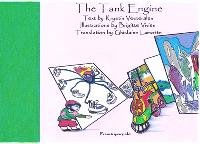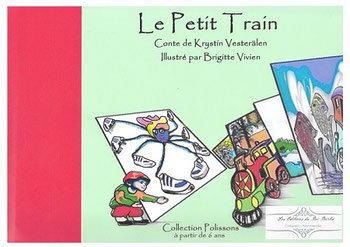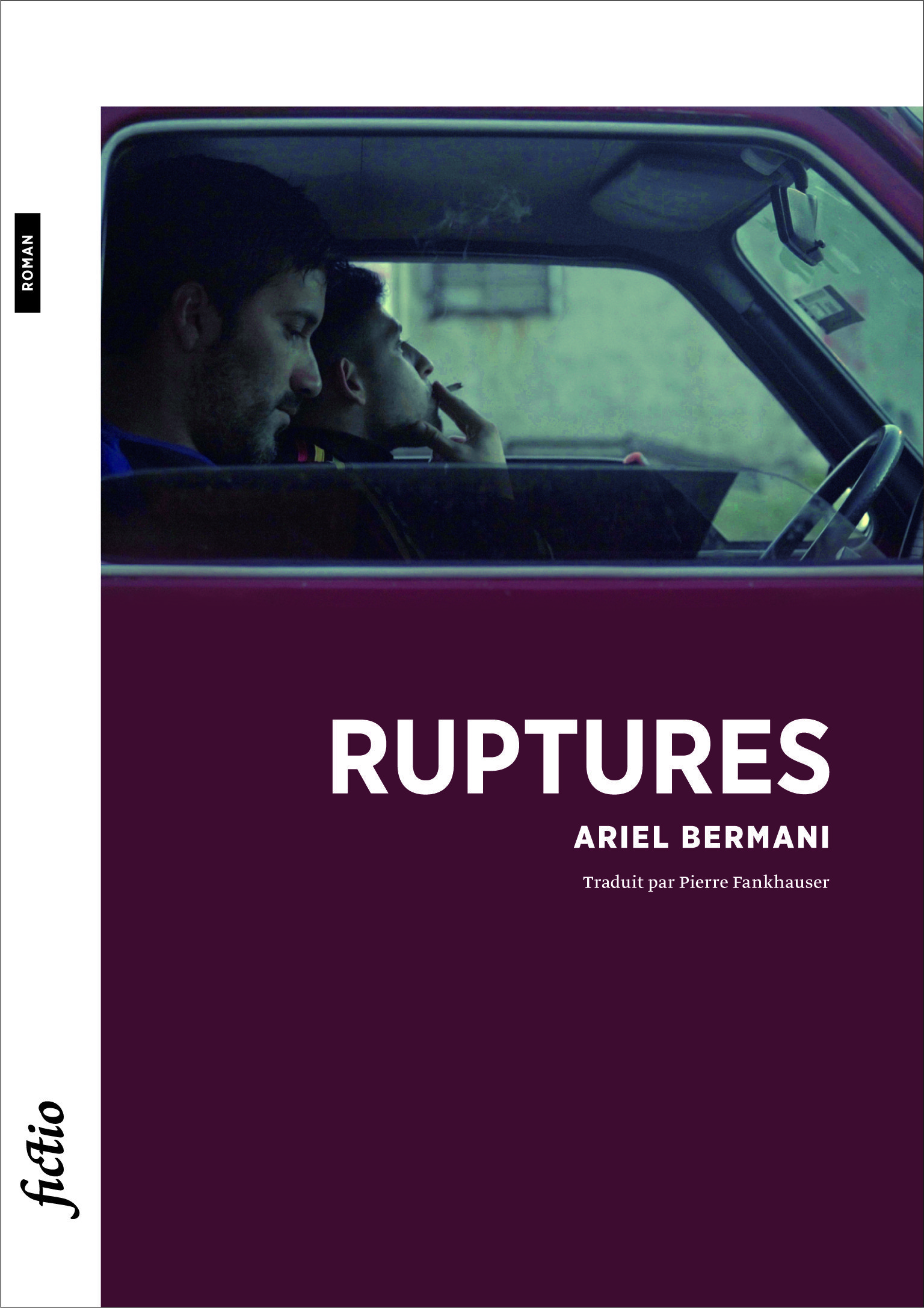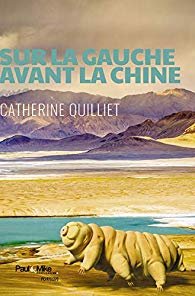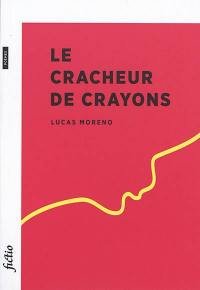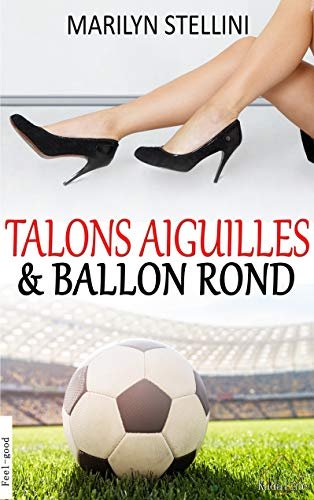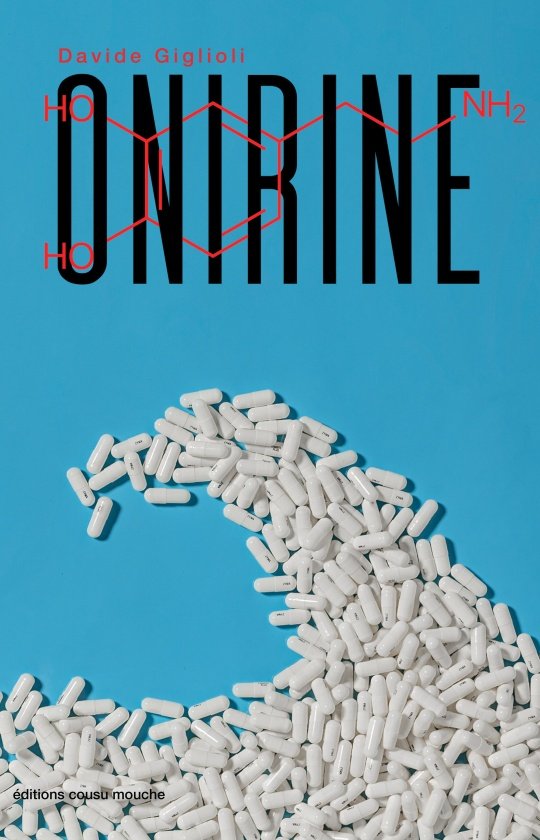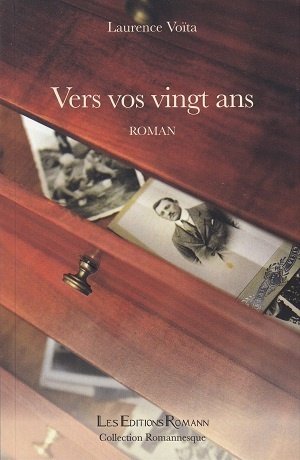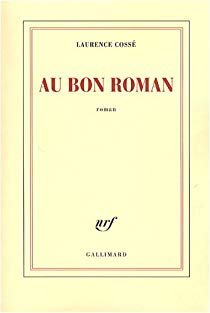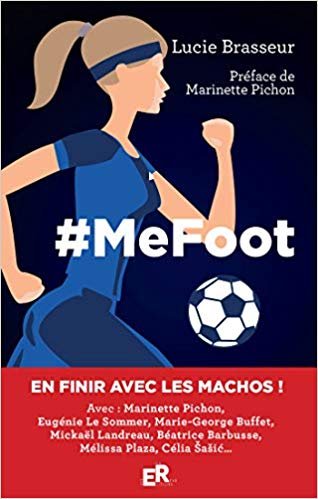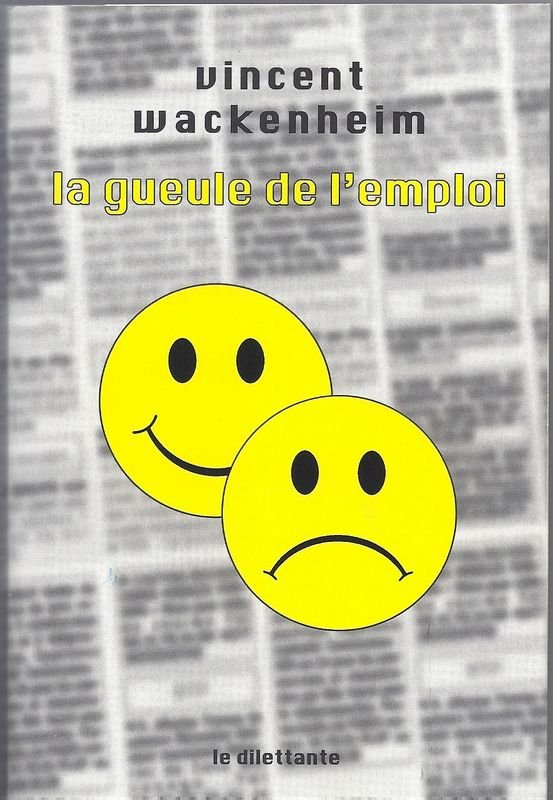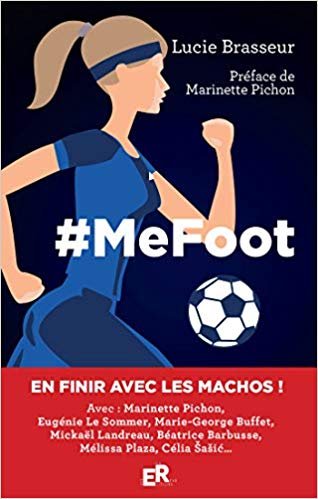
Lucie Brasseur – Ce soir même, a lieu le coup d'envoi de la coupe du monde de football féminin. Une manifestation sportive est toujours quelque chose qui compte, et il est permis de croire que l'événement, organisé en France, donnera un surcroît de visibilité à un sport qui, au féminin, connaît un déficit d'image. L'écrivaine Lucie Brasseur a choisi d'aller y voir de plus près, dans un esprit résolument féministe. "#MeFoot" est le résultat de ce travail d'investigation. Double résultat, même: "#MeFoot", c'est un livre, mais aussi un documentaire TV, réalisé par Marc Arnaud. Le présent billet porte sur le livre.
Brièvement avant toute chose, il est permis de mettre en cause la formulation du sous-titre du livre, qui apparaît en bandeau: faut-il, comme on lit, "en finir avec les machos!"? Ou alors "en finir avec le machisme"? Si la seconde formulation admet que la personne machiste peut s'amender, la première, essentialiste, suggère qu'il faut s'en débarrasser par tous les moyens. Pour le dire diplomatiquement, c'est limite menaçant.
Enfin, passons! Voyons ce que le livre a entre ses quatre pages de couverture.
La structure du livre épouse celle d'un reportage de terrain, parfaitement journalistique, mariant de façon équilibrée les analyses et les entretiens, généreusement transcrits, avec des actrices (et quelques acteurs) concernés. L'auteure permet ainsi au lecteur d'entendre la parole de footballeuses (Eugénie Le Sommer), de cadres, de personnalités politiques (Marie-George Buffet), mais aussi d'un homme au moins, en la personne de Mickaël Landreau. Les questions visent à chercher en profondeur les obstacles qu'une fille, dès son plus jeune âge, peut trouver sur sa route si elle veut taper dans le ballon. Ainsi se dessine un stéréotype: le foot, c'est un sport de mecs.
Dès lors, il sera question de pratique du jeu, et l'auteure écoute avec intérêt des fillettes qui jouent au foot et s'expriment sans filtre sur les différences de pratique entre elles et leurs collègues masculins: "Les filles sont plus intelligentes que les garçons. Elles font moins de fautes" ou "Oui, nous on joue l'efficacité, le collectif", lit-on par exemple. Mais c'est le même sport, et l'auteure, en observant des matches, considère que du point de vue technique, les filles n'ont rien à envier aux garçons. Pareil ou pas pareil? "#MeFoot" a l'intelligence de ne pas trancher, quitte à ce que cela paraisse paradoxal, voire contradictoire: les points de vue ont le droit de diverger.
Reste que les entretiens posent constamment la question du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Et le lecteur a l'impression que l'auteure, à force de creuser (d'un point de vue sociologique, mais aussi historique: sait-on que le foot a été interdit aux femmes pendant quarante ans en France?), veut un peu trop voir le verre à moitié vide. La formulation des questions s'avère révélatrice parfois – on pense à l'envie de parler d'écriture inclusive à Célia Šašić, Franco-Camerounaise active dans le championnat allemand. Autre élément: le regret constamment ressassé que telle avancée arrive si tard: "Vingt-huit ans après sa création, la France accueille – enfin – pour la première fois, la Coupe du monde de football féminin", lit-on dans le prière d'insérer. On a envie de répliquer qu'il n'est jamais trop tard... et que partant, le "enfin" est de trop dès lors que les choses bougent.
Alors oui: la démarche de l'auteure est pointue, dérangeante parfois; elle permet de déceler les obstacles placés sur le chemin du football féminin. Elle met au jour les préjugés de genre ("c'est un sport de garçons"), les regards pas toujours élégants (il y un florilège de sorties pas forcément anciennes qui révèlent un certain mépris à l'encontre des footballeuses) et aussi les difficultés logistiques et financières, mais aussi spécifiques (la question du cycle menstruel) d'un sport qui, dans sa version féminine, n'a pas acquis la visibilité qu'il estime lui être due – et qui serait source de finances, donc de salaires décents pour les professionnelles de ce sport. En somme, question fric, il y a de l'indécence vers le haut chez les hommes, et vers le bas chez les femmes.
Le diagnostic étant posé, quelles seraient les solutions? L'auteure dissémine quelques pistes au fil des pages, et ses interlocutrices et interlocuteurs ont des idées aussi, mais force est de constater qu'il n'y a pas de rubrique spécifiquement consacrée aux conseils aux acteurs, institutionnels entre autres. C'est dommage: dénonciateur de problèmes spécifiques, le livre "#MeFoot" laisse l'impression de n'être pas tout à fait en mesure d'ouvrir des pistes structurées et raisonnées pour y répondre.
On préfère dès lors lire les nombreux commentaires des actrices, des femmes de terrain, des footballeuses en somme, cités dans les "Bonus" du livre. Interviewées, celles-ci ne masquent jamais les difficultés liées à la pratique de leur sport en tant que femmes, mais préfèrent, on le sent clairement, relever les avancées réalisées ces dernières années et dire qu'elles se sentent les actrices d'une pratique sportive en plein essor, porté par la passion de celles qui s'y adonnent: les stades sont de plus en plus pleins, on a des équipements adaptés, on débloque des budgets. Ces commentaires positifs, l'amateur et l'amatrice de football féminin les garderont dans leur cœur à l'issue de leur lecture de "#MeFoot".
Lucie Brasseur, #MeFoot, Astaffort, Editions du Rêve, 2019, préface de Marinette Pichon.