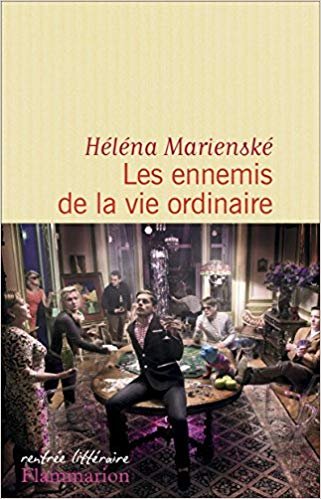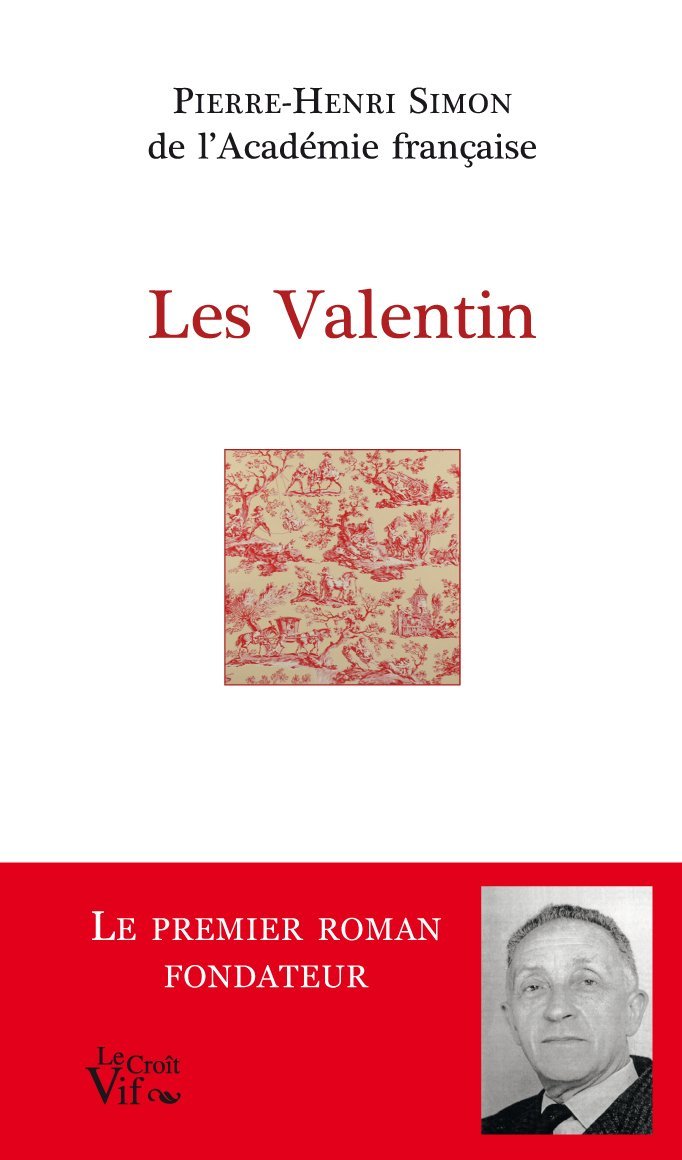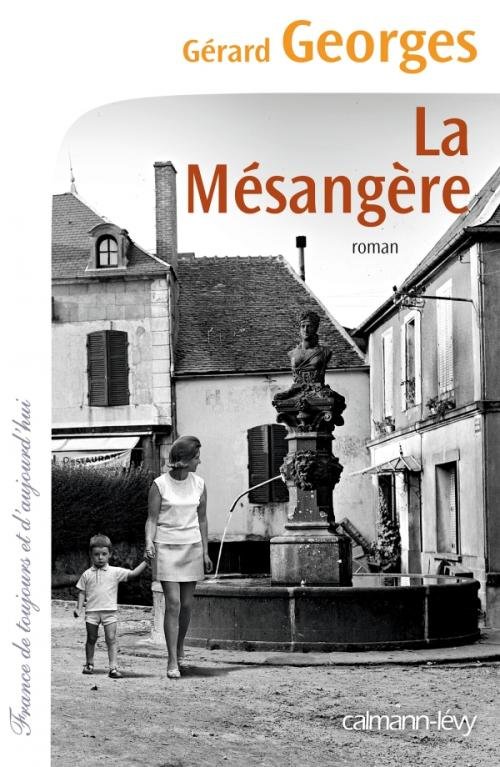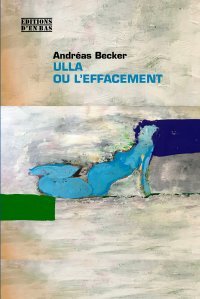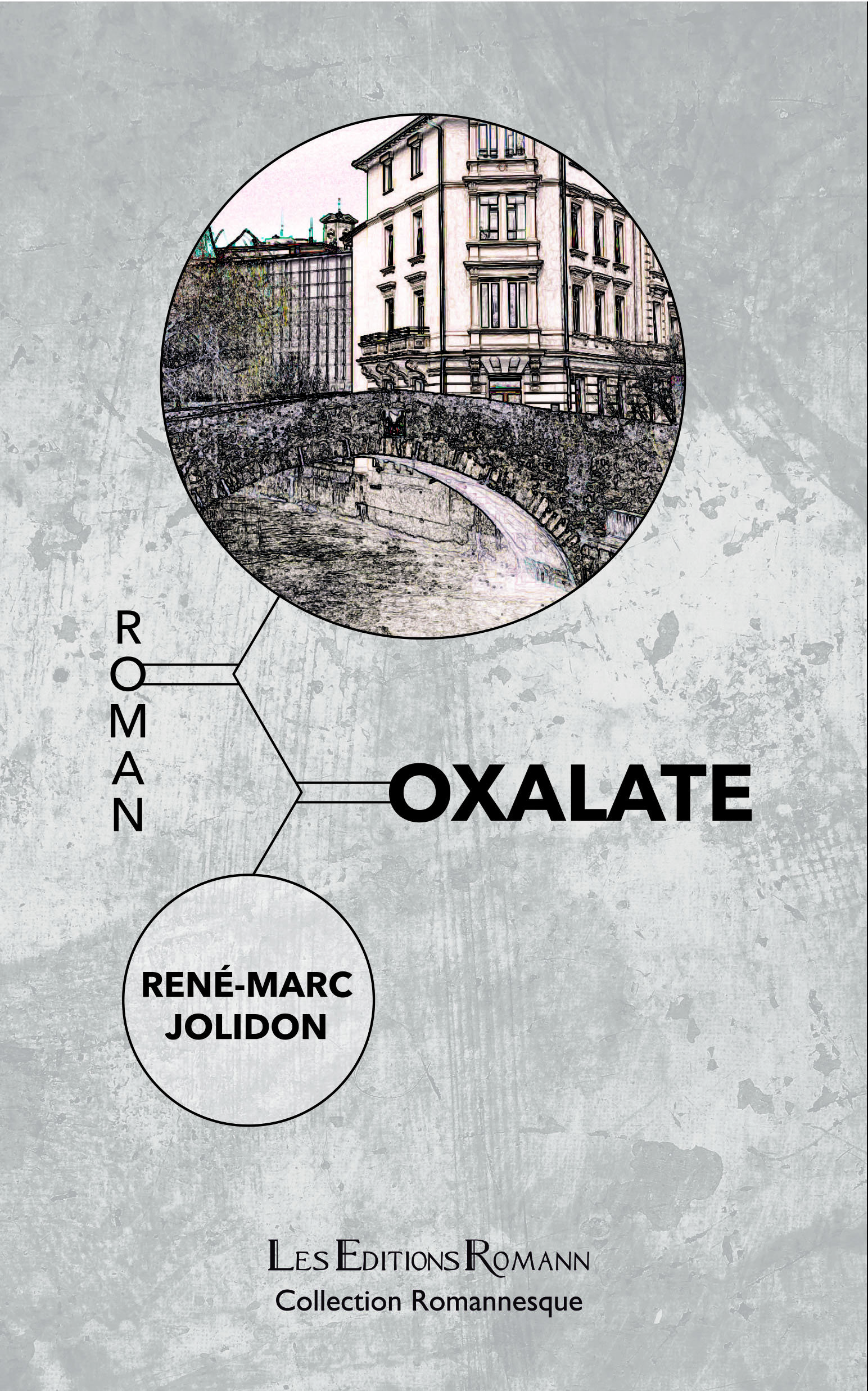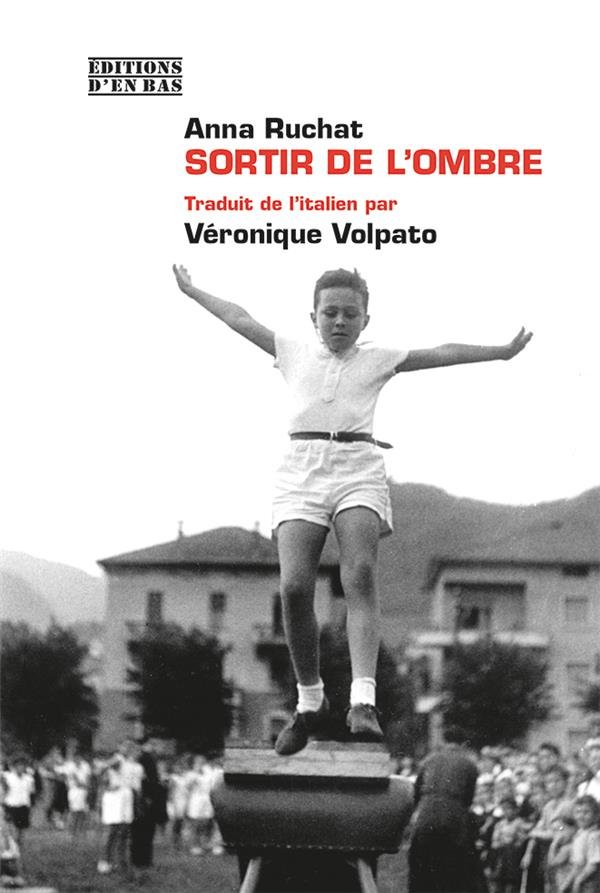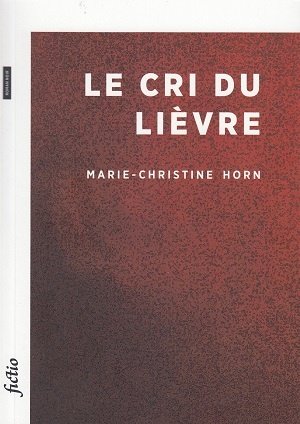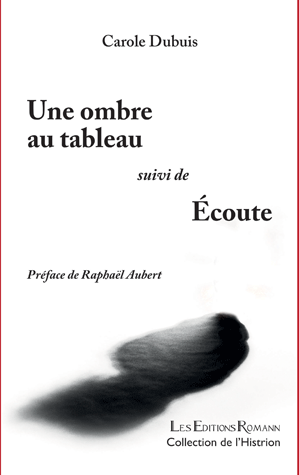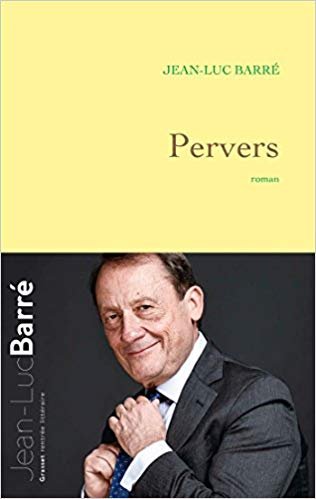
Jean-Luc Barré – N'y a-t-il rien de plus tordu qu'un écrivain? Avec "Pervers", Jean-Luc Barré propose son premier roman, et si je l'ai lu, c'est après une rencontre d'exception. Brillant biographe et éditeur, l'auteur s'immisce dans un monde nouveau, celui de la réalité reconstruite, voire mensongère, du roman: les limites entre la réalité et l'imaginaire s'effacent. Cela, autour de Victor Marlioz, personnage fictif d'écrivain que l'auteur démasque doucement sur un roman de 208 pages.
Victor Marlioz? Cet écrivain qui cultive sa rareté se sent légitime à inviter un critique littéraire dans sa retraite ligurienne de Portofino afin de lui annoncer qu'il met fin à son activité de romancier. Reste que le narrateur, Julien Maillard, l'invité justement, qui connaît son monde et s'est renseigné sur Victor Marlioz, n'est pas totalement dupe. Le lecteur va donc voir comment vont lutter le critique qui fait son métier, l'écrivain qui a ses astuces et, en joker, l'éditeur qui a tout vu et tout vécu.
"Tout vu et tout vécu": Durban joue les éditeurs blasés, lâchant comme sans faire exprès des anecdotes sur le monde de l'édition parisienne, un monde où l'on sait piquer autrui. Insistant, l'écrivain pointe une tache qui n'est pas aveugle: le suicide de la fille de Victor Marlioz, Alexia. On en parle, on n'en parle pas? Les personnages s'interrogent. Et mine de rien, le lecteur commence à trouver Victor Marlioz détestable sous son chapeau de feutre. Quel jeu a-t-il joué?
C'est que livre après livre, le vieil écrivain ne peut écrire quoi que ce soit sans manipuler son entourage, les vraies gens qu'il a connus. Ici, son attitude est précisément celle d'un pervers. Cela, avec des conséquences difficiles: une scène de candaulisme non consenti, un viol, un aveu que son enfant n'a pas été désiré. S'il y a un manipulateur, terrible s'il en est dans ce roman, c'est donc bien l'auteur de "Pervers", on le comprend. Alors, une question traverse "Pervers": Victor Marlioz, pervers comme sans faire exprès, est-il responsable du suicide de sa fille? De page en page, l'auteur entretient le mystère, ne tranche jamais de façon franche, mais le lecteur finit par comprendre.
Et Maillard, journaliste désireux de faire une interview, se retrouve pris au piège. Un piège où, nolens volens, l'entourage de Victor Marlioz est impliqué. Certains personnages, en particulier l'épouse alcoolique de Marlioz, donnent un point de vue sur le grand écrivain qui partage leur vie, de façon amicale ou amoureuse. L'alcool sait délier les langues, mais Marlioz, s'il souhaite parler de lui, est aussi jaloux de ses secrets: son discours a des airs de stratégie de communication malgré ses dessous sincères.
"La marque du romancier tenait à la froideur de son écriture, au regard clinique qu'il portait sur ses personnages, à un style qui refusait tout concession à la littérature": telle est la philosophie de l'écrivain Victor Marlioz dans "Pervers". Cette option d'écriture choisie par Jean-Luc Barré concourt à la tonalité sérieuse et précise du livre, une tonalité qui entre en résonance avec le grave métier de biographe de Jean-Luc Barré. Cela, dans un contexte où la fiction et le réel ne sont séparés que par une frontière poreuse.
Jean-Luc Barré, Pervers, Paris, Grasset, 2018.
Lu par Florian Vallaud, Folies d'encre, Les Livres de Joëlle, Mes p'tits lus, Olivier, Osez le livre.
Le site des éditions Grasset.
Le site des éditions Grasset.