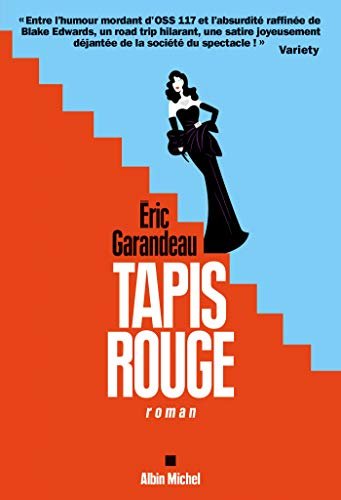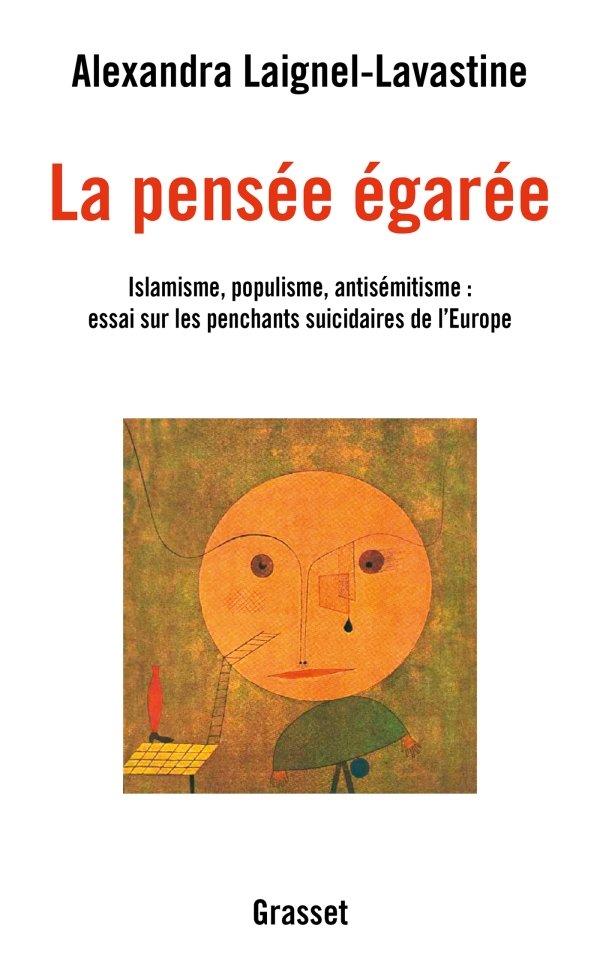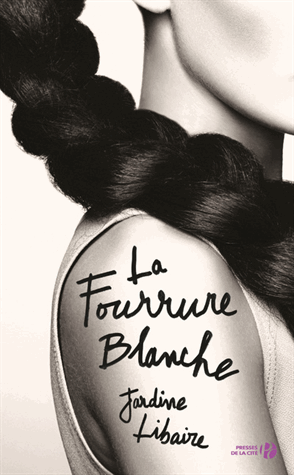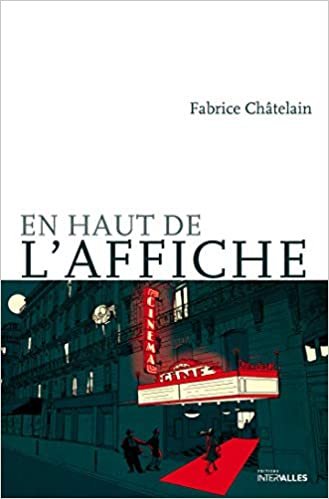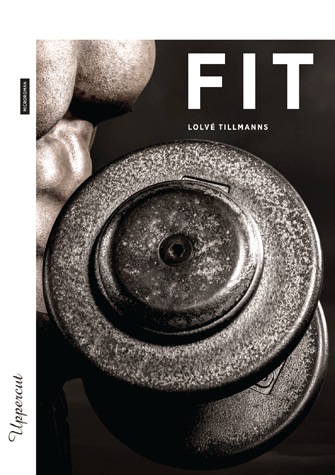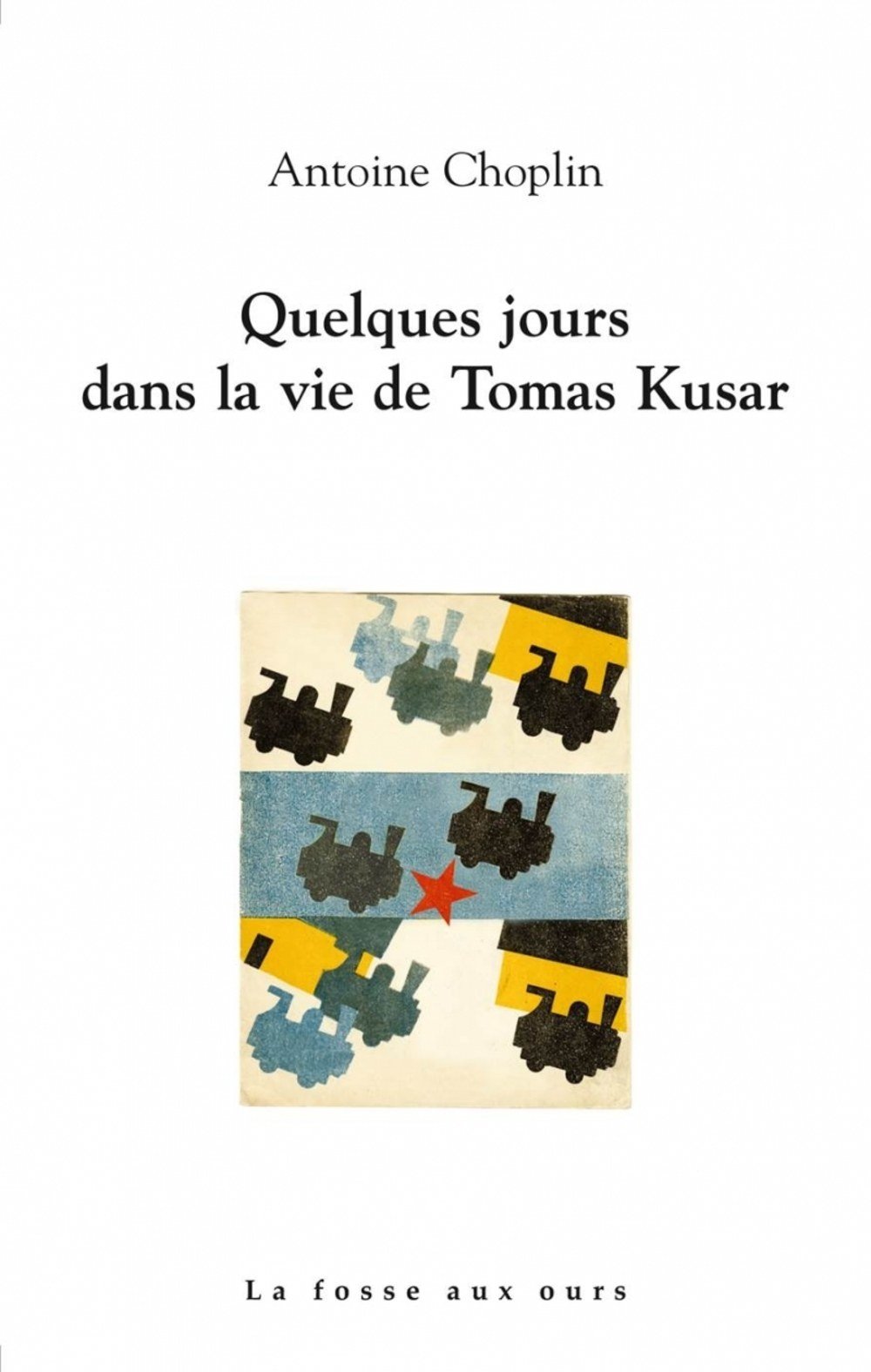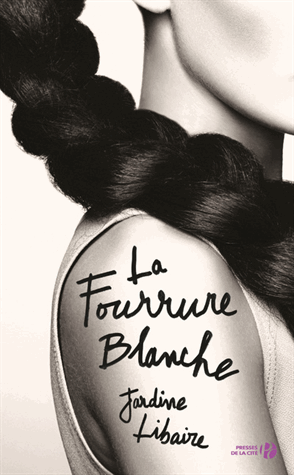
Jardine Libaire – On s'aime par-delà les classes sociales, et on assume, même si ce n'est pas facile tous les jours. C'est ce que raconte "La Fourrure blanche", roman de l'écrivaine américaine Jardine Libaire. Elle est fille de junkie, lui est fils de milliardaire: rien ne rapproche Elise et Jamey.
Au fil des pages, Jardine Libaire réinvente la romance à l'américaine sur un ton grave qui n'empêche pas le happy end de rigueur – que la gravité même du récit rend incertain, ainsi que la saisissante scène initiale du roman: Elise pointant un fusil de chasse vers le cœur de Jamie dans une chambre de motel minable. Comment, pourquoi? Le lecteur s'interroge, et pour savoir, il tourne les pages.
Des personnages issus de familles dysfonctionnelles
L'écriture s'avère certes fluide, mais sans facilités: les chapitres sont assez longs, puisqu'ils recouvrent tout un mois de vie commune. Tout au plus peut-on relever, sans en être certain, qu'ils tendent à se raccourcir peu à peu. Habile, l'écrivaine joue cependant la partition du rythme avec science, alternant en un savant dosage les pages de dialogues rapides et celles, plus lentes, où l'on décrit et où les personnages pensent à eux.
Des personnages qui pensent à eux? Oui! L'écrivaine campe avec Elise et Jamey des personnages d'une profondeur extrême, vus tous azimuts. Elise a une épaisseur, elle a un passé qui permet à l'auteure de développer sans la juger une vision d'une réalité sociale, celle de certains Portoricains surnommés Boricuas – en l'occurrence celle d'une famille qu'on dirait dysfonctionnelle, avec un père parti, une mère à la ramasse et une fratrie qui s'organise comme elle sait.
Mais la riche famille de Jamey fonctionne-t-elle mieux, si propre sur elle qu'elle veuille paraître? Fils de milliardaires apparemment peu concerné par la vie, il est ballotté entre des parents peu présents, si ce n'est pas le biais de l'argent, par exemple lorsque le père, débordé par ses affaires, offre un cadeau de Noël à son fils, de sa part, en déléguant son achat et son envoi à un subordonné. Il est ainsi permis de lire l'idylle d'Elise et Jamey comme la rencontre de deux détresses familiales, par-delà les classes sociales.
Et puis il y a les descriptions physiques, qui rendent rapidement Elise et Jamey familiers: Elise qu'on reconnaît à ses petites tresses, Jamey qu'on reconnaît à son visage en forme de cœur (quel symbole amoureux évident!) et à sa veste en poils de chameau, qu'on verra s'user au fil des pages: une usure qui symbolise l'évolution du personnage, pourrait-on dire – moins riche, mais plus confortable, comme un vêtement moins neuf mais dans lequel on est plus à l'aise. Quant à "La fourrure blanche", le titre du livre fait référence au vêtement qu'Elise privilégie au début du livre. Symbole de pureté, de terre vierge? En tout cas de "terra incognita" dans tous les sens du terme pour Jamey, même si, au moment de leur rencontre, Elise, pour sa part, a déjà vu du pays.
Une hiérarchie sociale pour une autre?
On comprend dès lors, au terme de "La Fourrure blanche", que les 429 pages du roman sont le récit d'une émancipation radicale par deux êtres que tout éloigne... et que tout rapproche aussi. Emancipation de l'argent, puisque Jamey renonce à sa part d'héritage, ce qui pourrait paraître suspect aux yeux de sa famille: ne lâche-t-il pas tout pour une toquade qui n'en vaut pas le premier centime? Emancipation de la société américaine aussi, qui a ses hiérarchies rigides que l'auteure intègre avec un grand naturel dans la narration (on trouvera dans "La Fourrure blanche" un personnage suffisamment odieux pour parler de "cancer gay" pour dire "sida"). Ce qui tranche avec l'idée que les Etats-Unis sont un pays où tout le monde a sa chance...
Tout au plus est-il permis de se demander si l'Inde, pays à castes rigides, est bien le pays prometteur de vie libre et vraie que l'on peut se promettre. Et si, en quittant une hiérarchie sociale, on ne fait rien d'autre qu'en intégrer une autre, pas forcément meilleure, dont on ne peut s'abstraire que par le fric ou les cadeaux, peut-être – la scène finale, montrant Elise qui offre des fraises à une pauvre Indienne, est parlante et nous dit que la romancière est lucide sur cette question. Même si elle constitue un autre chapitre... qui dépasse quelque peu "La Fourrure blanche".
Vers la vie des sens
L'auteure dessine aussi avec acuité le regard que les classes sociales respectives des deux personnages projettent l'une sur l'autre. Forcément, il y a de la méfiance du côté de la riche famille de Jamey, et l'auteure illustre, en faisant agir et parler ses personnages, que Jamey fera une mauvaise alliance avec cette fille. Reste que de l'autre côté, l'entourage d'Elise a aussi ses préjugés à l'encontre des très riches. Et la force de "La Fourrure blanche" est de simplement décrire, laisser dire, sans juger justement.
Et puis, il y a la vie des sens... On dit ce roman d'amour incandescent, et ce n'est pas faux. Bien sûr, pour ce qui est de la trame, on peut penser au film "Love Story", avec certes une issue différente. Mais l'écrivaine de "La Fourrure blanche" va plus loin en décrivant, parce que cela fait partie de la vie amoureuse de la fin des années 1980 et que cela intéresse les lecteurs d'aujourd'hui, la vie des sens de ses personnages. Là aussi, l'équilibre est précis, fin, afin de donner au lecteur l'impression d'y être sans foncer dans l'écueil du voyeurisme. Incandescent, dit la critique? Oui, et de façon maîtrisée pour accrocher.
Hypergamie?
"La Fourrure blanche", en somme, c'est le roman de deux jeunes gens qui, peu à l'aise dans leur univers social, décident ensemble de s'en créer un nouveau, rien qu'à eux, en vivant cachés pour être pleinement heureux. Alors oui, cet n'est pas la première fois qu'on raconte l'histoire d'un jeune homme riche et d'une jeune fille pauvre qui s'aiment et s'apprennent l'un l'autre – c'est le plus vieux moteur de la romance, animée par l'hypergamie, mais pour le coup, la romancière, rouée, entretient le doute, entre intérêt et pureté des sentiments.
Et on y croit, une fois de plus: c'est avec un regard particulièrement aigu que l'auteure observe son petit monde, allant chercher le détail qui fait mouche ou dit tout, que ce soit un plat partagé ou un geste. Cela, tout en osant de surcroît les comparaisons parlantes qui ajoutent un supplément de poésie bien solide et ciblée au propos. Un travail d'orfèvre.
Jardine Libaire, La Fourrure blanche, Paris, Presses de la Cité, 2018. Traduction de l'anglais (Etats-Unis) par Christine Barbaste.
Lu par Books & Boom, Carolivre, 2 petits loulous, Dobby, Emily Costecalde, Gwen, Je veux tout lire, Misa, Scarlett, Shangols, Sylvie Sagnes.