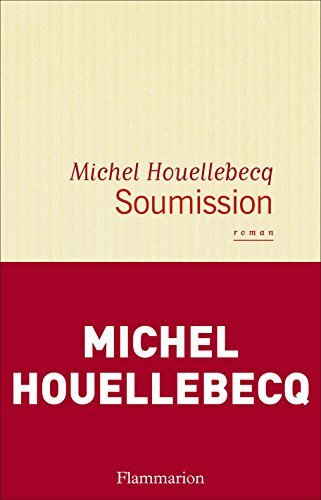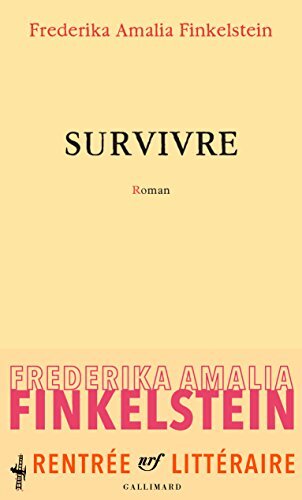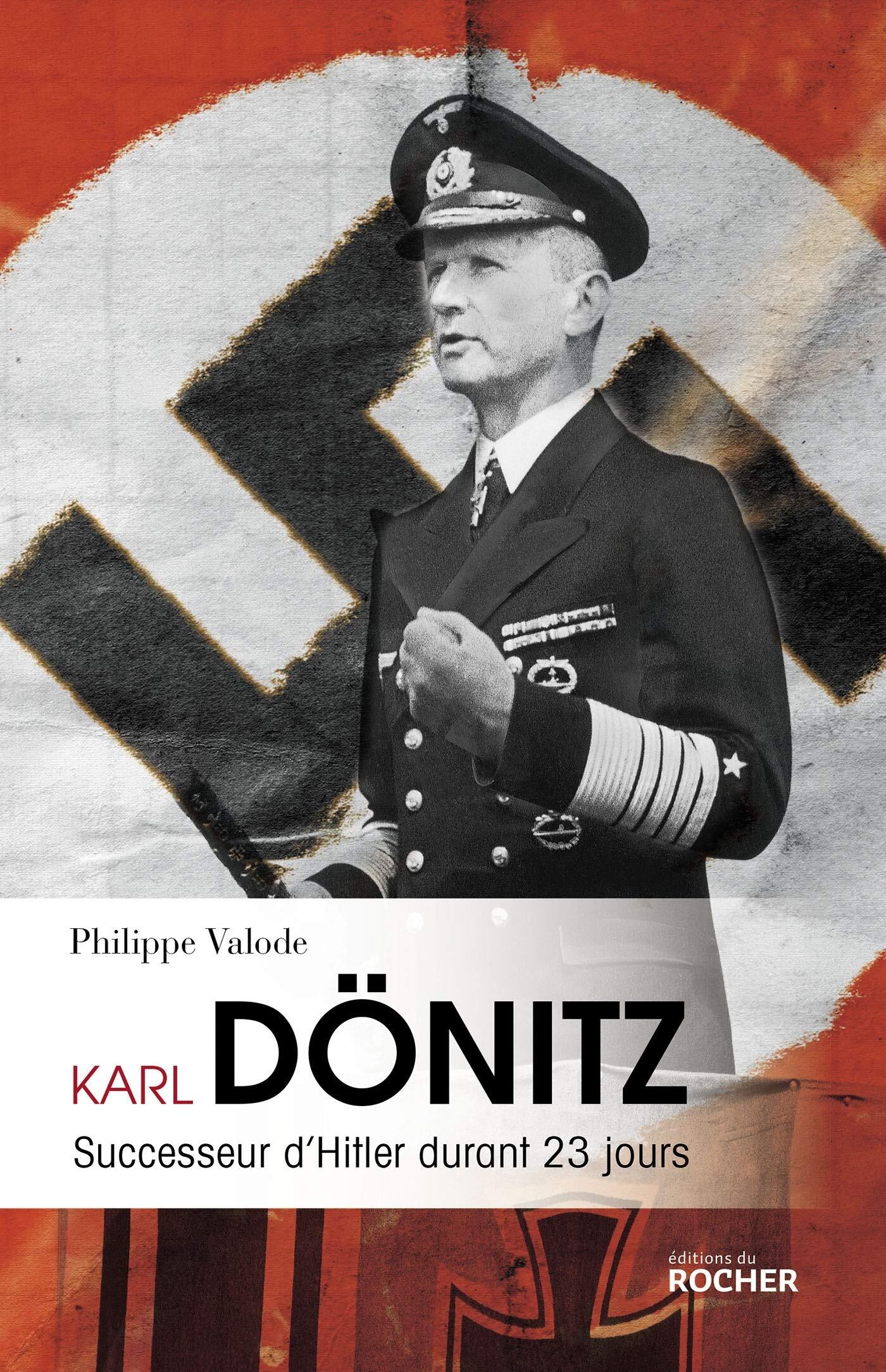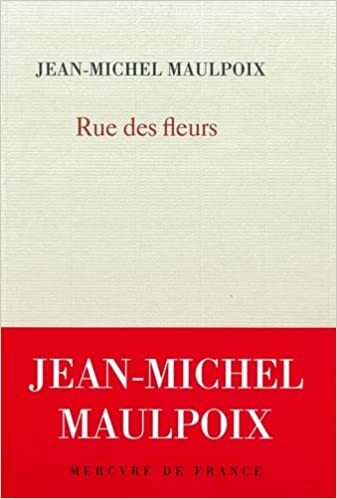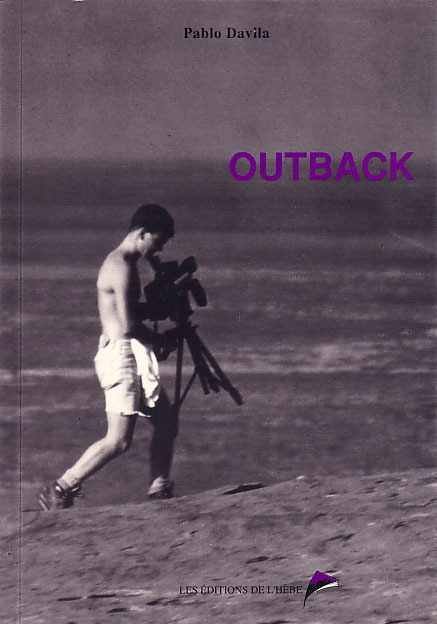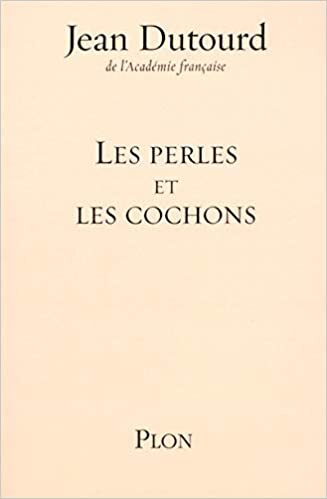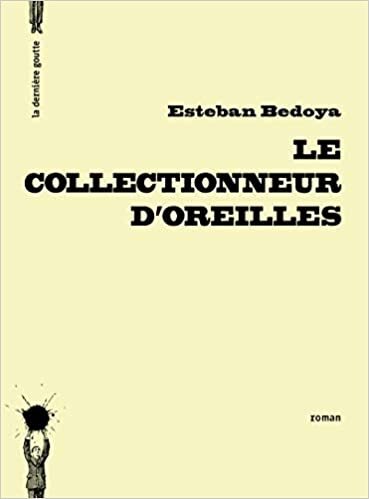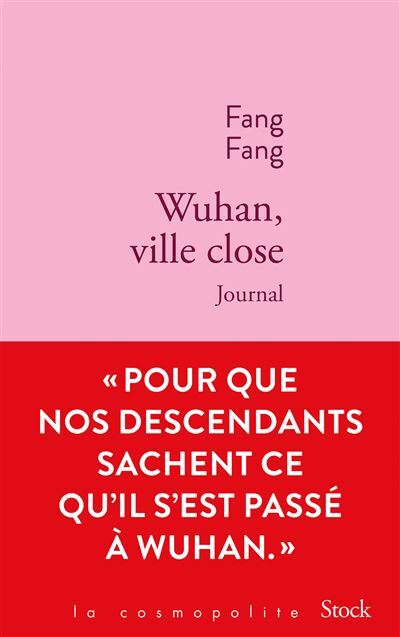Michel Houellebecq – Alors que Michel Houellebecq vient de publier un nouveau roman, je comble mon retard... d'autant plus que les circonstances font que c'est la première fois que je parle sur ce blog d'un roman de cet écrivain. Pour le coup, il s'agit de "Soumission", un roman de politique-fiction qui cristallise, comme on le sait, quelques éléments d'actualité: le rituel de l'élection présidentielle française, ainsi que l'arrivée possible à la tête du pays d'un président partisan de l'islam politique.
On retrouve dans "Soumission" la manière d'écriture "blanche", travaillée pour être aussi inexpressive et lisse que possible, qui est la marque de fabrique de l'écrivain. Cela permet au propos de résonner dans la tête du lecteur, sans que celui-ci ne soit jamais distrait par des élans de lyrisme ou de dramatisation excessive. Ainsi racontés, certains éléments, par exemple le retour en force d'une forme forte de patriarcat pourtant assez bien acceptée même si elle assigne les femmes au rang de perpétuelles mineures, s'avèrent d'autant plus glaçants.
C'est que "Soumission" est le récit de l'acceptation souple, par les Français, d'un mode de vie foncièrement différent, fondé non sur la laïcité, l'humanisme et les lumières de la raison, mais sur la charia, loi d'inspiration divine. Les professeurs en Sorbonne eux-mêmes s'y plient, par obligation, par indifférence (la Sorbonne vaut bien une chahada...) mais aussi par intérêt, puisque leur salaire est massivement revalorisé, ce qui leur permet d'avoir plusieurs épouses – sachant que seuls les hommes sont habilités à enseigner dans ce contexte.
Je ne peux m'empêcher de relever que la bonne grâce globale avec laquelle les populations d'Europe occidentale (les "moutons", disaient les sceptiques) se sont pliées aux contraintes sanitaires anti-covid 19, pas toujours adéquates, montrent que si paradoxal que cela puisse paraître, un recul massif de la démocratie libérale est possible. Elle est souhaitable même pour certaines parties en présence, par exemple pour sauver le climat.
Prenant l'exemple de l'islam politique, porteur dans la perspective d'un roman, l'auteur pointe du doigt, de manière étonnamment crédible, le manque d'envie de démocratie de la France, et plus largement des sociétés dites occidentales. Il va jusqu'à ne mettre en scène aucune forme de résistance organisée. Tout au plus y a-t-il celle, finalement très vincible, d'un narrateur blasé et ennuyé par son temps, tenté par un mysticisme à la Joris-Karl Huysmans – écrivain dont la vie traverse tout le roman, comme un contrepoint à la vie du narrateur, professeur d'université de son état. Ainsi éclairée, la fin a dès lors quelque chose de prévisible...
De façon apparemment réaliste, l'écrivain dessine avec une douceur surprenante quels pourraient être les contours d'une république islamique à la française, née sans révolution: disparition des solidarités froides nées des assurances sociales au profit d'une solidarité chaude familiale ou clanique, évolution des équilibres dans un enseignement assuré par de seuls musulmans plus ou moins fraîchement convertis, etc. – cela, grâce au ralliement des partis républicains, prêts à brader la république à l'islam politique plutôt que de la laisser au Front National. Quelques personnages politiques connus affleurent dans l'implacable "Soumission", tels Manuel Valls ou François Bayrou (qui prend cher).
Au terme de la lecture de "Soumission", ce n'est pas à la seule France que le lecteur pense. Il ne peut manquer de songer à l'image renvoyée d'une Europe vue comme une vieille gloire molle, ayant oublié qui elle est, indistinctement ouverte à tous les vents – et le premier arrivé ramasse le morceau.
Michel Houellebecq, Soumission, Paris, Flammarion, 2015.
Lu par Anaïs, Carnet Parisien, Kyaraddict, Lauraline79, Lily, Luis, Sans connivence, Stef, Topobibliotheca.