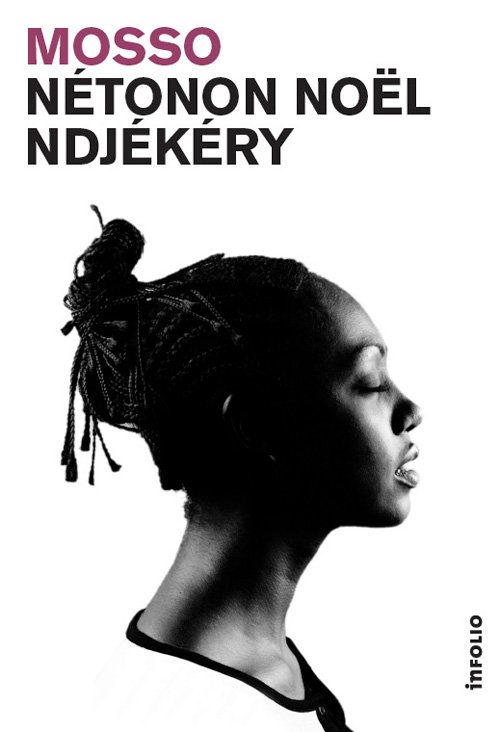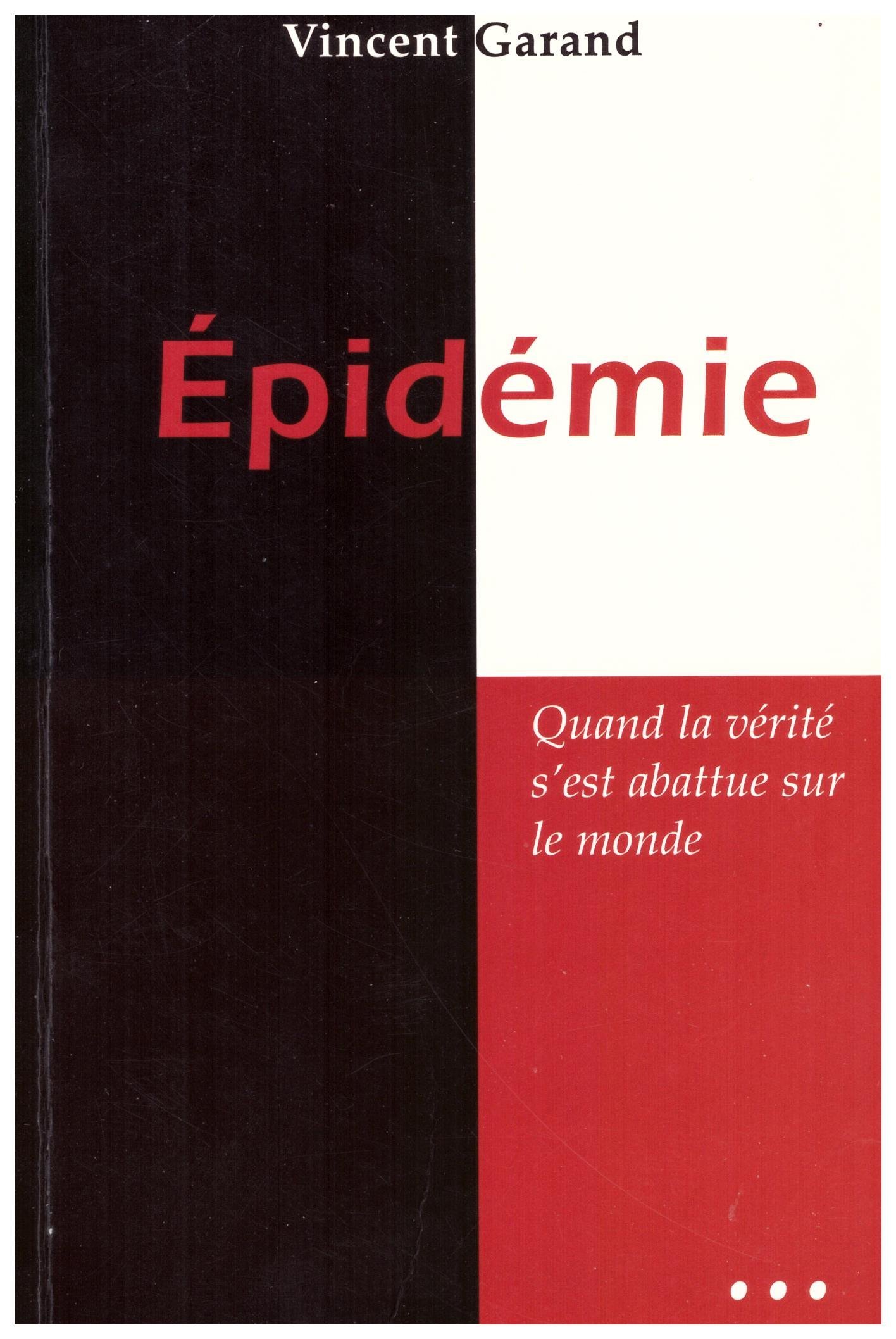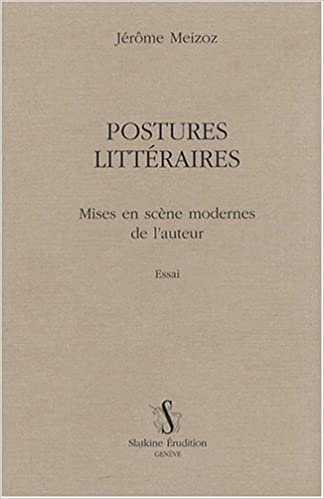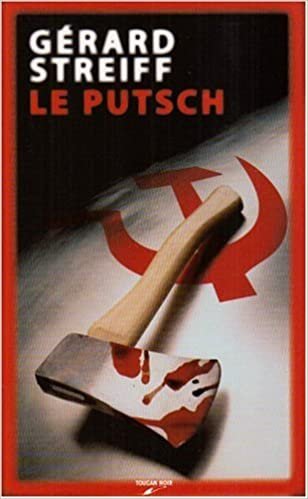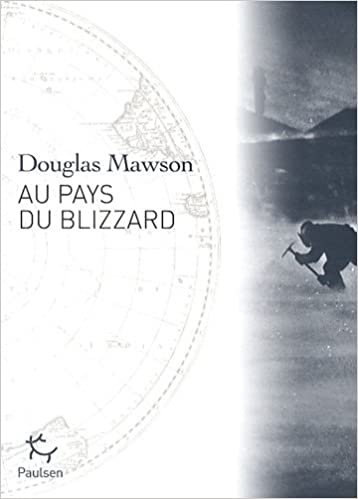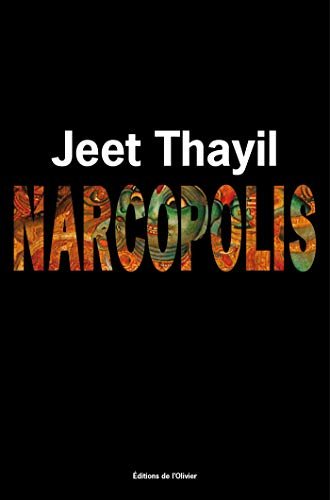
Jeet Thayil – Bombay, c'est un monde. L'écrivain Jeet Thayil y embarque son lecteur dans son premier roman, "Narcopolis", vision hallucinée de la grande ville vue à travers le prisme de la drogue en général et de l'opium en particulier. Une ville enveloppante qui vous embrasse, comme le suggèrent le premier et le dernier mot du roman, "Bombay" justement, là où tout commence et tout finit. Simple: Bombay est partout, jusqu'à l'étouffement.
Etouffement? Que le lecteur se plonge dans le prologue... il lit, il écoute le narrateur, et s'aperçoit que ce prologue n'est rien d'autre qu'une seule phrase, en apnée sur sept pages écrites petit. L'effet? Le lecteur se trouve pris à la gorge, les poumons surmobilisés et l'esprit qui pédale dans tous les sens, comme s'il venait d'absorber d'un coup une grosse bouffée d'opium. Et il a l'impression, déjà, que le romancier veut tout dire, toucher désespérément à l'absolu. Evoqué, l'opium apparaît comme une drogue totale qui va plus loin que le concept de paradis artificiel ("... l'opium était affaire d'étiquette...", p. 16). Quant au choix de dire Bombay, il est volontaire, et en quelques mots, tout est dit: "Bombay, qui a oblitéré son histoire en changeant de nom et en s'offrant un lifting architectural, est le héros ou l'héroïne..."
Retour aux racines donc. Héros ou héroïne? "Narcopolis" est le roman des troubles dans le genre, par excellence, en particulier autour du personnage clé de Fossette. Homme ou femme? Son histoire le montre comme un homme castré, allé malgré lui au bout du passage d'un sexe à l'autre. Et si Fossette, prostituée, change de sexe, elle change aussi de nom plus tard, pour devenir Zeenat, porteuse d'une burqa à laquelle elle trouve des propriétés susceptibles de séduire le chaland.
Si les frontières des genres sont floues, celles entre les religions sont plus ou moins marquées aussi, au gré d'une relecture affolée, par exemple lorsque Fossette prie un Christ qui, relecture faite, se serait bien accommodé du système de castes indien – ce qui résonne avec cet artiste junkie qu'on voit trébucher lors d'un vernissage aux allures qu'on pourrait dire blasphématoires. A cela vient s'ajouter l'islam, avec l'évocation du statut minoritaire et méprisé qu'il a en Inde – un thème d'actualité. Et aussi, de façon plus générale, le contact des cultures, entre choc, préjugés et fusion dans un vaste pays. Tout est poreux dans "Narcopolis", en un savant brassage haut en couleur.
On brasse même la notion de narrateur à la fois omniscient et parlant à la première personne, qui paraît s'effacer dans une grande partie du roman pour laisser d'autres personnages exprimer leur existence. Avec Lee, l'"Histoire de la pipe" va chercher ses racines en Chine maoïste, un pays dont l'auteur brocarde les travers en une satire jubilatoire. Mais c'est à Bombay que lui aussi arrive, une ville dont l'auteur excelle à décrire les bas-fonds grouillants, du côté de Shuklaji Street, entre prostituées en cage et lieux plus ou moins glauques où l'on savoure un opium apprêté avec plus ou moins d'art. Là, l'opium côtoie d'autres drogues, légales ou non, cocaïne comme alcool, en un mélange bien entendu halluciné.
Et ce qui est suggéré dans l'incipit se trouve confirmé dans le livre quatre, "Quelques usages de la réincarnation": Bombay semble avoir perdu une certaine âme, celle que l'auteur a décrite au cours des trois premiers livres, lorsque le narrateur y revient – et, astuce littéraire, le "je" revient dans la narration. Il reconnaîtra peut-être le nom de la ville, mais pas les bâtiments de Shuklaji Street. Quant au dernier vivant de ce roman, il paraît déjà presque mort, comme à la limite. Poreuse, la limite.
"Narcopolis" apparaît ainsi comme la description lente, vertigineuse et envoûtante, d'un monde empreint de misère flamboyante portée par l'opium, drogue dure qui commande, substance du rêve qui favorise le mélange de tout et de tous en vue de la recréation impitoyable d'un univers à nul autre pareil. Quitte à ce que ça pique les yeux parfois, c'est aussi le poème haut en couleur, dense et prenant, d'une ville, Bombay, où résonnent les chansons des films de Bollywood et qui participe aussi à ce grand mélange qui met au défi les limites les plus éprouvées.
Jeet Thayil, Narcopolis, Paris, L'Olivier, 2013. Traduction de l'anglais (Inde) par Bernard Turle.
Le site des éditions de l'Olivier.
Lu par Baz'art, Nathalie Vanhauwaert.