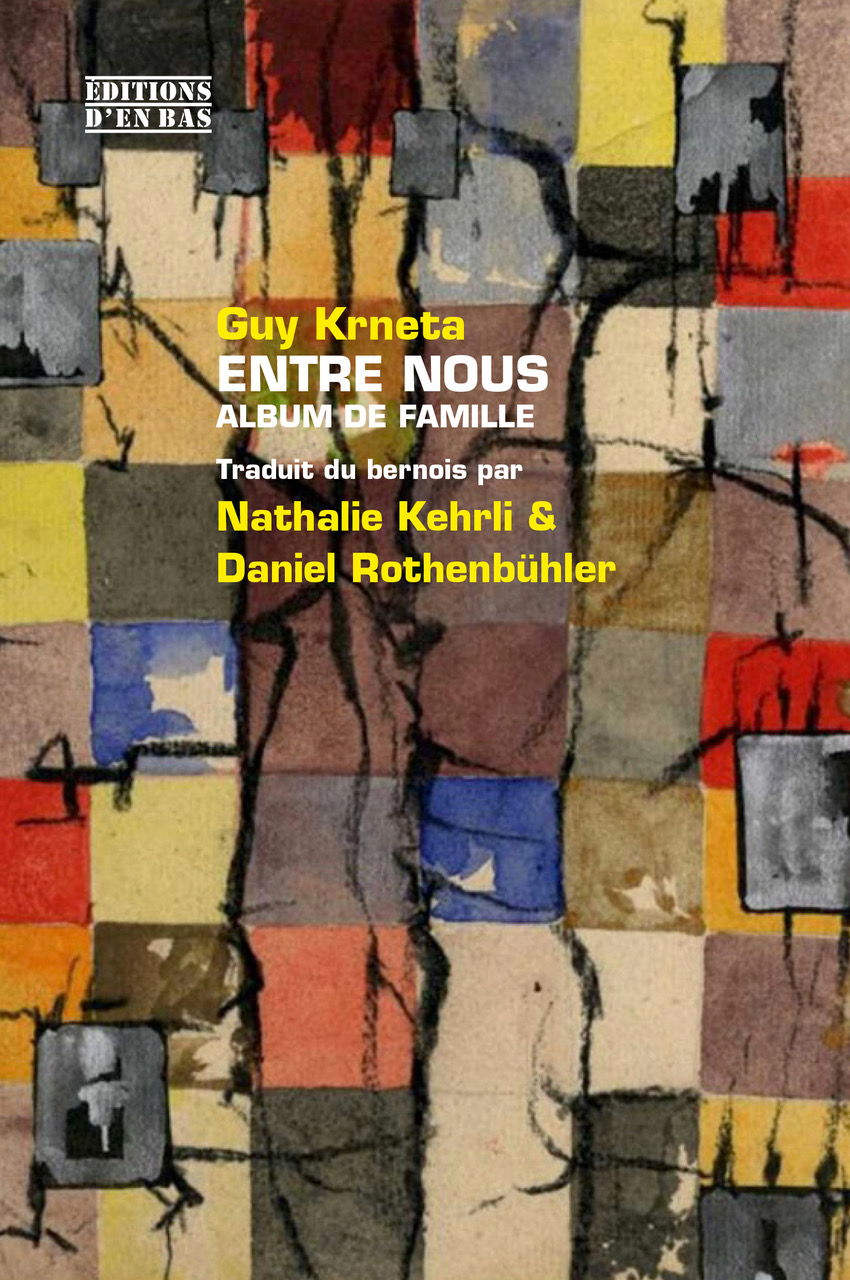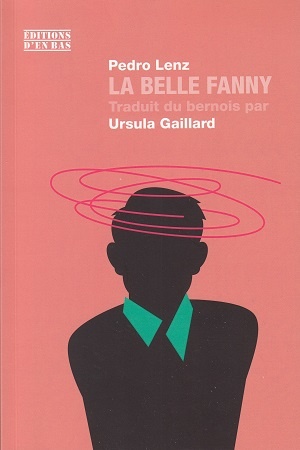Olivier Bocquet – Olivier Bocquet est actuellement connu comme scénariste de bandes dessinées, entre autres pour un album de "Spirou et Fantasio". Il y a quelques années, il a écrit un thriller à la française vraiment délicieux et drôle, intitulé "Turpitudes". L'ouvrage est porté par la question "Comment en est-on arrivés là?". Et ce "là" est précisé dans l'épilogue qui, de façon atypique, ouvre le roman en présentant la situation finale: des billets de banque qui jaillissent d'une grille d'égout, un prêtre qui liquide la messe de minuit en vingt minutes parce qu'il a la dysenterie comme tout le monde, une absente à la chorale. Précisons qu'on est en 2003 à Fontainebleau, ville a priori tranquille...
Voilà un roman solidement rythmé, au moyen d'artifices voyants mais judicieux, tels que le journal de Rachel Martin, 17 ans, pour lequel l'auteur fait usage d'une police de caractères spécifique, ou les articles de presse régulièrement cités, tous tirés de la "vraie" presse régionale. Cela crée un rituel au fil des pages. Quant au journal de Rachel, force est de relever qu'il recrée à merveille une voix de jeunette en rupture avec des parents singulièrement peu disponibles. Une jeunette qui prétend vouloir devenir tueuse à gages, il faut bien vivre!
Mais il n'y a pas que Rachel dans ce roman: il y a plein de personnages que rien ne devrait rapprocher... et qui vont se retrouver à se disputer la bagatelle de trois cent mille euros. Et tous ont quelque chose à cacher: à chacun ses turpitudes! On salive par exemple en observant l'affairisme effréné du sénateur-maire, Robert Martin, dont les différentes manières louches de se faire de l'argent menacent ruine avec le décès de son fidèle bras droit, Fisher. Il y a aussi Elias, le grand Noir hyper costaud qui pourrait remplacer ledit bras droit (et dépuceler Rachel, la diariste, qui est aussi la fille du sénateur-maire véreux et qui aimerait bien), mais ce n'est pas si simple... Et il y a François, l'archétype du loser, qui a récupéré l'argent mais – c'est trop bête! – l'a perdu.
L'auteur excelle à passer d'un personnage à l'autre pour faire avancer une histoire tout à fait hilarante. Les chapitres sont courts et rapides, riches en péripéties surprenantes, souvent relatées de façon très visuelle – à l'exemple des tentatives désespérées de François pour récupérer le pactole, en vain. Dans "Turpitudes", le romancier distingue par ailleurs nettement les voix de ses personnages, recréant en particulier un parler "banlieue" vigoureux pour Elias, ce qui crée un contraste, par exemple, dans ses conversations avec Rachel Martin qui, si elle se lâche à l'écrit, sait se tenir à l'oral.
Et "Turpitudes", derrière les voix révélatrices, ce sont aussi des caractères bien tranchés, et des personnages à la Carl Hiaasen, qui ont une certaine épaisseur (l'auteur n'hésite pas à leur inventer un passé, parfois rocambolesque à l'instar de celui de l'épouse de Robert Martin, ex-top modèle polonaise bien plus jeune que lui) et qu'on suit volontiers tout au long du livre, même s'ils ont tous des zones d'ombre qui ont tendance à déborder. L'exploration de ces zones d'ombre donne naissance à un thriller totalement loufoque.
Olivier Bocquet, Turpitudes, Paris, Pocket, 2010.
Le site des éditions Pocket, le blog d'Olivier Bocquet.
Lu par Esperluette, La Grande Stef, Melmelie, Pickwick, Skritt, Val.