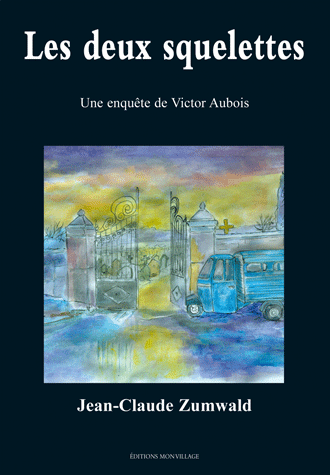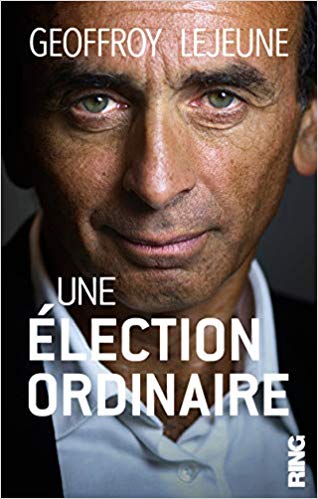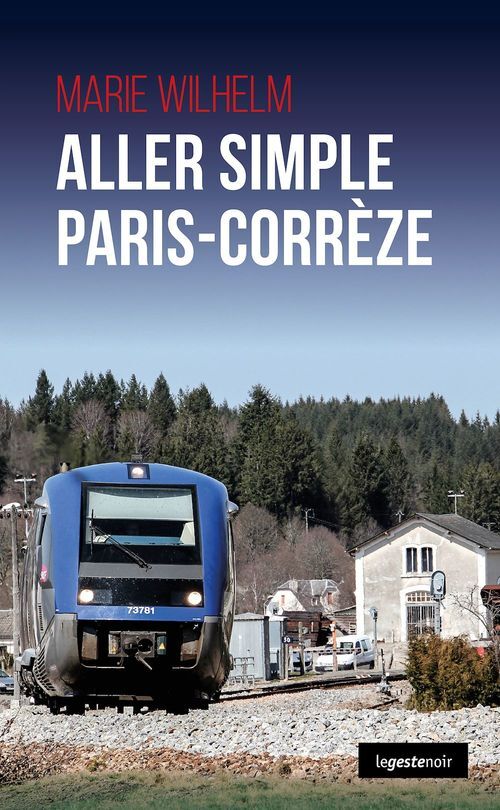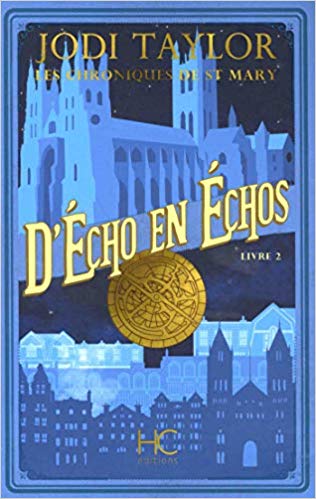
Jodi Taylor – Madeleine Maxwell est de retour! Et à peine est-elle de retour qu'elle est déjà repartie. Le tome 2 des "Chroniques de St Mary", écrit par l'imaginative romancière anglaise Jodi Taylor, invente à nouveau une série de voyages dans le temps, mettant en scène l'équipe d'historiens casse-cou de l'institut St Mary. Un institut où Madeleine Maxwell, dite Max, a pris du galon, les circonstances aidant.
"D'écho en échos", tel est le titre de ce deuxième opus de la série. Le lecteur est familier de l'univers de la romancière, l'effet de surprise ne joue plus guère, il s'agit de se renouveler. Ce n'est pas tout à fait gagné, malgré quelques scènes de bravoure, qui ne font pas oublier les moments un peu longuets où Madeleine Maxwell règle (certains de) ses problèmes personnels. Reste que l'astuce des échos, ces échos cités dans le titre, n'est pas innocente: le motif apparaît une fois sous la forme d'une mauvaise blague (quand on fait un frottis à Max, il y a de l'écho), et une seconde sous une forme presque philosophique, suggérant que l'histoire est une symphonie d'échos – ce que le titre anglais d'origine ("A Symphonie Of Echoes") dit autrement, ou mieux, que la version française. Une symphonie en neuf mouvements: amis lecteurs, vous êtes prévenus!
Un institut à l'ancienne, jusqu'au management
Du galon, ai-je écrit plus haut? Les mots ont un sens. On conçoit bien que l'univers de St Mary, institut historique qui travaille sur les voyages dans le temps pour vérifier sur pièces ce que les documents affirment, se trouve au croisement du passé et de l'avenir. Ce croisement se retrouve dans la description de cet institut aux bâtiments vétustes et au personnel foutraque, auquel on confie cependant le matériel le plus moderne et le plus pointu pour errer dans les couloirs du temps.
Le lecteur peut être surpris par le côté traditionnel, militaire de l'organisation hiérarchique de l'institut: si elle se fissure dans les bords, notamment lorsque l'urgence l'exige, la dynamique hiérarchique est généralement top-down, sans que les exécutants n'aient grand-chose à dire, même s'ils sont généralement plus compétents que leur propre hiérarchie, dont le métier est d'organiser le travail (pas très bien en l'espèce, ce qui est source de gags). On peut être surpris, en particulier, par la manière dont Madeleine Maxwell, dite Max, se voit imposer ses assistants, en particulier Rosie Lee – a fortiori par une assistante de direction à temps partiel, Mme Partridge, certes précieuse, mais dont les responsabilités ne sauraient aller aussi loin dans un monde normal.
Mais bon: Rosie Lee ne déploie guère ses talents dans "D'écho en échos". Et après tout, les lecteurs des "Chroniques de St Mary" s'accorderont à dire que l'univers de ce cycle romanesque n'est pas normal, n'est-ce pas?
L'Angleterre et l'Ecosse d'abord
Jack l'Eventreur, Thomas Becket, Marie Stuart, l'île Maurice: à l'exception notable d'un détour du côté de Ninive et des jardins suspendus de Babylone, l'auteure explore dans "D'écho en échos" des éléments clés indissociables de l'histoire anglaise. Normal: l'histoire anglaise est riche, et la revisiter avec humour apparaît comme un délice aux ressources infinies. Cela dit, certains de ces éléments sont certes fascinants même pour des gens peu anglophiles, à l'instar de Jack l'Eventreur, rapidement liquidé en début de roman; mais d'autres, par exemple l'épisode de Thomas Becket, leur paraîtront moins proches.
Face à ces moments graves de l'histoire anglaise, les péripéties survenues sur l'île Maurice apparaissent comme cocasses. L'enjeu consiste en effet à capturer des dodos, ou drontes, volatiles aujourd'hui disparus – si ce n'est, ailleurs que chez Jodi Taylor, dans les romans de Jasper Fforde (où ils font plock-plock). L'histoire fait dès lors figure de science alliée à l'écologie. Qu'advient-il des dodos capturés? Quelques rires pour le lecteur de "D'écho en échos", et peut-être quelque chose de sérieux dans un tome ultérieur de la série: une fois ramenés à St Mary, assez au début du livre, ces oiseaux un peu bébêtes, observés d'un œil moqueur au moment de leur capture, se font parfaitement oublier jusqu'à la fin.
Si british que soit l'intrigue, cela dit, celle-ci est menée de manière assez consciencieuse, même si le contexte est pour le moins brindezingue. Les éventuels anachronismes sont le plus souvent justifiés, y compris par l'humour; on mettra même sur le compte de l'humour la diatribe finale contre la consommation de bière au temps de Marie Stuart: si trouble qu'elle ait été, elle était toujours plus saine que l'eau pure en ces temps reculés. Généralement, l'auteure a le souci de parer son propos d'un vernis solide de réalisme, par exemple lorsqu'il est question de décrire les vêtements que portent les historiens en goguette au temps de Marie Stuart... et les contraintes de leur port.
Sentiments en pagaille
J'ai évoqué la question des problèmes personnels de Max en introduction... il est vrai que l'auteure consacre pas mal de temps à décrire les relations houleuses, pétries de malentendus, entre Max et le personnage de Leon Farrell, directeur technique. C'est de l'émotion, oui, ça change des voyages dans le temps, OK, mais cela paraît long. Il y a plus de force dans les pages relatant les derniers instants de David, l'assistant handicapé de Max, même pas fichu de raconter une blague "Toc, toc, qui est là" dans tout le livre, alors qu'il est présenté comme un spécialiste du genre. Les amateurs en seront pour leurs frais...
Les expressions de l'amour sont cependant parfois moins drôles dans "D'écho en échos", par exemple lorsque Max abandonne Marie Stuart aux mains d'un prédateur sexuel qui doit devenir son mari... Affaire à suivre? Voguant entre réalité et fiction, la romancière sème dans le deuxième roman de sa saga quelques petits cailloux qui devraient resservir dans de prochains volumes. C'est une force, dans la mesure où le lecteur désireux de savoir va vouloir se procurer la suite. Et aussi une faiblesse, puisque "D'écho en échos" apparaît un brin orphelin s'il est lu isolément.
Et d'ailleurs, quelle est la suite? Après un ultime suspens, la dernière phrase du roman annonce la couleur: "Mesdames et messieurs, nous allons à Troie!".
Jodi Taylor, D'écho en échos, Paris, HC Editions, 2018. Traduction de Cindy Colin Kapen.
Le site des éditions Hervé Chopin, le site de Jodi Taylor, celui des "Chroniques de St Mary" (livres à gagner!).
Lu par Aelinel, Bianca, Biblio, Chacha, Cyan, Erika, Mélie Grey, Nanou, Rosalie, Sapere Aude, Stéphane Larue.
Mon billet sur le tome 1 de la série: Jodi Taylor, Un monde après l'autre.