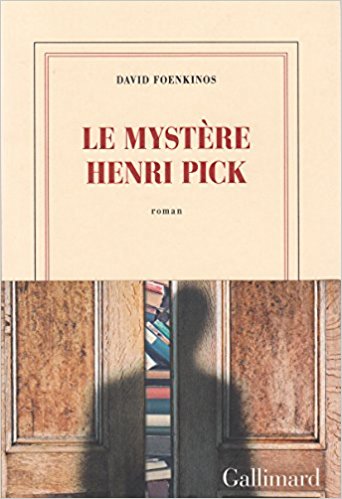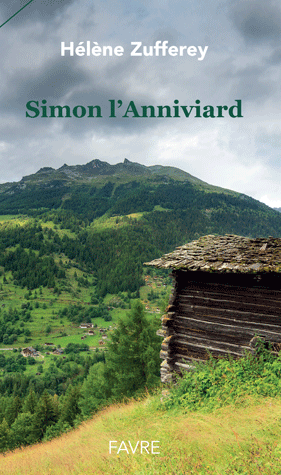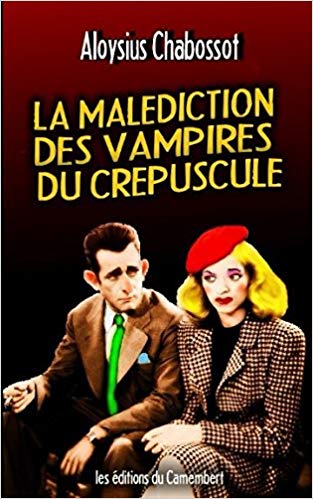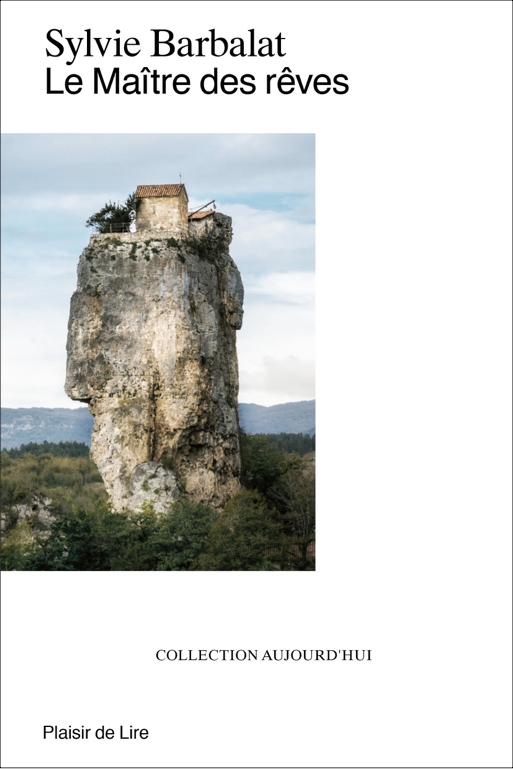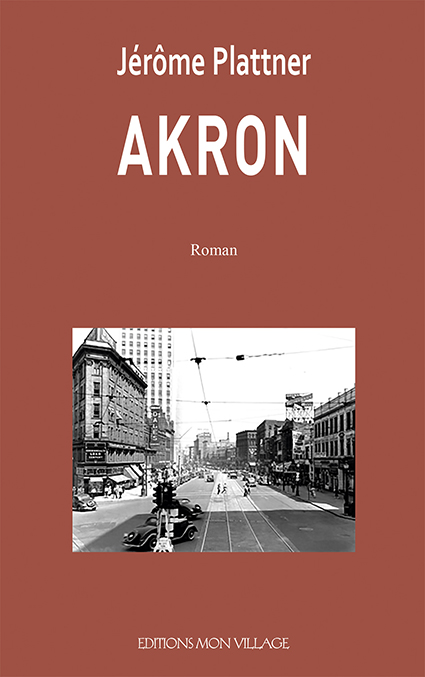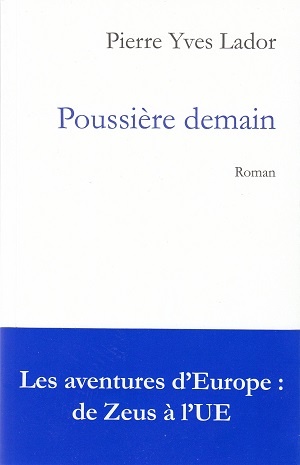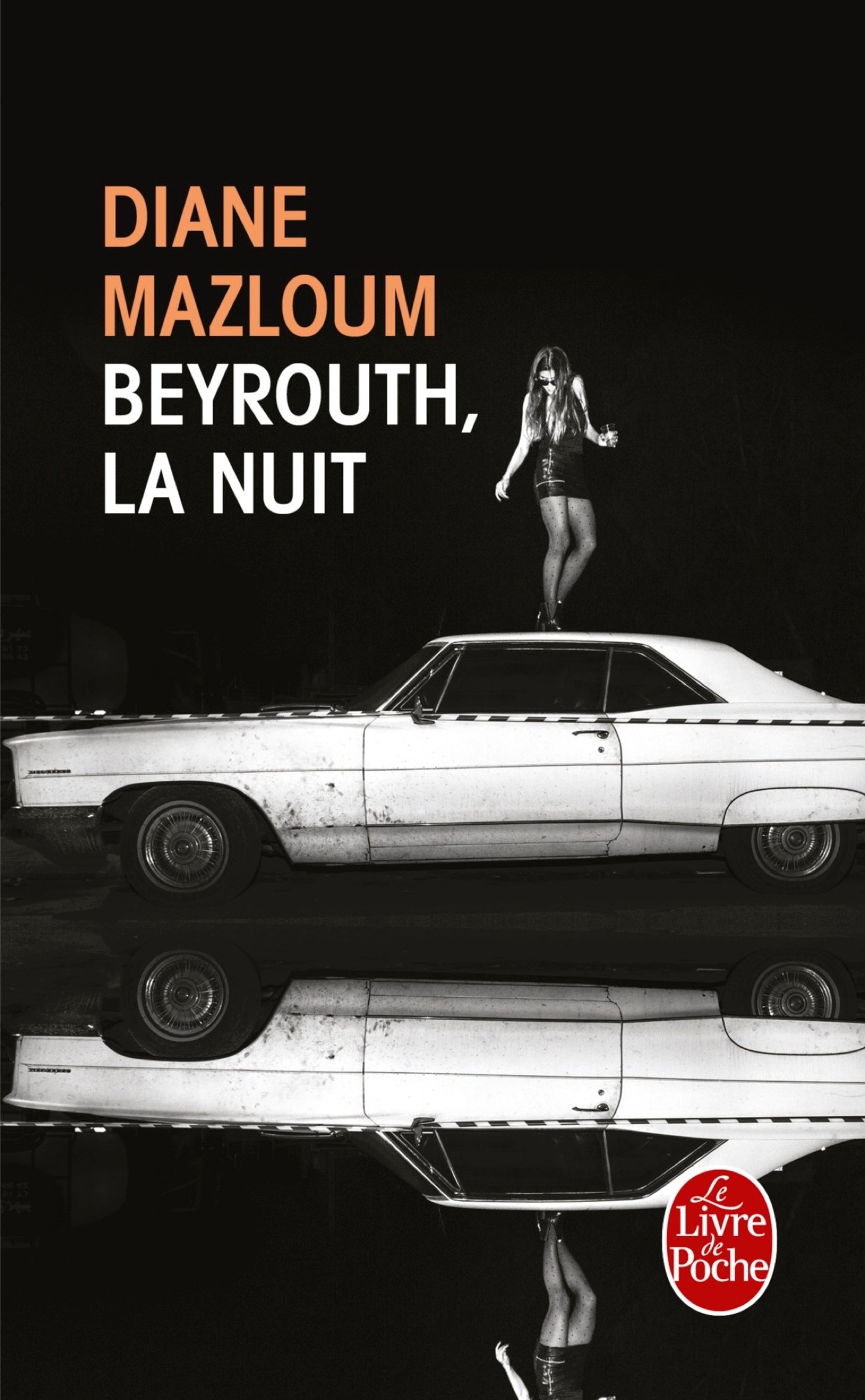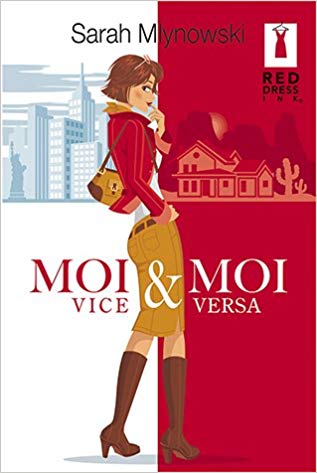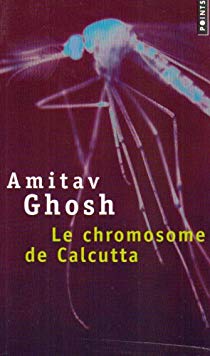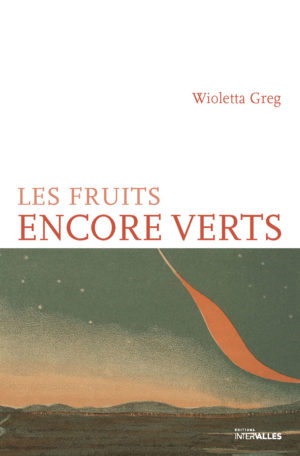
Wioletta Greg – "Je suis ces fruits encore verts", lit-on en fin de "Les fruits encore verts", texte qui donne son titre à un livre de Wioletta Greg, publié dernièrement aux éditions Intervalles dans une traduction soignée signée Nathalie Le Marchand. Nouvelle, chronique, anecdote? Intégré à un livre qui évoque la vie en Pologne dans les années 1980, ce texte s'avère important dans ce livre.
Important, parce qu'il met la lumière sur l'importance des liens intergénérationnels mis en scène. Voyons: la narratrice est une préadolescente qui vit sa seconde décennie d'existence, connaît ses premières règles, subit nolens volens les regards, les mots et les gestes des garçons – sans compter les agressions sexuelles, mine de rien: regard humain, celui de la narratrice est aussi, précisément, celui d'une femme en devenir. Autour d'elle, il y a la famille, qui a ses propres préoccupations mais joue parfois à être plus jeune qu'elle ne l'est, et même des aïeux: on se marie, on meurt, on discute, on ne se comprend pas toujours – surtout du point de vue de la narratrice. Et on vit un peu les uns sur les autres, la jeunesse se mêlant au grand âge et vice versa.
Ce mélange peut s'installer chez un seul personnage: le lecteur situe la narratrice entre deux âges, soit l'enfance et l'adolescence. Son regard sur la vie reste concret, encore un brin naïf, donnant à l'histoire une impression de générosité savoureuse, sans arrière-pensées. Qu'on ne s'y trompe pas, cependant: le ton de la narration, loin de contrefaire artificiellement le langage enfantin, apparaît comme adulte, donnant au lecteur l'impression que la narratrice est plutôt mûre pour son âge. Le fait qu'elle porte le même prénom que l'auteure suggère que cette dernière a mis quelque chose de son propre vécu dans les courts chapitres des "Fruits encore verts".
De courts chapitres, oui! Ils sont construits comme des nouvelles, ou des anecdotes témoignant d'épisodes de la vie villageoise, pour ne pas dire rurale, quelque part dans le Jura polonais. La description de cette vie s'avère à la fois simple et foisonnante, simple du fait de l'écriture directe adoptée, et foisonnante du fait du souci du détail, voire de l'effet de réel. Les dialogues, transcrivant l'accent fleuri de certains locuteurs, concourent encore à ce réalisme. Et d'un chapitre à l'autre, des constantes assurent une cohérence qui suggère qu'on est toujours dans le même monde: des objets comme le baromètre en forme de chalet, les gens qui entourent la narratrice. Le lecteur sourira même en voyant cette narratrice, qu'on découvre philuméniste éclairée, se mettre martel en tête et prendre des risques pour compléter sa collection d'étiquettes de boîtes d'allumettes.
Le lecteur voit ce petit monde évoluer et dessiner une mentalité gorgée des préceptes plus ou moins bien assimilés de la religion catholique: certains personnages y croient, ajoutant à leur foi des superstitions venues d'ailleurs. Cette mentalité est en phase avec un univers où, même si la Pologne est satellisée par un univers communiste qu'on croirait farouchement athée, le catholicisme marque la vie quotidienne. D'autant plus que Jean Paul II est pape en ce temps-là...
Justement: le lecteur le manque de peu, et le fait qu'il échappe aux personnages des "Fruits encore verts" suggère que le bruit du monde n'est pas l'essentiel ici. Les Jaruzelski et consorts, certes évoqués, paraissent bien lointains, plus en tout cas que les animaux que le père de la narratrice empaille – un père qui a certes fait de la prison. Loin de cet arrière-plan et des grandes théories, "Les fruits encore verts" montre des gens vivants, décrits par un langage qui fait toute sa place au concret, dans ce qu'il a de sombre, de lumineux ou même de cocasse.
Wioletta Greg, Les fruits encore verts, Paris, Intervalles, 2018. Traduction du polonais par Nathalie Le Marchand.