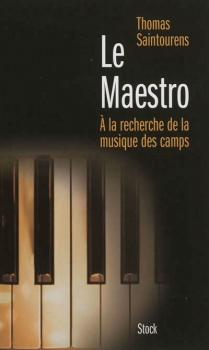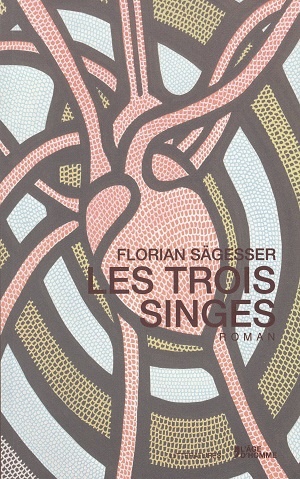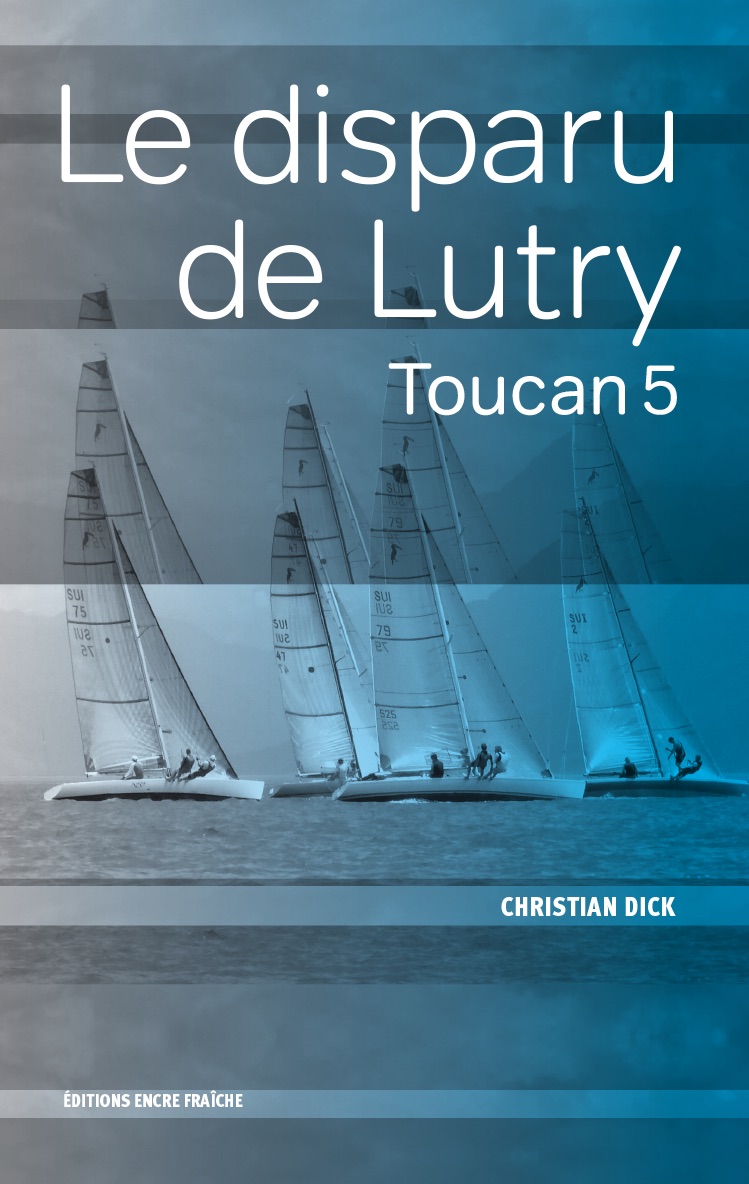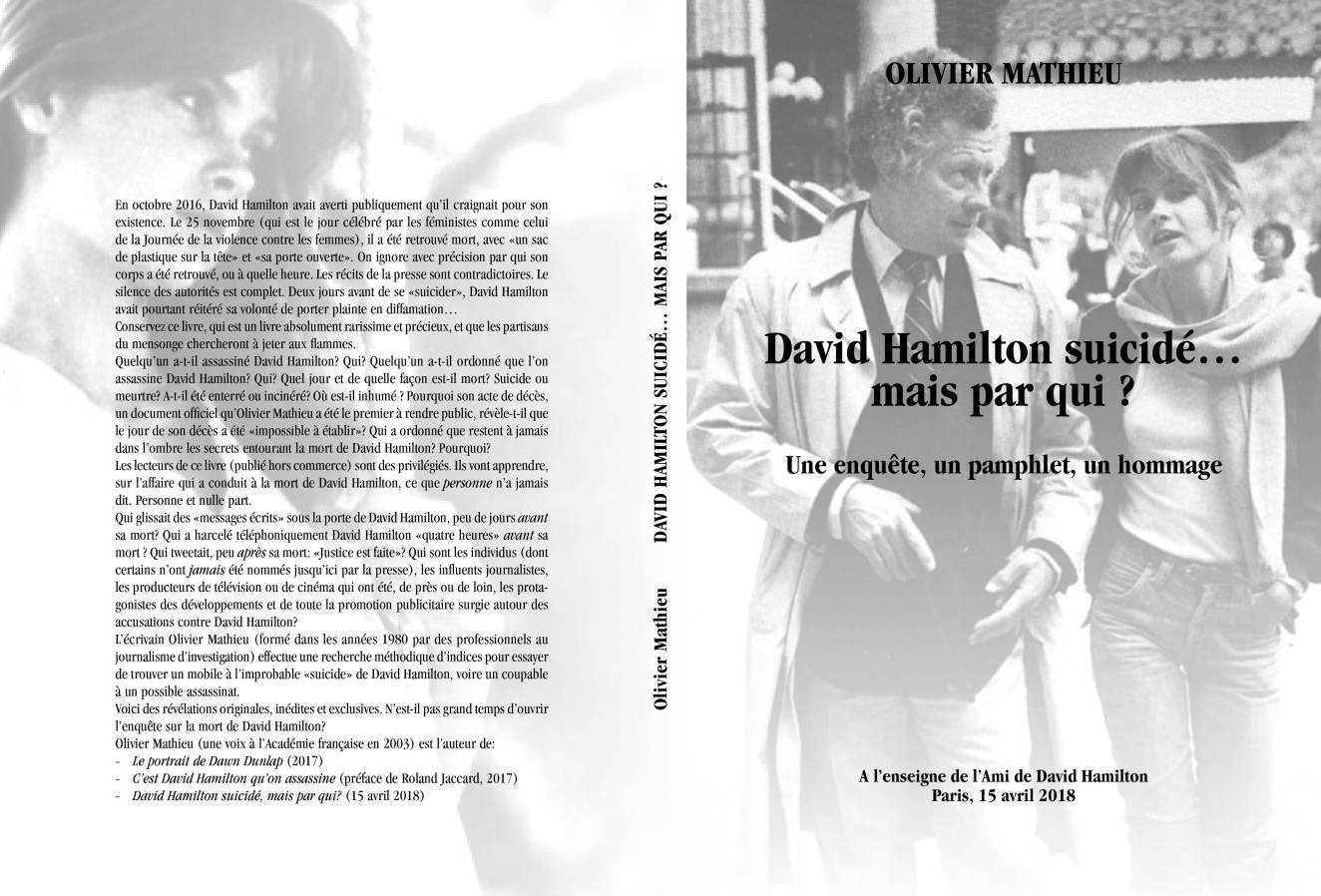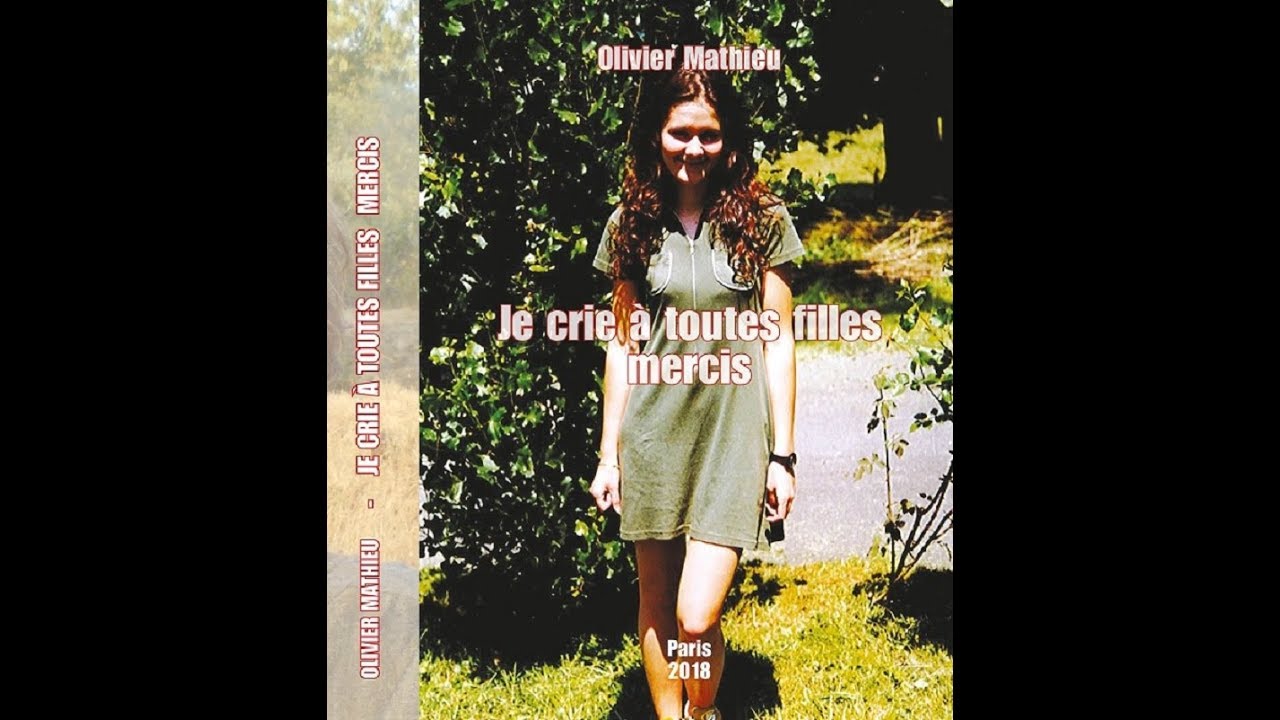Emmanuel Schmutz – Né en 1951, Emmanuel Schmutz, ancien adjoint du directeur de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU), est parti pour un monde meilleur le 3 novembre dernier. Il laisse le meilleur souvenir à tous les usagers de la BCU. Personnage indissociable de cette institution d'envergure cantonale, l'homme a cependant eu plus d'une corde à son arc! C'est ce que démontre "Jamais contents!", un dernier petit livre qui évoque avec esprit les années qu'il a passé à exercer les fonctions de médiateur de la Radio-télévision suisse romande (RTS).
Ces souvenirs, ce sont autant d'anecdotes arrachées à la poubelle: l'auteur ne cache pas qu'au moment de trier de vieilles archives reléguées à la cave, il s'est dit que ceci ou cela mériterait d'être sauvé. Ce "ceci ou cela", à savoir les moments forts de l'activité de médiateur de l'auteur, constitue la teneur de "Jamais contents!". Un titre qui annonce la couleur, avec une éclatante franchise: bonté divine, les téléspectateurs seraient-ils un peuple de râleurs?
C'est là, justement, que le médiateur, destinataire de messages courroucés à plus ou moins bon droit, intervient. Comment leur répondre? L'auteur invite son lectorat à visiter la salle des machines: en se plongeant dans le petit livre jaune d'Emmanuel Schmutz, le lecteur découvre quelques ficelles du travail de médiation, un travail d'arrondisseur d'angles, sans cesse réinventé en fonction des situations et des interlocuteurs. Du point de vue légal le plus carré qui soit, bien sûr, il y a les cas où la réaction est trop tardive: circulez! Mais dès lors qu'il faut entrer en matière, les cas sont divers: un reportage maladroit, une sortie sensible dans l'émission phare "La Ligne de cœur", les quérulents qui exigent un passage à l'antenne pour faire passer leur message, ou un mot de travers lorsqu'il est question des relations entre Israël et la Palestine.
Les anecdotes et les questions de fond alternent dans "Jamais contents!", un titre qui est comme un cri du cœur que l'auteur a sans doute dû pousser à plus d'une reprise en faisant son travail. Cet ouvrage peut s'avérer utile à toute personne désireuse de reprendre le flambeau de la médiation. Son rythme est rapide: au nombre d'une trentaine sur une grosse centaine de pages bien aérées, les chapitres sont brefs. Ils paraissent même parfois trop ramassés, évoquant de manière trop allusive une actualité qu'on a un peu oubliée. C'est que l'on parle de médiations qui ont eu lieu entre 2001 et 2011, évoquant des sujets parfois ensevelis bien profondément dans la mémoire du lecteur.
Mais l'humour rattrape cela, et l'auteur se révèle un excellent bateleur de mots. Dès que l'occasion s'en présente, il se fait plaisir en labourant les champs lexicaux des thèmes abordés, de façon journalistique à la puissance mille: le domaine du lait s'avère un délice, de même que le tabac... dès lors qu'il est question du tournoi de tennis "Davidoff" de Bâle, devenu les "Swiss Indoors" sous la pression des milieux anti-fumée. Et en particulier, les titres de chapitres s'avèrent ludiques et ne reculent devant aucun jeu de mots.
Au soir de sa vie, l'ancien médiateur jette un regard amusé, empreint d'une juste distance, sur les cas les plus remarquables qu'il a eus à traiter. Il n'oublie pas même l'auditeur ou le spectateur: soucieux d'empathie, il sait se mettre à leur place dans tous les cas. L'apprenti médiateur ne trouvera certes aucune solution miracle, toute faite, dans ce livre, et pour cause: chaque cas est unique. Mais il est invité à y découvrir des situations plus ou moins précisément dessinées qui lui offrent l'occasion de gamberger avec le sourire sur la fonction à laquelle il aspire, quitte à se replonger dans un contexte parfois poussiéreux. Mais la poussière elle-même rappelle les tensions humaines, que le médiateur se charge d'apaiser avec toutes ses non moins humaines qualités.
Emmanuel Schmutz, Jamais contents!, Fribourg, Faim de siècle, 2018. Illustrations (amusantes) de François Maret.
Le site des éditions Faim de siècle.