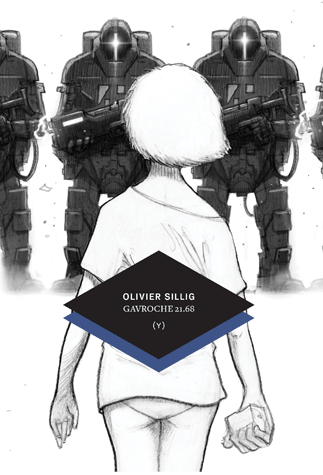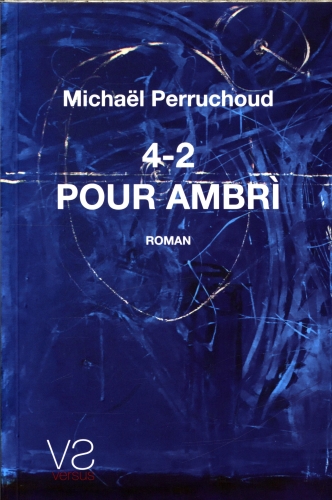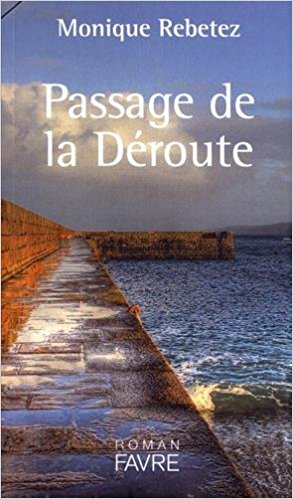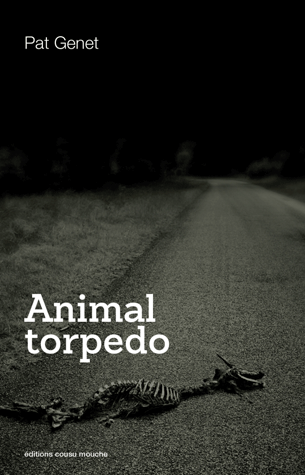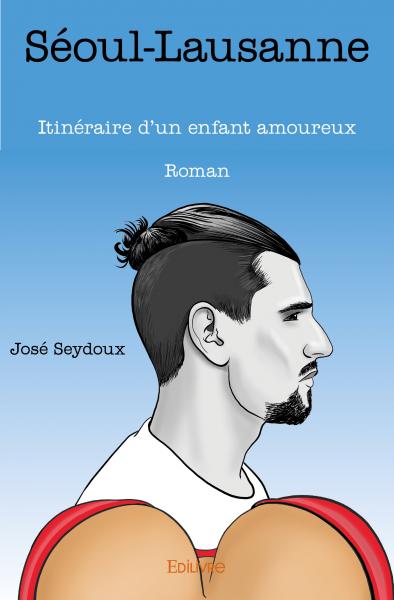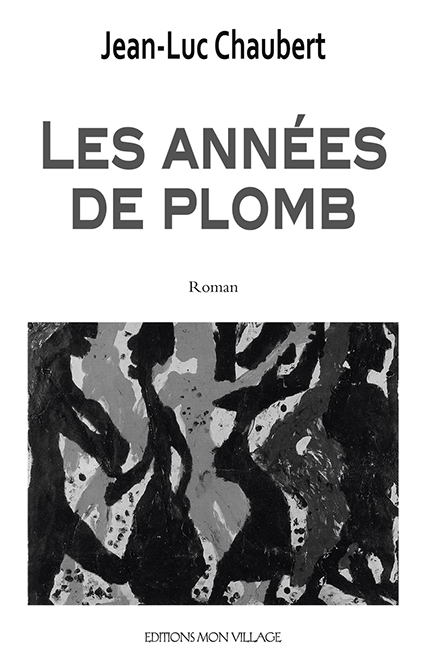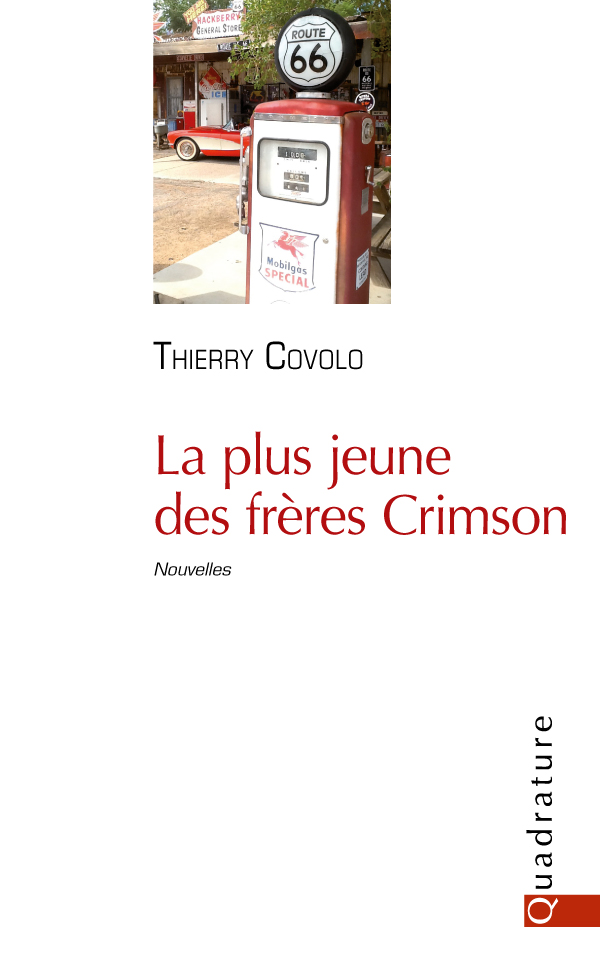Pierre Yves Lador – Il m'est déjà arrivé de noter, ici ou ailleurs, qu'en matière de littérature, Pierre Yves Lador est un ogre. Ogre littéraire, tant son œuvre est prolifique et forte. Et ogre mangeur aussi: il est question des choses de l'estomac dans ses livres "Confession d'un repenti", ainsi que dans "La Guerre des légumes". Et voilà qu'on le retrouve, à la fois vorace et conscient, dans ses "Variations vegan", parues dernièrement aux éditions Hélice Hélas. En guise de préambule, j'ose un spoiler: amené par les circonstances de la vie à s'y intéresser, l'écrivain vaudois est finalement contre le véganisme.
"Variations vegan" est une promenade littéraire qui déconstruit l'argumentation développée par le mouvement vegan pour se justifier. Oui, le cri de la carotte est bien là; mais la réflexion de l'auteur va au-delà de ce cliché, suggérant que le monde végétal a aussi son intelligence, sa sensibilité. Tout part, du coup, d'un postulat de départ, qui est que du haut de ses bonnes intentions antispécistes, le véganisme n'est rien d'autre qu'un spécisme: pourquoi faudrait-il exclure telle catégorie du vivant de l'alimentation humaine, alors que l'humain est réputé omnivore? Pour l'auteur, le végane décide de façon finalement aléatoire que tel ensemble d'espèces vivantes peut être tué à des fins de consommation, et tel autre ne le peut pas.
L'auteur pose donc que le prix de la vie des uns est la mort des autres, dans une approche définie comme holistique: poussant au bout la réflexion végane, il considère que seule l'inédie, option consistant à vivre sans manger (mais la science n'a pas encore démontré que c'était possible, malgré quelques cas cités notamment par la religion – on pense à Marthe Robin, qui n'a jamais voulu que les docteurs s'intéressent à elle), respecte le vivant dans son ensemble. De façon plus ou moins appuyée, il rappelle le côté aléatoire du choix de ne pas consommer/exploiter telle forme d'être vivant: ce n'est pas parce qu'une vache a plus manifestement une âme qu'un plant de soja ou une amibe que sa vie vaut davantage. La base essentiellement émotionnelle de l'argumentation végane est ainsi mise au jour, sans ménagements.
L'approche résolument littéraire des "Variations vegan" offre à l'auteur la possibilité de jouer l'outrance et la mauvaise foi pour faire avancer son propos. On pourrait le lui reprocher, mais ce serait un peu vain: en poussant les idées jusqu'à leurs extrêmes, en alignant les phrases copieuses, l'auteur ne fait rien d'autre que lancer un débat contradictoire autour du véganisme, perçu à plus d'un égard comme une religion – dans le pire sens du terme: une religion qui n'élève pas, mais asservit. Le lecteur relèvera aussi, du reste, que pour l'auteur, le végan est souvent une végane: il use volontiers du genre féminin pour désigner les adeptes de ce mode de consommation, et a ses arguments pour ce faire. Et ils n'ont pas grand-chose à voir avec l'écriture inclusive...
Plus globalement, l'auteur profite de ce pamphlet pour développer quelques thèses qui pourfendent le politiquement correct et rappellent l'envie de décroissance – à laquelle, soit dit en passant, le véganisme, avide d'avocats, de soja et de produits de substitution opaques, repu de livres de recettes publiés par des éditeurs intéressés, véhiculé par des médias qui peinent parfois à prendre du recul, ne contribue pas. Les classiques de l'argumentation sont alors convoqués, par exemple les kilomètres parcourus par les denrées, ou le fait qu'un produit chimique délétère peut être parfaitement végan. Ce pan de l'argumentation va jusqu'à critiquer les droits de l'homme érigés en religion intangible, et à poser la question de l'égalité entre les humains eux-mêmes. Jusqu'où l'auteur, pamphlétaire énergique, croit-il à ses réflexions? Celui-ci assume sa part de mauvaise foi; gageons que "Variations vegan" est surtout conçu comme un exercice consistant à pousser une réflexion à son terme extrême, afin d'inviter à son tour le lecteur à réfléchir.
Reste que si cette recherche des extrêmes est une des lignes directrices de "Variations vegan", ce livre propose aussi une approche du juste milieu, "modeste" comme on dit dans le canton de Vaud cher à l'écrivain. L'auteur défend en effet le mouvement bio, dont il apprécie le caractère holiste, réellement respectueux de tout le vivant sans distinction: il tend même à y inclure le règne minéral. Plus largement, sa devise est "BBL": brut, bio, local. Si le produit brut n'est pas facile à trouver ou à consommer (sauf à devenir un apôtre du cru à la façon de Guy-Claude Burger – cité au passage), on ne peut qu'être séduit par la notion de proximité de l'aspect local: "Que ce soit un porreau ou un tournedos, je veux savoir son nom, d'où il vient, qui l'a élevé, comment.", exige l'auteur, désireux d'être autant que possible conscient de ce qu'il mange.
Charnu, riche en phrases longues, "Variations vegan" a les accents d'un pamphlet littéraire: c'est l'un de ces ouvrages qui, par-delà l'ironie, invite un chacun, végane ou non, à réfléchir et à prendre du recul. Considérant que le véganisme est un extrémisme religieux et une impasse philosophique, refusant en même temps l'industrialisation cruelle et sans âme de l'agro-alimentaire, l'auteur s'interroge: quelle est la meilleure voie pour nourrir l'humanité... et les vers pas du tout véganes qui se repaîtront de nos cadavres? Portée par des phrases longues et nourrissantes, celles finalement d'un écrivain libre de tout dogme et de toute idéologie, la réflexion s'avère féconde.
Pierre Yves Lador, Variations vegan, Vevey, Hélice Hélas, 2018. Préface de Stéphane Bovon.
Le site des éditions Hélice Hélas, le site de Pierre Yves Lador.