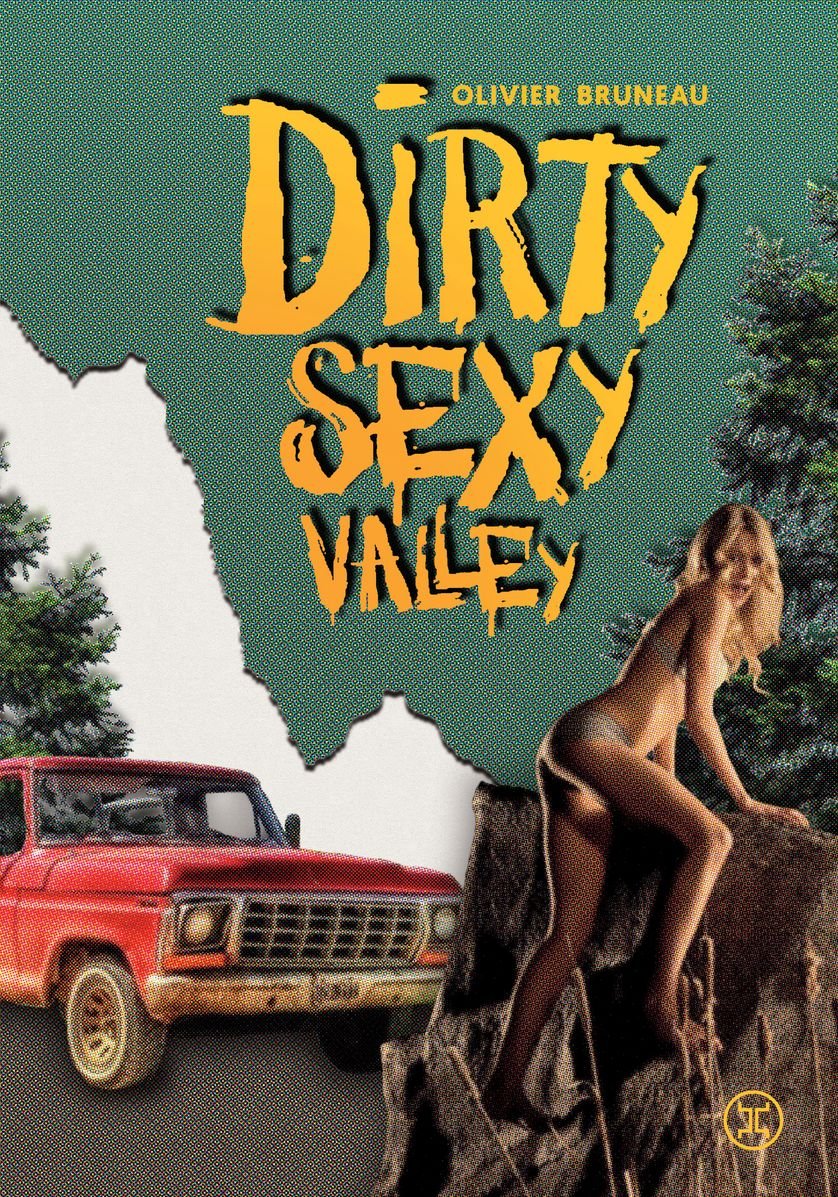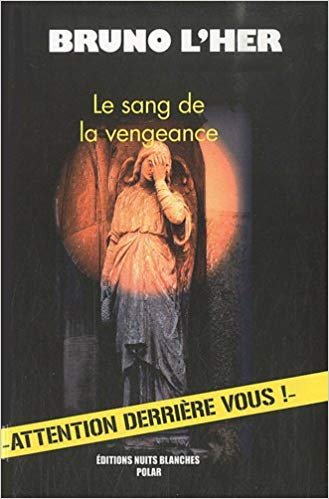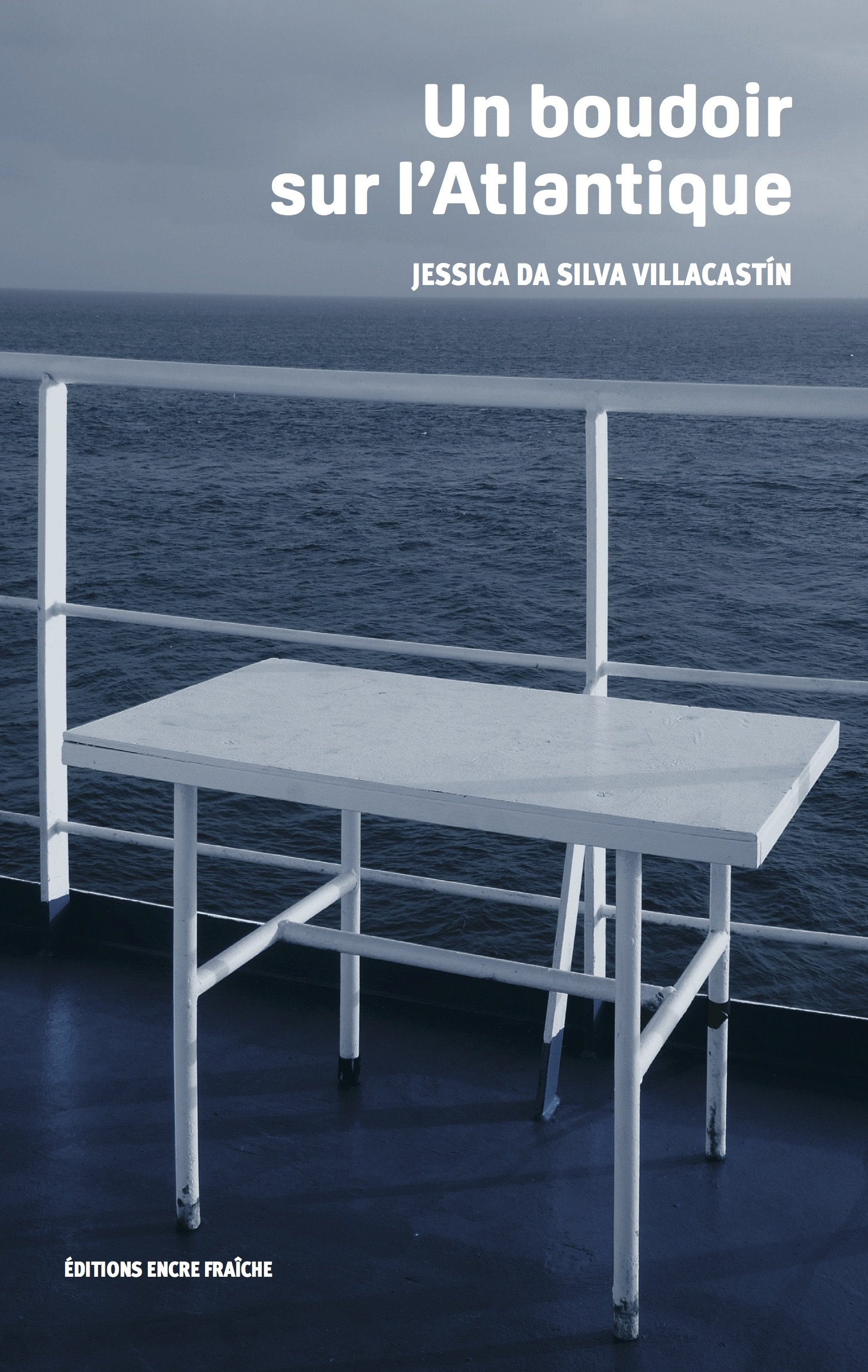Rebecca Gablé – L'écrivaine allemande Rebecca Gablé a imaginé la grande famille des Waringham, éleveurs de chevaux anglais actifs au cœur du Moyen Age. C'est pour ainsi dire un clan, peu à peu indissociable des jeux de pouvoir qui agitent l'Angleterre au temps des rois. Après un tome deux tournant autour de la guerre de Cent ans ("Les gardiens de la rose"), voilà que la saga des Waringham s'intéresse à la Guerre des Deux-Roses, qui oppose les York et les Lancastre: ça s'appelle "Le jeu des rois".
Évoquant une guerre civile touchant essentiellement l'Angleterre et le Pays de Galles, ce roman ne sera sans doute pas aussi flatteur que "Les gardiens de la rose", puisqu'il évoque des péripéties historiques moins connues du tout grand public. En particulier, il n'y a pas Jeanne d'Arc; cela dit, Marguerite d'Anjou, épouse d'Henri VI d'Angleterre, est bien présente.
On relève la minutie de la romancière, qui, fidèle à l'histoire, décrit les batailles clés de l'événement, mais aussi des intrigues en coulisse qui mêlent rivalités familiales, doutes au sujet des filiations et quêtes de pouvoir. Les morts pleuvent en ces temps peu tendres, et les scènes de duel et de batailles parsèment "Le jeu des rois". Ces défunts sont des personnages bien construits, en phase avec ce que l'histoire a pu retenir d'eux. En résonance, il y a les naissances, régulièrement empreintes de l'ombre du doute quant à leur légitimité.
"Le jeu des rois" est aussi traversé par une description soignée de la condition féminine à la fin du Moyen Age en Angleterre. Une condition pas évidente à vivre, certes acceptée nolens volens parce qu'on y trouve son compte, où les mariages doivent moins à l'amour qu'à la raison politique du moment – quitte à ce que l'estime réciproque vienne avec le temps. On ne compte plus les femmes violentées au fil des 757 pages du livre; elles font écho aux hommes trucidés peu à peu et contribuent à dresser le portrait d'une époque terrible, y compris pour une noblesse tenue et contrainte par ses prérogatives. A l'heure actuelle, où les violences à l'encontre des femmes sont d'actualité, cela résonne fort! Mais qu'on ne s'y trompe pas: l'écrivaine décrit dans "Le jeu des rois" des femmes à poigne, pleines de caractère, pas du tout confites dans leur statut de victime, capables par exemple de trancher la main d'un mari violent comme de tenir un ménage si les servantes, comme l'argent, viennent à manquer.
"Le jeu des rois" se tourne aussi vers l'avenir, en donnant à voir de façon privilégiée quelques batailles navales et scènes de mer et en suggérant que tel personnage, à la fin du XVe siècle, comprend que l'avenir se jouera sur les mers. Les images sur la mer mêlent l'épique des abordages où l'on croise le fer et le grotesque qu'on peut imaginer lorsqu'il est question de mal de mer: sérieuse et réaliste lorsqu'elle suit le fil de l'histoire d'Angleterre, l'auteure ne perd jamais un certain sourire – qui affleure aussi lors de certains dialogues, finement travaillés, ironiques à l'occasion.
Si c'est bien un monde d'hommes que "Le jeu des rois" décrit, son auteure ne manque pas de parler des femmes qui, dans l'ombre, font l'histoire ou en sont l'objet, ce qui revient parfois au même. Si la Guerre des Deux-Roses est moins populaire que la Guerre de Cent-Ans, elle n'en garde pas moins quelques péripéties et intrigues passionnantes et complexes qui ont un certain don pour captiver le lecteur. Et à travers la famille des Waringham, elle personnifie le regard porté sur l'époque, tout en lorgnant vers l'avenir: "Le jeu des rois" s'achève en 1485, à la veille des grandes conquêtes navales de la Renaissance. Comme il y a actuellement sept romans autour des Waringham, se succédant de façon chronologique, gageons qu'il y aura de quoi se faire plaisir jusqu'au tout début du XVIIe siècle. Affaire à suivre, c'est le cas de le dire: pour les Waringham, la roue de la fortune n'a pas fini de tourner!
Rebecca Gablé, Le Jeu des rois, Paris, HC Éditions, 2019. Traduction de l'allemand par Joël Falcoz.
Le site de Rebecca Gablé, celui des éditions HC Éditions.