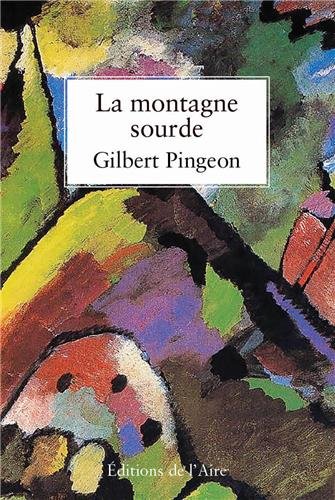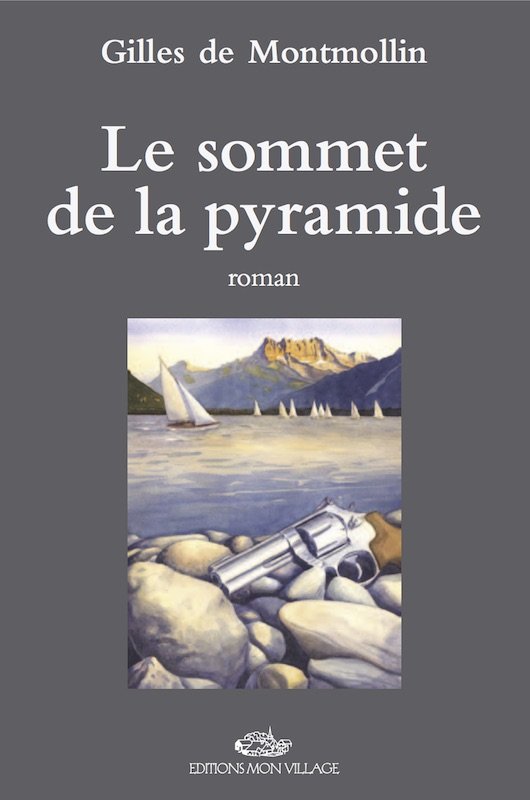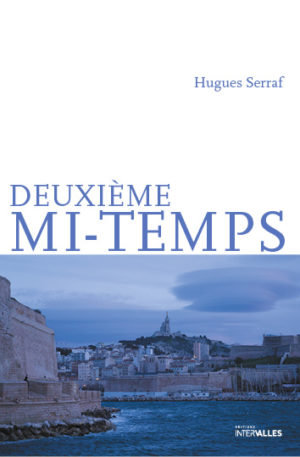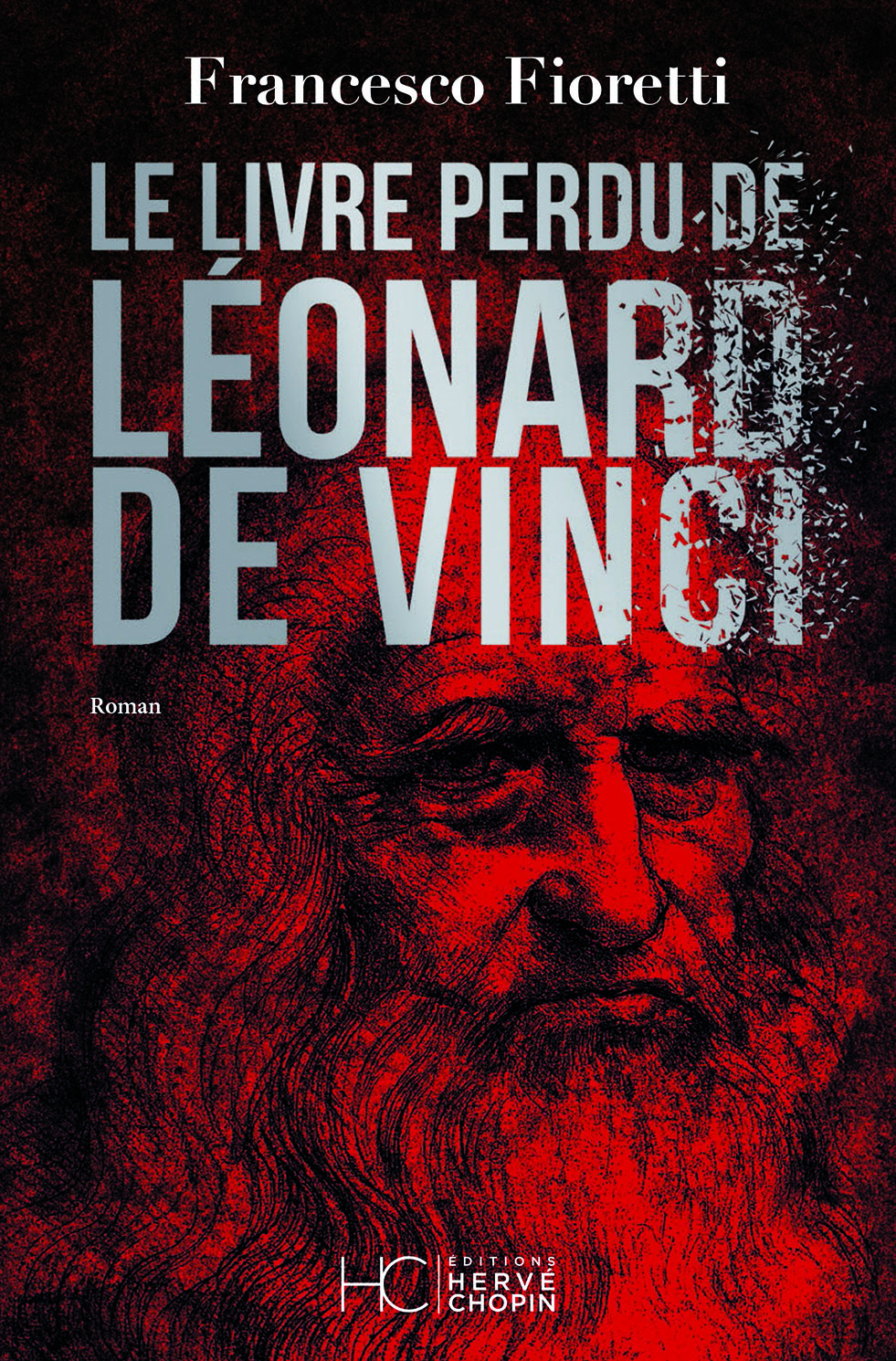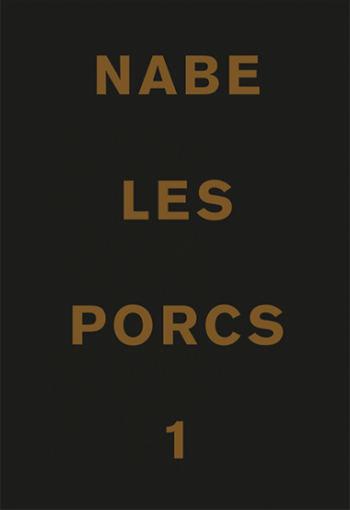Michel Niquille – Après un premier opus intitulé "Poker d'as sur Pérolles", l'écrivain fribourgeois Michel Niquille revient avec "Du sang sur le Moléson". Un second ouvrage qui apparaît comme un véritable roman, décliné en chapitres courts qui, en phrases rapides comme celles du journalisme, dessinent avec succès une intrigue de vengeance classique et solide, ainsi que des ambiances bien campées.
Récapitulons les faits: en 1995, Denis Vuillemin, employé des remontées mécaniques du Moléson, découvre le cadavre d'une quadragénaire à la sortie d'un dancing nommé "La Peau de Vache", bien connu de tous les Fribourgeois. Meurtre, viol? La machine policière et judiciaire se met en branle. Cela, avec ses efficacités et surtout ses résistances...
Deux tempéraments d'enquêteurs s'affrontent en effet dans ce roman: celui du juge Gremion, qui a "sa petite idée" à laquelle il tient malgré une évidence de plus en plus manifeste. Ce caractère buté est, selon l'écrivain, la manifestation d'une personnalité en proie à ses préjugés et obsessions, construits en partie sur des croyances chrétiennes radicales, mais aussi sur la loyauté envers une institution policière qui, si elle se veut irréprochable, n'hésite pas à protéger les notables au besoin.
A la personnalité du juge Gremion s'oppose celle du commissaire Ruffieux, adepte d'une vérité identifiée de manière sereine et patiente, à la manière d'un joueur de go qui encercle son adversaire. L'auteur entend confier d'autres enquêtes à ce personnage; gageons qu'il en ressortira quelque chose d'intéressant, sur fond de terroir fribourgeois.
C'est que la police, en ces terres fribourgeoises qu'on dit paisibles, a longtemps eu ses blocages et ses excès. Ceux-ci transparaissent dans "Du sang sur le Moléson". La crainte de s'attaquer aux notables est un ressort de l'intrigue. Il est intéressant de relever que ceux-ci prennent la forme de chasseurs de jupons, fils de bonne famille, étudiants et violeurs en bande, qui font écho aux chasseurs qui sévissent dans les bois en automne et auxquels il faut aussi donner des gages si l'on veut se faire apprécier comme homme de justice en Gruyère à la fin du vingtième siècle. Et surtout, on relève que tout cela crée, au fil des pages, une ambiance de secret redoutablement protectrice. Gare à celui par qui le scandale arrive!
S'il creuse le contexte policier, en se fondant sur les souvenirs de faits divers qui ont défrayé la chronique fribourgeoise, l'auteur réussit à rendre attachante la personne de la victime aussi. A la façon d'un journaliste, il n'en donne pas le nom de famille, et c'est le seul personnage du roman qui a droit à ce traitement. Mais si l'on s'attache à elle, c'est aussi parce qu'elle a un vécu qui n'est pas de tout repos et qu'elle porte son lot de secrets. Lui allier une amie lourdement handicapée, donc a priori inoffensive, renforce cette impression de sympathie.
Rapide et solidement construit, "Du sang sur le Moléson" est un premier roman de terroir réussi: brièvement, par esquisses, il donne à voir plus d'un lieu du sud et du nord du canton de Fribourg, et met en scène des personnages qui, détestables ou attachants, ne laissent pas indifférent. Cela, à partir de quelques traits de caractère habilement esquissés. Et qui, en tout cas pour le commissaire Ruffieux (mais aussi, c'est sûr, pour le juge Gremion!), méritent d'être approfondis au gré de nouvelles intrigues.
Michel Niquille, Du sang sur le Moléson, Bulle, Editions de la Trême, 2018.