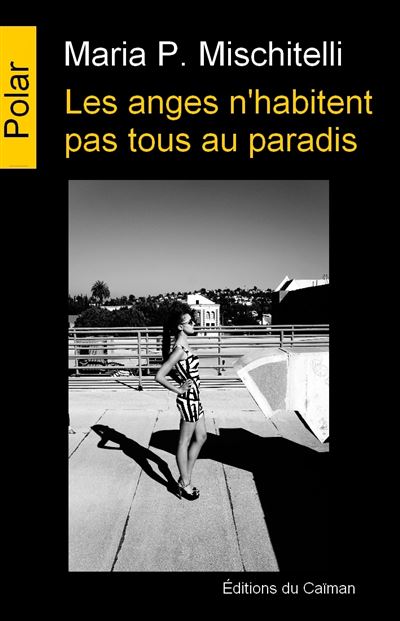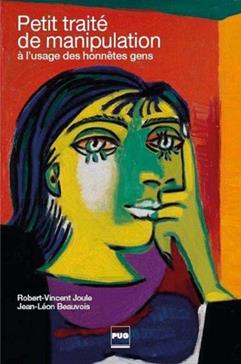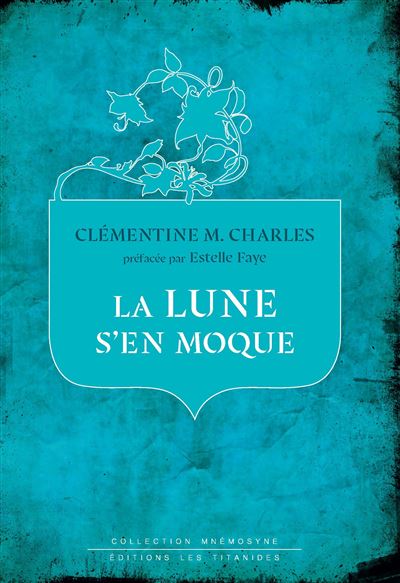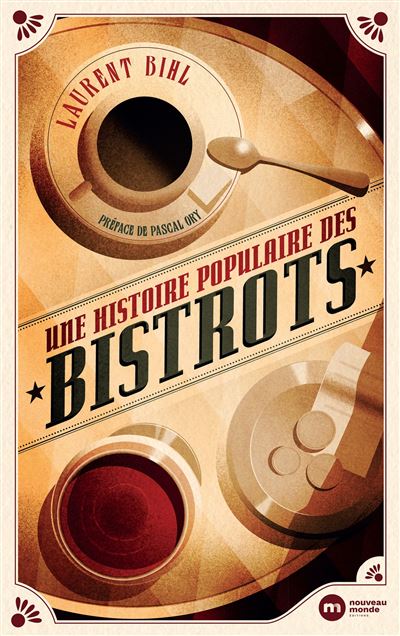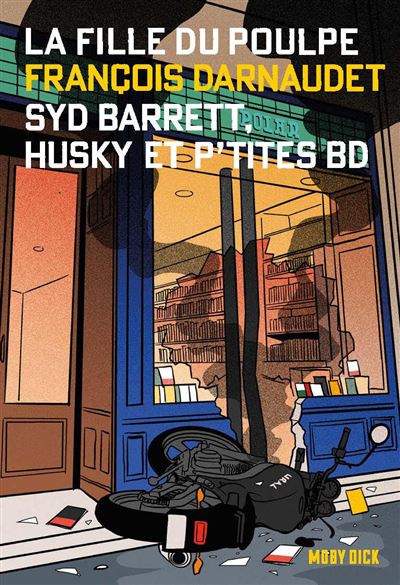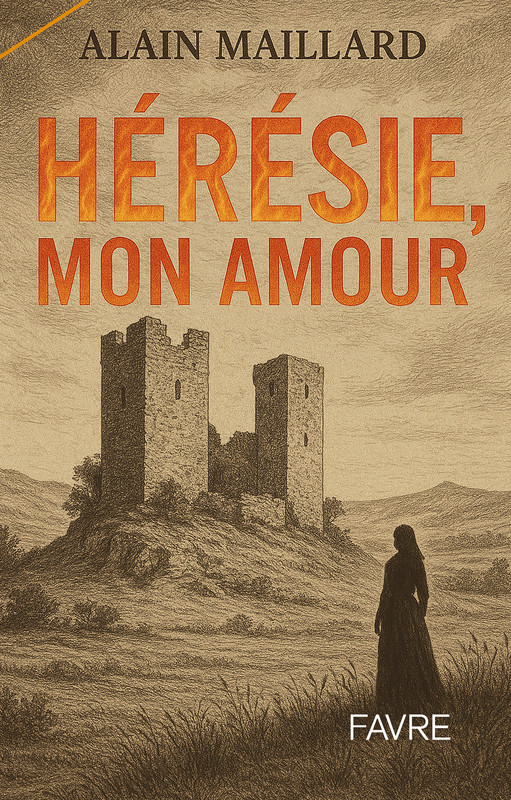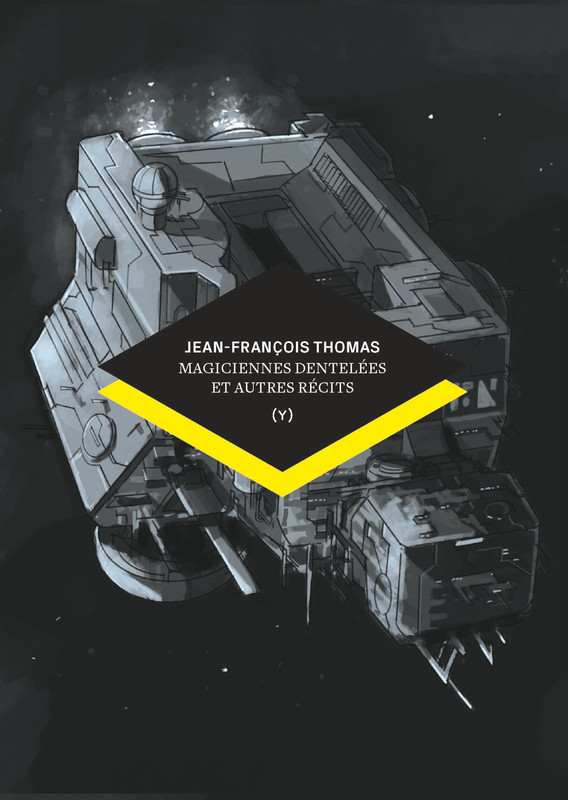Laurent Bihl – Ce soir, c'est la tournée des grands-ducs! Une tournée qui va aller au travers des âges, du dix-huitième siècle français jusqu'à aujourd'hui voire demain. Avec l'historien Laurent Bihl, l'excursion sera savoureuse, ample aussi: l'ouvrage qu'il a écrit sur les débits de boissons au fil des âges, "Une histoire populaire des bistrots", pèse près de 800 pages.
Pas de gueule de bois à craindre, pourtant: la lecture de ce livre riche en anecdotes épatantes (relatant entre autres les origines du chant de "L'Internationale", né dans le contexte de chorales solidaires nommées "goguettes") s'avère accessible, instructive et riche en surprises. Il y a aussi quelques mises en question, par exemple sur la (trop) célèbre étymologie du mot "bistrot" attribuée au mot russe "быстро" qui signifie "vite", ou des précisions terminologiques d'intérêt: les noms désignant les établissements publics où l'on sert des rafraîchissements sont légion en français, et tous ont leur spécificité.
Faisant démarrer son travail historique au mitan du dix-huitième siècle, l'auteur tient sa ligne directrice historique: lieux où les esprits s'échauffent à grand renfort de café et d'alcool, les bistrots sont considérés depuis longtemps en France comme des lieux potentiellement subversifs, à surveiller de près. L'auteur retrace en conséquence l'évolution du droit applicable aux établissements publics. On pense aux règles contraignantes relatives aux apéritifs anisés (ou non, mais la méfiance est là, et si Laurent Bihl donne des pistes dans son livre, l'apéro en France, avec ses enjeux, ombres et lumières, mériterait une histoire à lui seul), aux horaires d'ouverture, et il est permis de voir, entre les lignes de l'auteur, la description d'un Etat français oscillant entre flicage brutal et paternalisme intéressé.
Le lecteur parcourra avec intérêt le rôle joué par les Auvergnats dans le développement de la cafétérie et de la restauration parisienne, qui va jusqu'à la mise en place de prix littéraires qui, nés dans les profondeurs du vingtième siècle, existent encore aujourd'hui. C'est là qu'on en apprendra davantage aussi sur les brasseries historiques de Montparnasse; l'auteur en regrette cependant l'évolution actuelle, qui consiste en un figement où seuls les prix évoluent, tendanciellement vers le haut. "Le Dôme", "La Rotonde", "La Coupole": vous en avez peut-être fait l'expérience... et les fantômes des célébrités qui les ont hantés, les Hemingway et consorts, ont peut-être pu vous paraître bien loin.
Adossé entre autres aux travaux de Didier Nourrisson, l'historien s'intéresse aussi au statut des personnes qui hantent les bistrots, qu'il s'agisse d'ouvriers au sortir de l'usine, goûtant sans mesure à l'absinthe et à des vins où il y a davantage d'additifs que de raisin, ou de grands bourgeois s'enivrant (sans mesure non plus) au champagne: l'alcoolisme des uns est-il meilleur que celui des autres? L'auteur suggère une hiérarchie, du point de vue social, que la médecine contredirait bien sûr. Et aujourd'hui? L'auteur se montre critique envers la sévérité de la législation française d'aujourd'hui, qui invoque la lutte contre l'alcoolisme: aujourd'hui, selon lui, les jeunes s'enivrent chez eux avec des breuvages achetés au supermarché, parce que c'est moins cher. Dès lors, selon lui, le champ de cette bataille n'est plus tant le bistrot que d'autres lieux, moins contrôlés, où l'on se procure puis où l'on consomme des vins et spiritueux.
Un tel ouvrage ne saurait se terminer par un chapitre sur les perspectives des bistrots, considérés comme des institutions. Centrée sur la France, cette étude envisage la raréfaction des "Licences IV" comme porteuse d'un risque de disparition des bistrots, pourtant lieux de socialisation dans des espaces qui, sur le territoire français, en manquent cruellement. L'auteur évoque aussi l'émergence des bistrots associatifs comme un avenir possible; il est dommage qu'il passe sous silence le conflit larvé entre le modèle traditionnel de restauration, très normé, et le modèle associatif, nettement plus libre, ce qui permet une forme de concurrence pas toujours considérée comme loyale.
Avec "Une histoire populaire des bistrots", l'historien poursuit et complète l'œuvre de son père Luc Bihl, auteur de "Des tavernes aux bistrots : une histoire des cafés" (1997). Volontiers conteur, Laurent Bihl associe brillamment la petite et la grande histoire et fait alterner avec bonheur les lames de fond et les anecdotes. Richement documenté, son ouvrage retrace l'aventure d'un ensemble de professions: patrons, restaurateurs, garçons de café (oui, même le caractère, euh, typique des garçons de café parisiens a une histoire!), etc. La place des femmes n'y est pas non plus oubliée, qu'elles soient derrière le bar, en salle pour le service (avec une porosité quelque peu taboue avec la prostitution) ou comme clientes, parfois mises à l'écart de lieux propices à la bagarre, donc considérés comme dangereux pour elles.
Bref, "Une histoire populaire des bistrots", c'est de la belle ouvrage, instructive en diable, à lire, pourquoi pas, accoudé au zinc d'un bistrot de quartier: ce livre fonctionnera dès lors comme accélérateur de sociabilité, ce qui est toujours sympa à prendre.
Laurent Bihl, Une histoire populaire des bistrots, Paris, Nouveau Monde Editions, 2023. Préface de Pascal Ory.