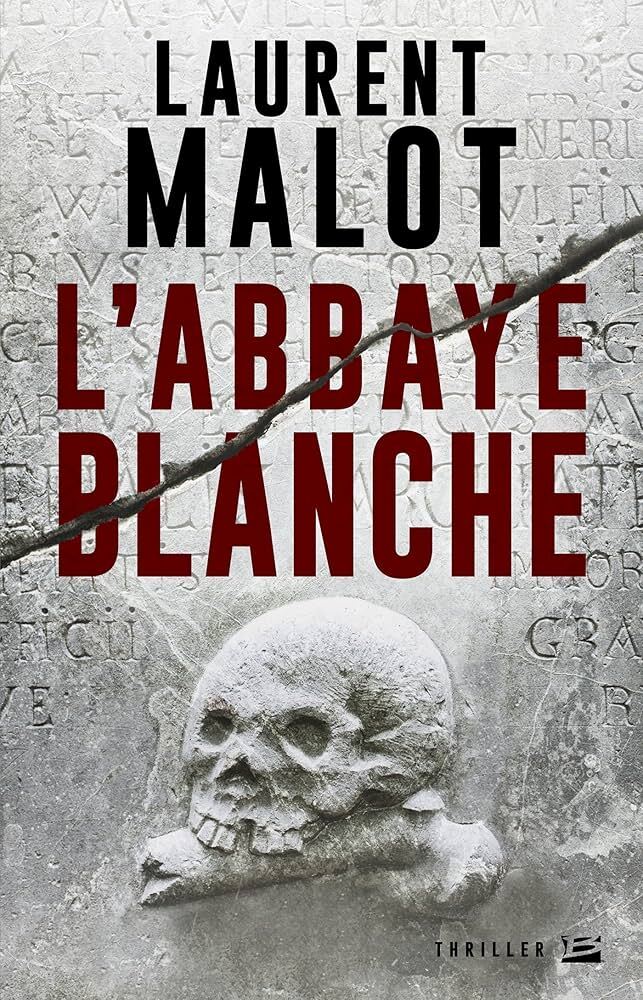Collectif – Il y eut un concours, naguère, invitant les écrivains déjà publiés à écrire un texte autour de la nature. Celui-ci a été lancé à l'initiative de la fondation Pierre et Nouky Bataillard en 2016, et a recueilli une brassée de nouvelles. Sept d'entre elles, primées ou remarquées, ont paru à la fin de l'année dernière aux éditions L'Age d'Homme, sous le titre "Natures".
Sept textes, sept auteurs, ce sont aussi sept personnalités d'écrivains qui ont du métier, bien tranchées au fil des pages. Premier prix, la nouvelle "Le Phare", signée Véronique Timmermans, donne le ton: l'écriture est belle et sobre, évitant les éclats inutiles et soucieuse d'aller à l'essentiel. Au travers de la mise en scène d'un gardien de phare aux origines bien terriennes, elle cumule les contrastes: terre et mer, homme et nature. Bien construite en sections courtes qui sont autant de mini-chapitres, elle fonctionne autour de flashes, reflets d'instants de vie.
Il y a beaucoup de sensibilité dans "La Question" de Matthieu Mégevand, qui met en scène un personnage animal, une vache, décrit avant d'être nommé et même baptisé. Alors que le titre suggère une question, l'auteur choisit de gommer les points d'interrogation, donnant à cette nouvelle une ambiance faussement sereine. Le dialogue rêvé entre l'humain et la vache, jouant sur le "je" et le "tu" en une forme d'exclusivité, suggère la relation entre la nature et l'homme. Cela, en contraste avec des tiers qui considèrent la vache comme un "bout de viande". Cette communion entre les espèces, malgré une issue inéluctable, n'est-elle pas une manière d'illustrer l'antispécisme et ses limites?
Il y a aussi des ambiances d'anticipation dans "Natures", forcément. "Rendez-vous millénaire" d'Anne S. Giddey revêt la forme d'une nouvelle post-apocalyptique intéressante, en ce sens qu'elle remet en cause les alliances et inimités passées entre espèces, à la lumière d'une nouvelle donne. Il y est question de loups, mais on ne le devine que peu à peu, et ce texte est rythmé avec pertinence par les changements de points de vue. Quant à Olivier Chapuis, c'est carrément à la nostalgie qu'il s'attaque, mettant en scène avec l'humour qu'on lui connaît une réunion qui n'est pas sans rappeler les Alcooliques Anonymes: ce seraient alors les Nostalgiques Anonymes. Nostalgiques de la nature, bien sûr, dans un monde entièrement aseptisé, obsédé par l'hygiénisme et le bio de complaisance. Curieusement, le désir le plus animal y a encore droit de cité...
Il est encore question de dialogue entre l'amateur de forêts et la bête chassée dans "L'homme et le cerf" de François Jolidon, qui met en avant l'ingratitude de l'humain face à la nature nourricière et salvatrice, et qui se distingue par deux voix bien distinctes: celle du cerf, écrite en vers libres, et celle de l'humain, en l'occurrence un champignonneur, rédigée en prose. Le lecteur goûtera aussi l'éclatante sensualité de "Comme un rêve d'opaline" de Florence Cochet, qui naît du support factice de la technologie, technologie également omniprésente dans "DameNature 2.0" de François Rouiller.
"En plein bouleversement environnemental, tous les goûts ne sont plus dans la nature", déclare Christian Ciocca dans une préface dont on appréciera davantage le ton travaillé que la tendance à la paraphrase de ce qui vient. On se joint au préfacier, cependant, pour indiquer que "Natures"est un recueil qui réunit sept nouvelles consacrées aux tendances les plus actuelles, écologiques au sens le plus large qui soit, liées au rapport de l'humain à la nature. Cela, au travers d'écritures diverses, toutes sensibles à cette question cependant, garantes d'un moment de lecture intéressant et de qualité.
Collectif, Natures, Lausanne, L'Age d'Homme, 2017. Préface de Christian Ciocca.