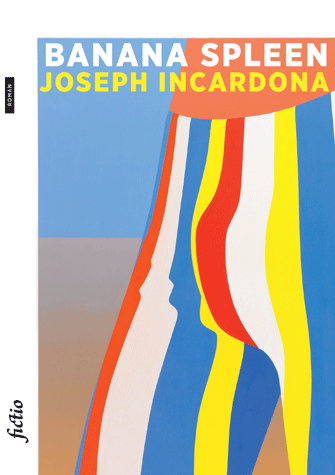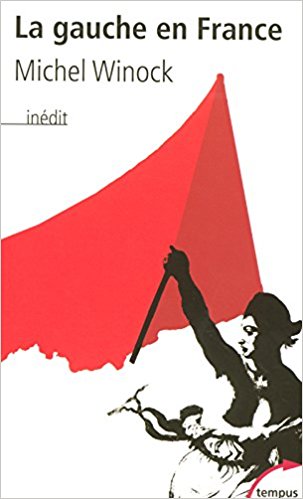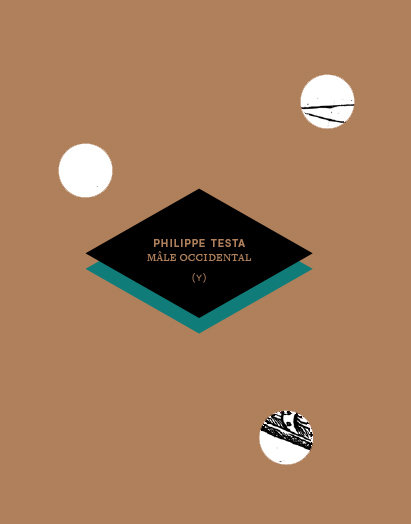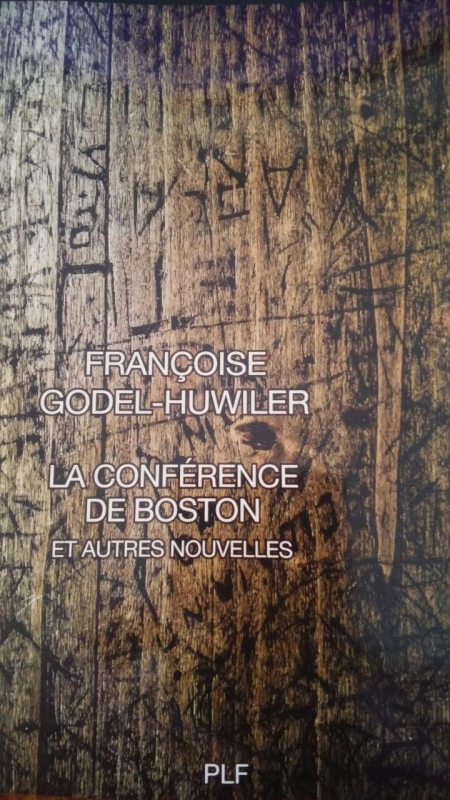
Françoise Godel-Huwiler – Les nouvelles que l'écrivaine et dramaturge fribourgeoise a réunies dans "La Conférence de Boston et autres nouvelles" ont été écrites au fil des années d'une existence voyageuse. Les sept textes de ce premier recueil témoignent d'une ouverture sur le monde et font voyager le lecteur. Elles révèlent aussi le goût d'une écriture soignée. Et le plus souvent, ce sont des femmes qui en sont les personnages principaux.
La nouvelle qui donne son titre au roman est, de ce point de vue, exemplaire. Tout s'ouvre sur un moment de stress, celui du personnage principal, qui doit se préparer à donner une conférence alors que, historienne de l'art immigrée aux Etats-Unis de sa Bulgarie natale, elle n'a obtenu qu'un poste de nettoyage dans un musée. Moment de stress joliment rendu, d'emblée, par une succession d'infinitifs qui rendent ce début haletant.
Plus loin dans la nouvelle "La Conférence de Boston", l'écriture se fait précieuse, un peu à l'ancienne, pour citer la conférence que la narratrice se propose de donner: on se plonge dans le tableau "Le Concert" de Vermeer (effectivement conservé à Boston), avec le délice d'une certaine sensualité. Cela tranche avec l'histoire plus prosaïque de la conférencière qui se hâte vers le musée; mais n'y a-t-il pas un parallèle à déchiffrer entre la Bulgare qui connaît une évolution de carrière soudaine et la fille du tableau, serveuse promue modèle? Cela, avec en fin de récit la promesse d'une tendresse nouvelle.
Le lecteur appréciera aussi le regard que porte l'auteure sur l'histoire biblique de Salomé, transposée dans une pièce de théâtre. "Les jupes de ma mère" est une nouvelle pétrie de culture générale, qui fait ressentir les états d'âme d'une comédienne de théâtre qui, tout en jouant, espère et redoute que sa mère, une femme qui s'impose partout où elle arrive, vienne la voir jouer lors d'une répétition publique. En écho, se dessine justement cette relation mère-fille, parallèlement à la relation qui a pu lier Salomé et sa mère.
Il est permis d'être plus perplexe face à "A chacun selon ses mérites", qui décrit un monde d'une façon un peu trop allusive: est-ce qu'on est en présence d'un élevage de chats ou d'une maison close... ou un peu des deux? L'auteure s'en sort avec un bug informatique... Cela dit, le lecteur se laissera malgré tout bercer par la sensualité féline (c'est le cas de le dire!) et l'ambiance onirique qui se dégage des phrases de cette nouvelle qui s'ouvre sur une réincarnation.
"La Conférence de Boston et autres nouvelles" est aussi un recueil empreint de tendresse, affirmée en particulier dans le portrait d'une grand-mère collectionneuse de cartes postales dans "Bons baisers de la Lune". Soigné, empreint d'une certaine retenue qui n'empêche pas, au contraire, la sensualité, l'ouvrage offre au lecteur avide d'évasion une bonne bouffée d'air du large.
Françoise Godel-Huwiler, La Conférence de Boston et autres nouvelles, Fribourg, PLF, 2018.
Le site des éditions PLF.