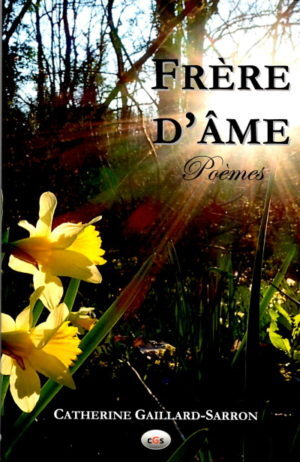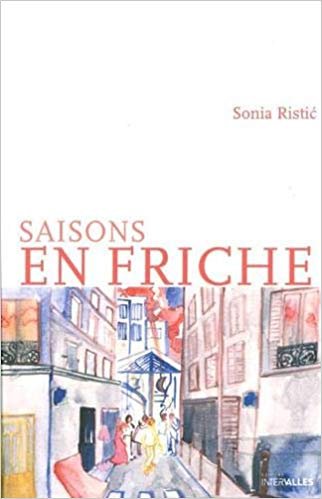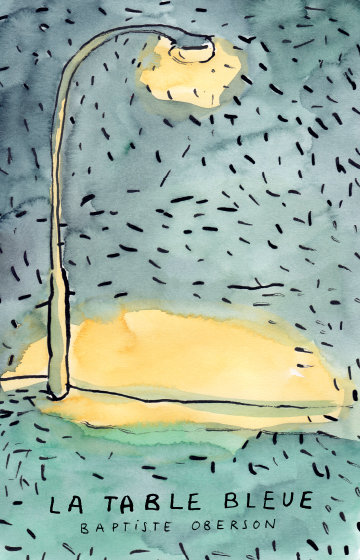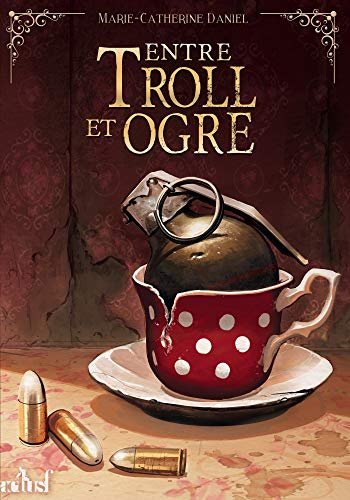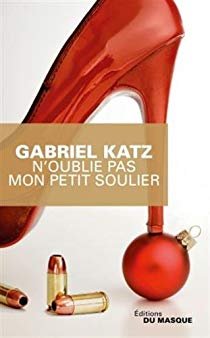Catherine Gaillard-Sarron – Avec "Frère d'âme", Catherine Gaillard-Sarron signe un livre de poésie extrêmement personnel autour du décès du frère de la poétesse, emporté par un cancer. Recueil? L'écrivaine va plus loin que la collecte d'états d'âme épars et fait de son livre un ouvrage qui, simplement, se structure autour de double loi d'airain de la mort et, pour ceux qui restent, du temps qui passe. Collectés en quelque 75 pages, les poèmes condensent donc les ressentis sur le ton du souvenir, mais aussi sur celui de la vie et de l'amour qui doivent primer.
Tout commence par la vision difficile de ce frère amoindri sur un lit d'hôpital, qui sait qu'il va partir. Comment le vivent ceux qui vont rester? Et comment le vit celui qui va partir? "Il va mourir./Il le sait./Et nous le savons aussi.": en trois vers, la situation est installée. La poétesse observe avec tendresse celui qui s'en va, attentive surtout à son regard, certes angoissé, mais aussi dernier à rester vif alors que le corps déjà dépérit: "Tes yeux de magnétite qui aimantent les miens...": là est toute la force de la vie. Cette attention au regard va jusqu'au bout: "Il nous fait ses adieux/Des larmes dans les yeux."
Il y a une forme de mise à distance dans tel poème écrit à la troisième personne, qui signifie l'acceptation du départ ultime et le début du processus de deuil. "Traversée en solitaire" évoque ainsi ce qu'on nomme volontiers "le dernier voyage"; là, la poétesse recourt à la troisième personne aussi, la seule juste: ce voyage, seul le défunt en fait l'expérience. Mais dans le poème "La Dame brune", qui évoque aussi le défunt à la troisième personne, cette distanciation n'oublie pas la proximité: "De tous il a tenu la main", dit-on de celui qui est désormais parti.
Par contraste, le poème "Mon frère est mort", écrit à la première personne, celle de l'écrivaine, apparaît comme extrêmement intime, utilisant le vers "Mon frère est mort" comme une anaphore, soulignée par l'usage varié et sensé de la ponctuation, porteuse de sens à chaque fois. Et il y a ce "A notre frère", poème qui utilise le "nous" pour dire le deuil de toute une famille, de tout un monde, et résonne comme un vibrant hommage funèbre.
Les circonstances du départ du frère apparaissent comme un lieu littéraire par excellence: il est parti à la fin de l'hiver, glaçant un peu plus l'arrière-saison. La poétesse ne manque dès lors pas de mentionner les flocons qui tombent - tout en rappelant que le frère défunt voulait partir au printemps. Elle indique aussi les fleurs qui reviennent - ce que suggère le poème "Au printemps". Ce printemps, saison du renouveau, est celui d'un autre départ: la vie doit continuer, et l'amour est sans doute la clé pour la rendre vivable malgré l'absence. "L'amour qui grâce à nous/Triomphera de tout", conclut d'ailleurs le dernier poème du livre.
Le processus de deuil est aussi l'occasion de réfléchir à ce qu'a été ce frère à la fois familier et méconnu, "Ce frère Tournesol, inventif mais distrait". La poétesse ne manque pas de faire résonner son approche littéraire avec le tempérament scientifique du disparu. Invité dans l'intimité de "Frère d'âme", le lecteur ne peut que s'interroger: est-ce que je connais vraiment mon frère, ma sœur? Est-il mon frère, ma sœur d'âme, d'armes, est-on tenté de lire?
Les points de vue varient, on l'a dit, et sont autant de focales sur le drame d'un deuil. La poétesse varie aussi la forme de ses poèmes, oscillant entre une versification parfaitement libre, libérée même de sa ponctuation, simple et proche du ton de la conversation, et des vers alexandrins d'allure classique et solennels, ou alors de facture néoclassique, libérés des strictes règles d'antan: le moment du deuil n'est pas celui de la rigueur, celui où l'on s'empêche parce que les conventions l'exigent. Reste une constante, qui rythme "Frère d'âme": ces haïkus qui introduisent chacun des poèmes et forment un contrepoint très dense à ce qui va être plus longuement dit.
Ainsi l'écrivaine, recourant à des mots simples et directs, met son cœur à nu et recourt à tout son art poétique pour dire de manière juste et profonde le départ d'un être cher, ce frère, ce Christian auquel "Frère d'âme" est dédié, invitant le lecteur à partager sa peine, mais aussi la promesse d'un deuil apaisé. Ce que suggèrent les jonquilles inondées de soleil figurées sur la couverture de ce livre fort.
Catherine Gaillard-Sarron, Frère d'âme, Chamblon, Catherine Gaillard-Sarron, 2019. Préface de François Gachoud.
Le site de Catherine Gaillard-Sarron.