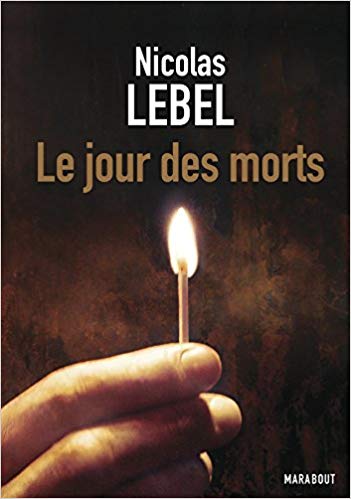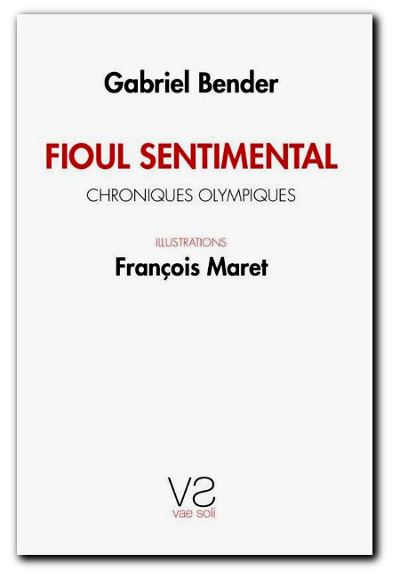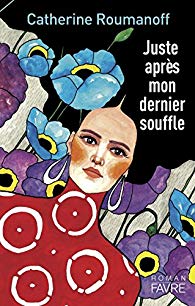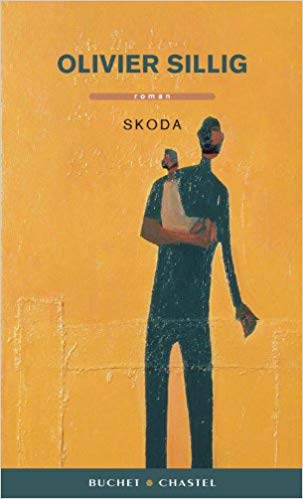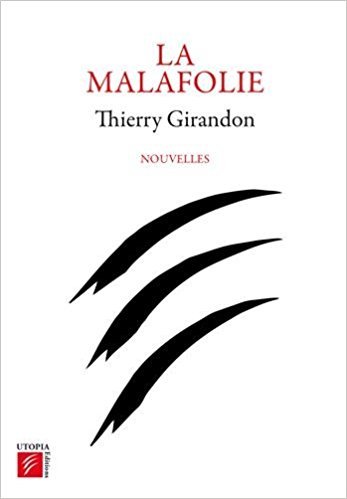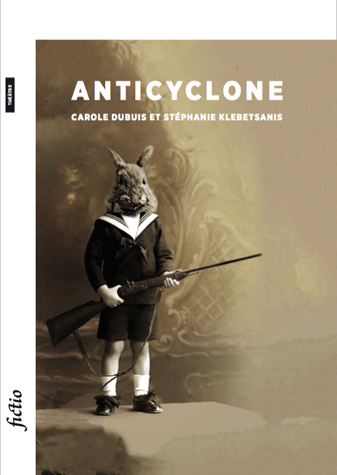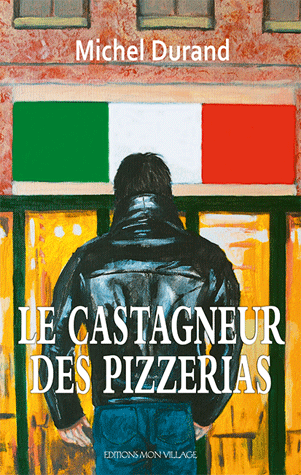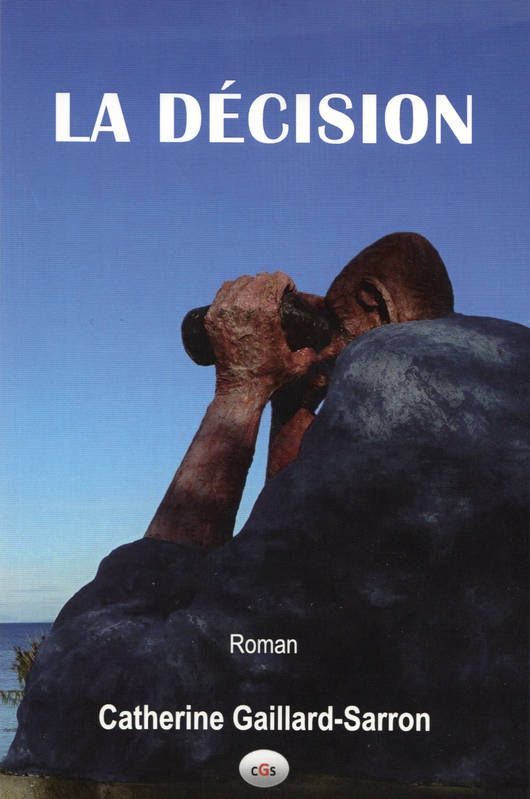
Catherine Gaillard-Sarron – Partir d'un malaise existentiel pour passer à autre chose: c'est le fil conducteur de "La Décision", troisième roman de l'écrivaine Catherine Gaillard-Sarron. Un roman qui tourne autour du personnage de Vincent, mis à l'écart d'une promotion très attendue au profit d'un collègue. Que faire, dès lors? En parler en famille? Vincent prend une décision qui va traverser tout ce roman où la psychologie occupe une place prépondérante.
Psychologie? La romancière aborde des thèmes difficiles comme le harcèlement en entreprise ou l'incommunication en couple et en famille, voire entre amis. Il en résulte d'assez longs passages introspectifs, les personnages étant poussés à se remettre en question; d'autres évoquent la vanité de certaines valeurs d'entreprise, voire la perte de sens du travail. Cela ralentit certes le propos, mais ça sonne toujours juste.
Le propos? Le harcèlement en entreprise dont Vincent est la victime est peu décrit. La trame narrative se concentre sur la narration du week-end en famille que Vincent vit après son éviction. Basé sur un mensonge, une omission qui va peser un peu sur l'ambiance, celui-ci s'avère cependant heureux, plus même que d'habitude: les activités sont nombreuses et pas forcément de tout repos, entre balade à Nyon, rencontre avec les voisins, etc. Pour un quadragénaire surmené virant quinqua, Vincent a d'ailleurs la santé: il fait l'amour une demi-douzaine de fois à son épouse durant les deux ou trois jours qui sont le cœur de "La Décision", et les descriptions, sans fausse pudeur, s'avèrent voluptueuses comme il se doit. Ces scènes suggèrent aussi qu'un langage du corps, à défaut de celui des mots, s'installe à nouveau entre les personnages, avec passion.
Des personnages aux noms choisis avec soin, d'ailleurs. Certains rappellent des localités romandes (Marly, Morat) ou des polices de caractère (Bodoni, Garamond), d'autres sont transparentes, à l'instar de ce supérieur hiérarchique nommé Canis, véritable chien. Il est à relever que si les personnages secondaires, et en particulier les collègues de travail de Vincent, sont le plus souvent désignés par leur nom de famille, les personnages qui composent la famille de Vincent sont nommés par leur prénom, et ce n'est qu'incidemment qu'on apprendra leur patronyme, assez loin dans le roman. Ainsi se crée, pour le lecteur, une connivence particulière avec la famille qui est au cœur de "La Décision".
"La Décision", c'est trois ou quatre jours qui vont tout changer dans la vie d'une famille suisse romande ordinaire. Tout le monde en sort grandi et plus mûr, même les deux filles qui, en fin de roman, ne pensent plus guère aux gadgets électroniques indispensables pour être dans le coup à l'école. En forme de nouveau départ, la conclusion a des airs de roman feel-good, suggérant que si l'absence de communication peut faire d'importants ravages, parler de ses problèmes, par écrit ou par oral, est un premier pas vers leur résolution. Et "La Décision" trouve les mots simples et justes pour le dire.
Catherine Gaillard-Sarron, La Décision, Chamblon, CGS, 2018. Préface de Jean-Marie Leclercq.
Le site de Catherine Gaillard-Sarron.