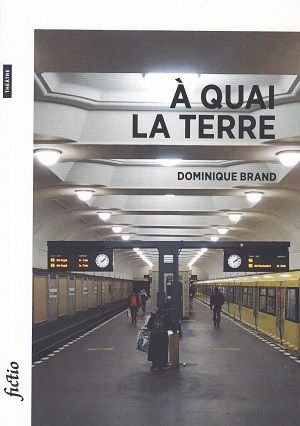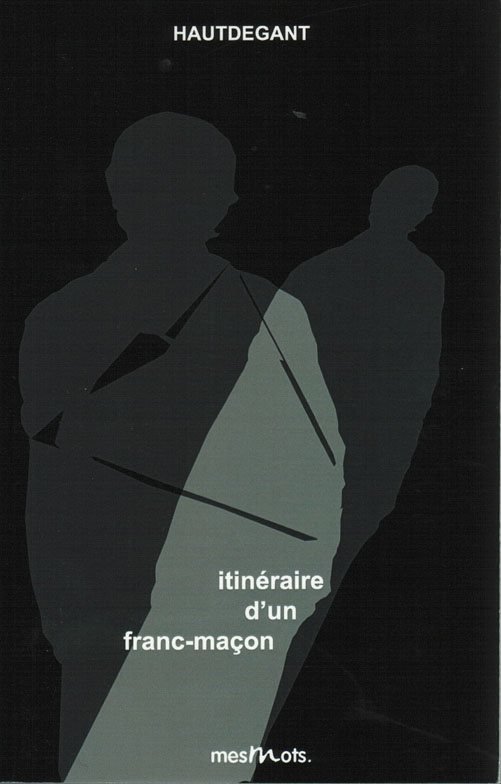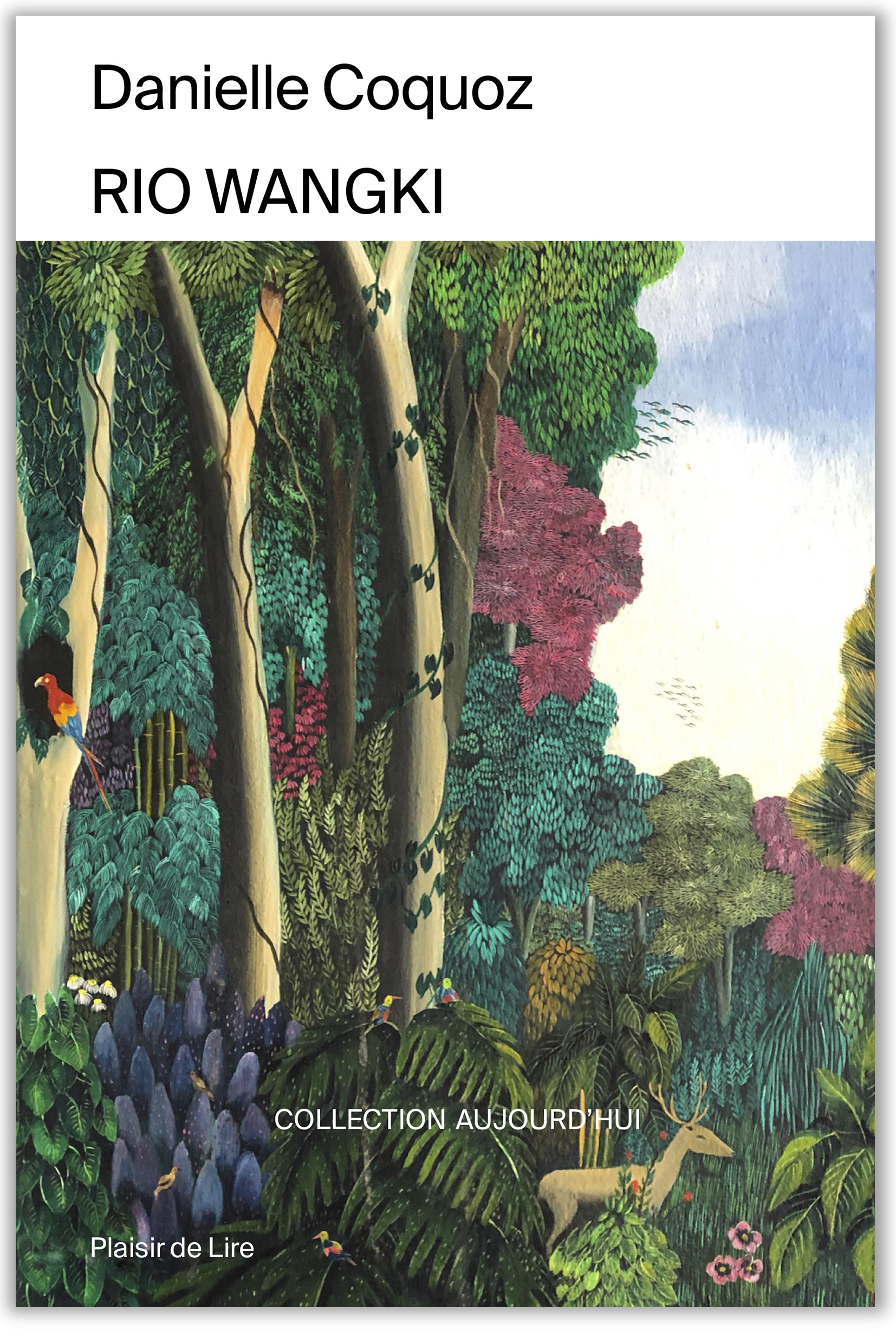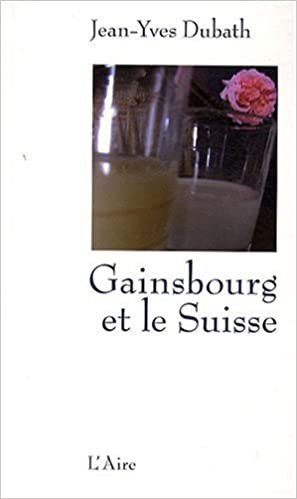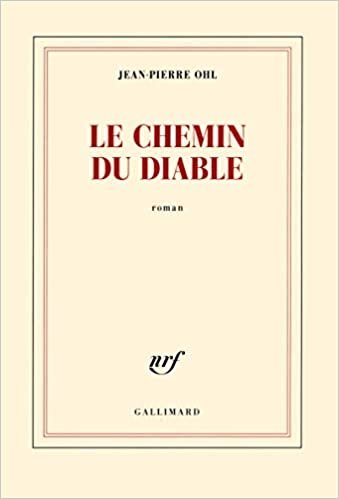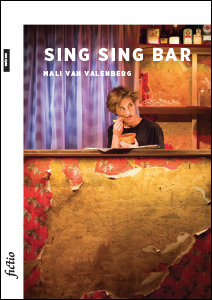dimanche 28 février 2021
Dimanche poétique 488: Philippe Jaccottet
vendredi 26 février 2021
Le métro, théâtre d'une poésie à jouer avec Dominique Brand
Dominique Brand – C'est à une sortie dans les rames du métro berlinois que le poète et dramaturge franco-suisse Dominique Brand invite ses lecteurs et ses spectateurs dans "A quai la terre". Il s'agit là d'un ouvrage posé entre deux eaux: celles du théâtre, lieu de la mise en voix vivante, et celles de la prose poétique, lue dans l'intimité. Et que ce soit sur scène ou en lecture silencieuse chez soi, ça fonctionne.
Un mot sur le contexte de cette publication, d'abord: "A quai la terre" a dû composer avec les conditions sanitaires et administratives que l'on sait. L'œuvre a ainsi vu le jour hors des salles de théâtre le 26 janvier 2021 sous l'égide du Théâtre 2.21 à Lausanne. Elle assume d'être en permanente métamorphose. Une métamorphose qui fonctionne aussi dans l'esprit du lecteur qui n'a pas été spectateur. "Les théâtres sont fermés, le moment est propice à réinventer les modes de représentation", commente la journaliste Natacha Rossel dans "24 heures".
"A quai la terre" se présente comme une succession de portraits et de choses vues dans le métro de Berlin, emblématique de tous les métros du monde. Portraits de gens anonymes, vues de manière fugace, croquées à coups de crayon rapides et précis, pour ne pas dire prégnants: en quelques lignes, émerge à chaque fois un humain dans sa singularité: "Dame Halloween", ou ce "Prédicateur" qui vit sa misère – toute une histoire condensée en quelques lignes. Ces portraits, ces instantanés veut-on dire, composent la mosaïque du cosmopolitisme des grandes villes, avec des personnages venus de loin pour exercer des travaux ignorés mais essentiels.
Fait remarquable, l'écriture se passe pratiquement de ponctuation. Résultat: l'acteur seul est invité à ciseler la musique du texte – ou, pourquoi pas, le lecteur, qui peut se lancer chez lui, à haute voix. Cela, même si l'agencement des mots, certaines cascades de noms communs juxtaposés pour suggérer l'accélération par exemple, donnent des pistes.
Et pourquoi être seul à dire les textes, d'ailleurs? C'est le choix de la scénographie prévue, signée Nicolas Wintsch, avec la comédienne Anne Vouilloz. Mais le lecteur aura peut-être d'autres envies, et celles-ci sont dans le texte lui-même: on pourrait par exemple imaginer une voix incidente, aussi contrastée que possible, pour clamer les annonces par haut-parleur du métro berlinois, qui viennent rompre le déroulé de la relation des portraits. Rupture double d'ailleurs: le poète les maintient en allemand, alors que ses proses poétiques sont en français.
Et la salle rêvée paraît se rallumer au moment de l'épilogue, au rythme changé: les séquences s'écrivent par lignes, la ponctuation est de retour. Cela, pour rappeler ce lieu paradoxal du métro, théâtre de contacts et de distanciation sociale, de connexions tous azimuts. Avec "A quai la terre", il est bien sûr permis de penser aux livres "Le métro est un sport collectif" de Bertrand Guillot ou "Je regarde passer les chauves" de Sandrine Sens, qui disent le métro parisien. Mais après tout, pourquoi ne pas aller un peu plus loin?
Dominique Brand, A quai la terre, Lausanne, BSN Press, 2021.
Le site des éditions BSN Press.
Lu par Francis Richard.
mercredi 24 février 2021
Jean Claude Hautdegant, le parcours d'un initié
dimanche 21 février 2021
Dimanche poétique 487: Joachim du Bellay
Quand je te dis adieu, pour m'en venir ici
Quand je te dis adieu, pour m'en venir ici,
Tu me dis, mon La Haye, il m'en souvient encore :
Souvienne-toi, Bellay, de ce que tu es ore,
Et comme tu t'en vas, retourne-t'en ainsi.
Et tel comme je vins, je m'en retourne aussi :
Hormis un repentir qui le coeur me dévore,
Qui me ride le front, qui mon chef décolore,
Et qui me fait plus bas enfoncer le sourcil.
Ce triste repentir, qui me ronge et me lime,
Ne vient (car j'en suis net) pour sentir quelque crime,
Mais pour m'être trois ans à ce bord arrêté :
Et pour m'être abusé d'une ingrate espérance,
Qui pour venir ici trouver la pauvreté,
M'a fait (sot que je suis) abandonner la France.
Deux femmes suisses au Nicaragua, entre sororité et choc des cultures
Danielle Coquoz – Le Rio Coco, vous connaissez? C'est le fleuve qui sépare le Honduras du Nicaragua. Peut-être en connaissez-vous le nom originel, à lui donné par les Amérindiens Miskitos, qui donne son titre au témoignage de Danielle Coquoz: "Rio Wangki". L'auteure y relate les mois qu'elle a passés en Amérique centrale dans le cadre d'une mission un peu folle au chevet des Miskitos, qui sont une population déplacée pendant des années 1980 marquées par la guerre civile. L'idée? Leur faire retrouver leurs terres d'origine. Cela, sous l'égide du CICR.
Le lecteur est vite happé par la musique que l'auteure installe. Cette musique, c'est celle qui installe de l'humour au fil de mots. L'auteure n'hésite pas à rire d'elle-même et de sa propre aventure, presque quarante ans plus tard. Il en résulte un ton résolument familier qui souligne le talent naturel de conteuse de l'auteure. Un talent qui s'exprime tant dans l'anecdote que dans la relation des enjeux d'une mission assez lourde, voire dans les rappels historiques, qui ne sont jamais ennuyeux.
Alors oui: il y a des choses sérieuses dans "Rio Wangki". L'auteure insiste régulièrement sur l'impératif de neutralité auquel le CICR doit rigoureusement se soumettre lorsqu'il intervient en des lieux où la guerre sévit – et en l'espèce, ce témoignage plonge dans les temps où les Contras et les Sandinistes se font face au Nicaragua. Cette neutralité transparaît dans "Rio Wangki", qui refuse de prendre parti pour les uns ou pour les autres. Qui plus est, en relatant une page d'histoire des Miskitos, il observe, avec toute la distance voulue, une communauté autochtone qui, pour des raisons historiques bien expliquées, penche vers ceux qui parlent anglais. Et jamais l'auteure, strictement descriptive, ne condamne ni n'approuve ce parti pris.
"Rio Wangki", c'est une aventure humaine et interculturelle à plus d'un titre, et c'est au fil des anecdotes que l'auteure le révèle. L'auteure se met en scène tantôt face aux Miskitos dont elle découvre les coutumes peu à peu, tantôt face aux latinos qui seront ses collaborateurs, qu'ils soient capitaines de navire, responsables logistiques ou bénévoles humanitaires. Un jour, il faudra virer séance tenante un homme qui utilise la nourriture livrée par le CICR pour monnayer des faveurs sexuelles auprès de femmes contraintes par la misère à cette extrémité. Un autre, l'auteure découvre les noms des Miskitos, pittoresques ou inquiétants. Mais le choc des cultures vécu sous les assauts des moustiques et les déluges démentiels, n'est pas exempt de rires ni de sourires.
Enfin, en évoquant sa collaboration avec sa collègue Andrée Juvet, l'écrivaine relate une véritable complicité, pour ne pas dire sororité, face à l'adversité d'un monde hostile – tantôt à cause des hommes, tantôt à cause de la nature. On se soutient moralement lorsque le moral flanche, on va jusqu'à se sauver la mise l'une l'autre, dans un esprit d'équipe réellement vécu. Cela va jusqu'aux rituels, par exemple les repas bien arrosés entre copines dans ce bistrot "un rien chicos" de Puerto Cabezas, où des crocodiles nagent dans un aquarium, face aux clients. Et deux femmes en mission, c'est un monde de particularités que l'auteure relate: nécessité d'être ferme lorsque ça menace de sortir des rails, mais aussi possibilité de s'ouvrir des portes sur des choses aussi triviales qu'un besoin pressant sur le territoire du Honduras, en principe interdit d'accostage à la mission.
L'auteure est consciente qu'en tant qu'envoyée du CICR au Nicaragua, elle est le maillon d'une chaîne: d'autres reprendront en main le projet de relation d'une population qu'elle a lancé, de même qu'elle aura peut-être été la continuatrice d'autres projets. Sincère et joyeuse, elle relate avec talent une tranche de vie aux allures parfois folles ou acrobatiques où l'adversité comme les soutiens prennent des formes inattendues.
Danielle Coquoz, Rio Wangki, Lausanne, Plaisir de lire, 2021.
Le site des éditions Plaisir de lire.
mardi 16 février 2021
Prophéties en Bretagne et conséquences
Liza Lo Bartolo Bardin – La Bretagne, une terre de légendes... voilà bien un classique! La romancière Liza Lo Bartolo Bardin revisite cette idée avec habileté dans un roman solide intitulé "Eärwenn, les messagers de la lande". Ses ressorts sont l'imaginaire des Templiers et la possibilité d'une appréhension du réel druidique, alternative, ésotérique somme toute, mais ô combien riche. Surtout, elle utilise comme substrat la Prophétie de Jean de Jérusalem, controversée mais d'une troublante actualité – et source romanesque fertile et originale.
On ne peut qu'adorer Eärwenn, personnage moteur du roman, cette vingtenaire originale qu'on dit bizarre voire doucement dingue parce qu'elle voit le monde avec ses yeux à elle, qui ne sont pas toujours ceux de la raison. Vrai: elle ne répond jamais aux questions de la raison, celles que lui pose par exemple Thierry, un jeune homme qui en tombe raide amoureux parce qu'il a su, à un certain moment, la regarder sans préjugés. L'écrivaine fait d'Eärwenn un personnage bourré de fraîcheur, mais aussi un guide que Thierry n'aurait jamais suivie sans le moteur de l'amour.
Pour souligner le caractère fantastique de son roman, la romancière souligne telle ou telle légende du cru, à l'instar de ce bâton de Gargantua ou de l'empreinte de son pied. Légendes immémoriales qui font écho à des histoires plus récentes, moins flamboyantes puisqu'elles reposent sur des amours contrariées. Celles-ci s'articulent autour de la mort mystérieuse du marin breton Pierrig De Collmeuc (il en faut bien un), d'un certain Charles-Henri, alcoolique presque sympathique et très intéressé par les vieilles pierres, et de Rozenn, qui aurait pu, dû être sa femme.
Qui est mort, qui est vif? Le chapitre 21 s'ouvre sur une nouvelle période, paraît détaché du reste du roman puisqu'il se déroule à Paris, quatre ans après l'idylle vécue entre Thierry, qu'on a pu croire mort, et Eärwenn. Pourtant, c'est là que la romancière renoue les fils encore rompus d'un généreux récit – dans un esprit qui paraît plus réaliste mais n'en conserve pas moins un bout de fantastique. Qui est en effet cette mystérieuse femme que Thierry rencontre çà et là, alors qu'il écrit des romans aux atmosphères de conte breton? Est-elle un ange, l'éternel féminin ou, à nouveau, l'envoyée des messagers de la lande?
Sur des bases solides, rédigé sur un ton fluide, le roman "Eärwenn, les messagers de la lande" sait embarquer ses lecteurs dans un monde qui plonge ses racines dans l'imaginaire des légendes chrétiennes. Cela, dans un terroir gorgé d'histoires d'hier comme d'aujourd'hui.
Liza Lo Bartolo Bardin, Eärwenn, les messagers de la lande, Saint-Etienne, Laura Mare Editions, 2010.
Le blog de Liza Lo Bartolo Bardin.
Lu par Goliath, Laurence Lopez Hodiesne.
dimanche 14 février 2021
Dimanche poétique 486: René-François Sully Prudhomme
vendredi 12 février 2021
Jean-Yves Dubath et Serge Gainsbourg, brève rencontre hallucinée
lundi 8 février 2021
Dernier lecteur selon Daniel Fohr: et s'il n'en reste qu'un, ce sera celui-ci!
Daniel Fohr – Le lecteur de sexe masculin est-il un modèle obsolète? Avec "L'émouvante et singulière histoire du dernier des lecteurs", l'écrivain français offre à son lectorat un roman d'anticipation original qui pousse à l'extrême une tendance déjà à l'œuvre actuellement: la disparition des hommes qui lisent. "9 lecteurs sur 10 sont des lectrices", dit la quatrième de couverture. Qui sera le dernier? Pour le romancier, c'est son narrateur.
"L'émouvante et singulière histoire du dernier des lecteurs" s'apparente à une confession sur le statut du dernier lecteur, volontiers introspective, relatée par un homme anonyme, littéralement sans propriétés particulières: c'est le lecteur par excellence, qui n'est guère que cela. L'ouvrage commence par quelques constats aux allures documentaires avant de relater, en courts chapitres au ton faussement désabusé, porteur d'un humour qui est comme qui dirait "la politesse du désespoir", truffé d'allusions littéraires que le lecteur détectera avec gourmandise, ce que c'est que d'être le tout dernier lecteur.
Il y a donc le regard sur le lecteur, vu comme un être bizarre et peut-être pas tout à fait viril, ce qui oblige le narrateur à se déguiser en femme lorsqu'il veut lire dans un lieu exposé au public. C'est que dans "L'émouvante et singulière histoire du dernier des lecteurs", le monde du livre est entièrement aux mains des femmes: il n'y a plus que des lectrices, des autrices, des éditrices et autres actrices en -trices.
S'ensuivent plusieurs questionnements, en particulier sur la manière de ramener aux livres ces hommes friands de séries et d'autres supports narratifs plus aisés, et de toutes façons essentiellement copains avec leur barbecue – un motif récurrent, pour le coup. On ne peut pas dire que le narrateur n'aura pas tout essayé: prêter des livres, inciter les collègues à la lecture. Les excuses sont celles qu'on connaît: image du lecteur homme vu comme une bête bizarre, manque de temps ou d'intérêt. Il y aura quelques illusions, certes, de quoi faire sourire le lecteur.
L'idée même d'écrire un livre "par un homme, pour les hommes" va manquer sa cible... elle pose la question du genre des livres: y a-t-il une littérature masculine et une littérature féminine? Comme objet de réflexion, l'auteur balance les romans d'aventure façon Bob Morane, suggérant même qu'Henri Vernes hante les pages de son livre. Il suggère aussi que peu de femmes apprécient Ernest Hemingway, alors que les hommes ne sont jamais vraiment précipités sur Colette. Cela étant, le lectorat du narrateur sera... féminin. Et curieux, bien entendu.
Allant jusqu'à effleurer la question du transgendérisme, utilisant occasionnellement l'écriture dite inclusive, l'auteur suggère que la disparition des lecteurs hommes, donc de leur regard sur les écrits en particulier littéraires, est une forte perte pour l'humanité. Le dernier lecteur est-il dès lors une pièce de musée? En achevant son livre d'une manière qui rappelle quelque peu celle du roman "Le Musée de l'Homme" de David Abiker, l'écrivain élargit le débat en (se) demandant si l'homme, représentant mâle du genre humain, n'est pas lui-même obsolète.
Daniel Fohr, L'émouvante et singulière histoire du dernier des lecteurs, Paris, Slatkine & Cie, 2021.
Le site de Daniel Fohr, celui des éditions Slatkine & Cie.
Lu par Francis Richard, Lire la nuit ou pas.
dimanche 7 février 2021
Dimanche poétique 485: Jacqueline Thévoz
samedi 6 février 2021
Jean-Pierre Ohl, un cadavre sous les rails
Jean-Pierre Ohl – Les inconditionnels de la fratrie Brontë connaissent Jean-Pierre Ohl pour sa toute nouvelle biographie des Brontë, sobrement intitulée "Les Brontë" et parue en 2019, et que m'a signalée une lectrice amatrice de cette époque – merci! Deux ans auparavant, il a proposé à ses lecteurs "Le Chemin du Diable", un roman historique de la meilleure eau, campé dans les années 1824 au cœur de l'Angleterre.
En installant le journal de Leonard Vholes, "destiné à personne", en guise de captatio benevolentiae, l'écrivain annonce d'emblée la couleur: il sera question de mystères à multiples fonds, et le lecteur va se sentir privilégié d'y entrer petit à petit. C'est là qu'il place certains éléments qui vont trouver place dans le roman. Cette "main qui écrit", par exemple, ne fait-elle pas écho à la main du Caporal, tranchée lors d'une insurrection populaire survenue à Peterloo, et remplacée par un fort utile tire-bouchon?
Mais c'est lorsque les personnages du roman deviennent davantage que des ombres que le lecteur se met à saliver. L'auteur a en effet le chic pour dessiner un monde d'humains, surtout des hommes, hauts en couleur, à commencer par Edward Bailey, dont le penchant pour le madère finit par constituer un leitmotiv. On aime aussi la construction de son commanditaire, Spalding, dont l'auteur se complaît à illustrer ses problèmes de goutte – avec l'image qui fait mouche à tout coup, conférant à ce noble un caractère soudain dérisoire.
Il est vrai que "Le Chemin du Diable" tient une bonne part de sa saveur à la capacité de l'écrivain de trouver les images qui font mouche: tels yeux seront ainsi comparés à des huîtres, et une peau tendue par une expression apparaîtra telle une barde de lard. Quant au "Chemin du Diable" qui donne son titre au livre, c'est le chemin de fer, rien que ça. Une telle image cristallise les résistances à ce moyen de transport, novateur au début du dix-neuvième siècle. De façon générale, bien sûr, il y a la crainte de pertes d'emploi ou de salaire, vécue par les travailleurs, et aussi les soucis face à un mode de transport perçu comme pathogène. Ces craintes et soucis, l'auteur les personnifie au travers d'un cadavre trouvé au fil du chantier. Il n'en faut pas moins pour jeter l'effroi et lancer une intrigue qui file sur les rails du genre policier.
Ce regard sur les hommes besogneux, affectés à la construction du chemin de fer ou à la mine, l'auteur les observe avec un réalisme zolien, retrouvant leur jargon et retraçant leurs rancœurs face à une révolution industrielle qui ne tient pas toutes ses promesses. A l'autre bout de l'échelle sociale, il y a les possédants, ceux qui se lancent dans l'invention du chemin de fer et des trains à vapeur, à commencer par George Stephenson, et aussi ceux qui se mêlent de politique, pour le meilleur et pour le pire, entre France et Angleterre: la Révolution française n'est pas loin, Waterloo non plus. Et il y a aussi ce monde de poètes – Charles Dickens en tête, jeune encore, apprenant son latin chez un bouquiniste – et de prostituées qui hantent les marges de l'ouvrage et lui donnent sa couleur littéraire, loin de toute froide technique.
Et comme il se doit, c'est en marge de l'inauguration de la première ligne de chemin de fer, entre Stockton et Darlington, que les derniers fils de l'intrigue se dénoueront. Ils sont complexes, passent par une chambre secrète qui s'ouvre par magnétisme et explorent quelques secrets de famille et autres cadavres mis au placard plutôt qu'au caveau. C'est gourmand, c'est dense, parfois même aussi tortueux qu'un tortillard de campagne: au-delà de l'intrigue, manifestement passionné par son sujet, l'auteur réussit à construire un univers à part entière autour d'un des berceaux de la révolution industrielle de la vapeur. De quoi captiver pleinement!
Jean-Pierre Ohl, Le Chemin du Diable, Paris, Gallimard, 2017.
Lu par Albertine, Alexandre Burg, Brontë Divine, Girl Kissed By Fire, Jean-Paul Gavard-Perret, Lilly, Une Ribambelle.
Et pour la petite histoire: les éditions Harlequin ont publié en 1978 un roman portant le même titre. Signé Violet Winspear, il parle sans doute de transports plus amoureux que ferroviaires...