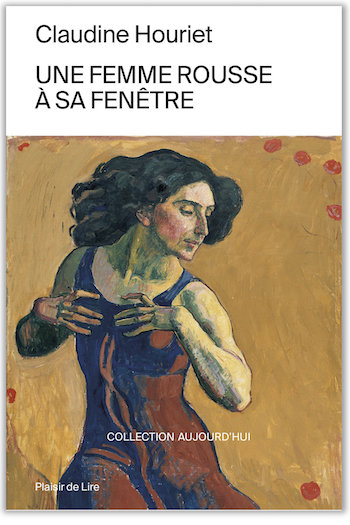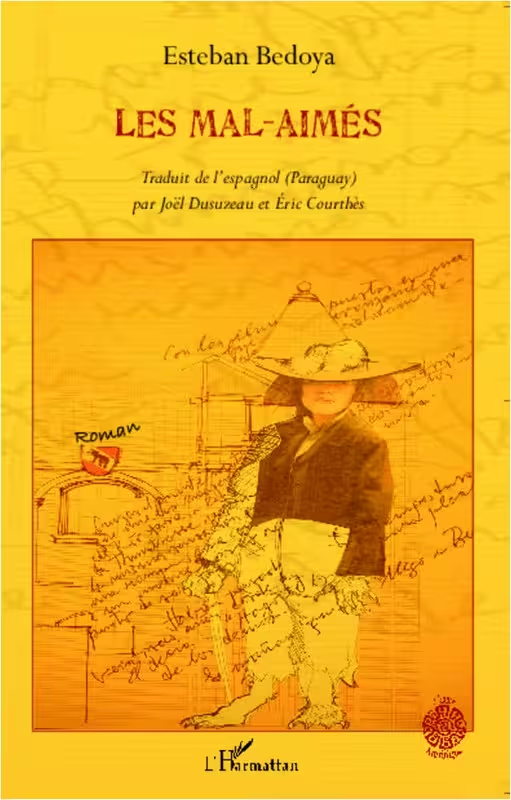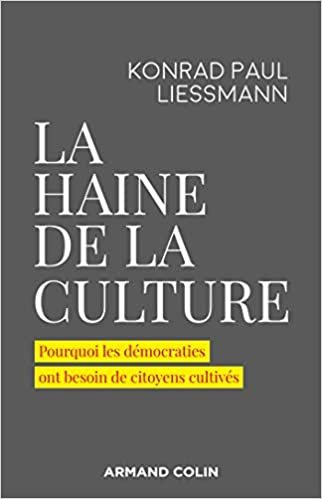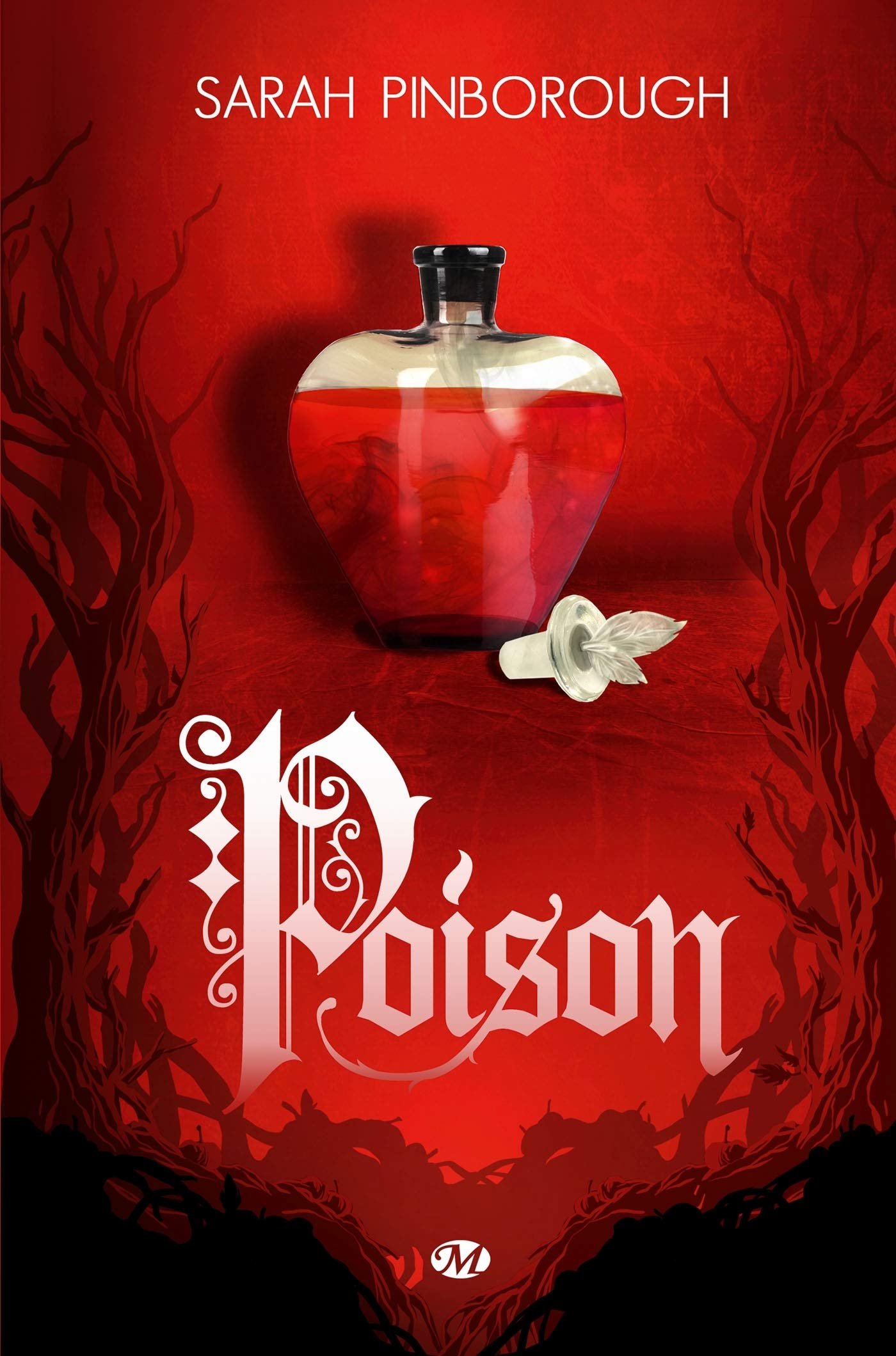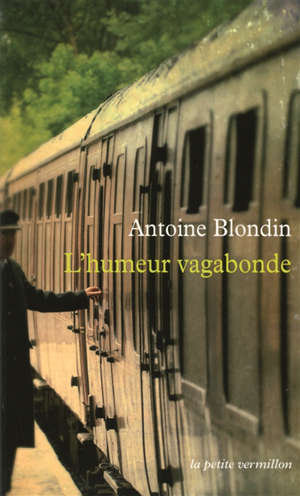Michel Bory – Treize polars en un seul volume! Avec "Les 13 enquêtes du commissaire Perrin", les éditions BSN Press proposent une plongée inédite dans les œuvres les plus marquantes de l'écrivain vaudois Michel Bory. L'éditeur assume le côté "Pléiade" de ce pavé de 1328 pages, et il a bien raison pour l'essentiel: certes, l'appareil critique est minimaliste (juste une préface signée Catherine Dubuis), mais le simple fait d'offrir à la lecture, à la suite, les treize romans policiers qui constituent le cœur de l'œuvre littéraire de Michel Bory permet au lecteur de mesurer un talent, avec ses forces et, surtout, son évolution.
Alors, déjà, parlons d'Alexandre Perrin. L'auteur pensait-il d'emblée à faire de lui un personnage récurrent? Il a en tout cas eu le flair de le faire revenir dans ses ouvrages. "Le barbare et les jonquilles", première enquête, met carrément le brave Perrin dans la situation du suspect. Si l'intrigue peut paraître sommaire, elle recèle tout un univers en gestation: Hugentobler, l'alter ego bernois de Perrin, est déjà là, et c'est sur un conflit que démarre leur amitié indéfectible – écho de l'histoire tourmentée du couple Berne/Vaud, ce dernier ayant été vassal de l'autre, canton suisse de seconde classe, jusqu'à ce que Napoléon Bonaparte vienne mettre tous les cantons suisses sur un pied d'égalité. Son âme damnée, Beck, aussi. Dans ce premier roman, l'écrivain fait de Perrin un amateur de lectures et de culture – ce qui sera oublié plus tard. Enfin, l'écrivain campe ici d'emblée un policier humain, marié à Anne Perrin et capable – on est tous comme ça – de mensonges et de cachotteries.
Au fil des enquêtes, les intrigues gagnent en épaisseur, pour le plaisir du lecteur. Une constante: l'écrivain s'inspire toujours de l'actualité et des personnages qui la façonnent, de façon anecdotique ou cruciale. "Bienvenue à New Hong Kong" évoque ainsi la question du bradage du territoire national suisse à des puissances financières étrangères. L'auteur va jusqu'à évoquer "L'assassinat du président Bush". Il y sera question du Réarmement moral, toujours basé à Caux, sur les hauts de Montreux. Et aussi de George W. Bush: ce roman a paru à un moment où plus d'un observateur aurait apprécié de voir ce bonhomme dégager le terrain.
Si l'actualité marque les intrigues, celles-ci sont aussi empreintes d'un ancrage local rigoureusement marqué. Encore une fois, c'est "Le barbare et les jonquilles" qui fait figure de marqueur initial: gageons que l'auteur est allé voir sur place comment on peut tenter un homicide depuis la tour de la cathédrale de Lausanne, là où crie le guet – un certain Philippe Becquelin, connu des amateurs de dessin de presse sous le nom de Mix & Remix, que l'auteur cite aimablement. Bien sûr, il y a aussi les bistrots, tiers lieux que l'auteur exploite à fond, y compris en suggérant que le très bernois Hugentobler, dit Jumbo en raison d'un physique mammouth, profite de ses sorties dans le canton de Vaud pour faire ripaille. Et Lausanne n'est pas la seule ville vedette des intrigues d'Alexandre Perrin: "Un cadavre au grand-air" trouve place à Moudon, et l'enquêteur va se retrouver du côté de Grandson pour suivre une pittoresque histoire de sécession.
Et il y a un truc dans ces enquêtes d'Alexandre Perrin: en lisant ces histoires, on le voit vieillir. Un choix parfaitement assumé par l'écrivain: c'est comme si tout commençait par "Le barbare et les jonquilles", récit où le bonhomme doit prouver qu'il est impeccable, et s'achevait avec, d'une part, "Sécession à Grandson", qui retrace la mission officieuse d'un jeune retraité, et d'autre part, "L'affaire du buste assassin", relatée pour une fois à la première personne, où Perrin se souvient parce qu'il a l'âge de le faire. Aspect important: Alexandre Perrin fait carrière, passe d'un service à l'autre. Passant ainsi des affaires criminelles aux affaires financières, il offre au lecteur le plaisir d'enquêtes diversifiées.
On ne saurait évoquer l'inspecteur Alexandre Perrin sans parler de sa femme, Anne, et de la relation qu'il entretient avec elle. L'amour est toujours là, bien sûr, bourré de complicité, et l'auteur ne se gêne pas de jouer la carte de la sensualité conjugale. Mais cette relation n'est pas exempt de méandres. Alexandre Perrin exploite parfois son épouse dans ses enquêtes, peine de temps à autre à lui faire comprendre que si borderline que soit son action, elle est correcte et légitime ("L'inavouable secret du commissaire Perrin"). Adultère? Tant mieux pour le lecteur: ni Anne ni Alexandre ne sont de bois, mais c'est bien Alexandre qui cède au charme d'une collègue, Virginie Garin (qui, soit dit en passant, porte le même nom qu'une journaliste radio sur RTL – un hasard, sans doute...).
Côté contexte, on pourrait encore évoquer longuement cette constante qui est celle de la navigation, évidente pour un personnage qui évolue sur les rives du Léman. La navigation permet à l'auteur de prendre ses distances avec le canton de Vaud, par exemple dans "L'inspecteur Perrin va en bateau", astucieuse intrigue qui va jusqu'aux Pays-Bas sur la piste d'un coopérant du CICR – un CICR refera surface dans "Les mensonges de l'inspecteur Perrin". Ecluses et canaux sont là; ils reviendront dans "Perrin creuse le canal du Rhône au Rhin" (un titre long mais pas du tout trompeur!) ou dans "Sécession à Grandson".
Peut-on dès lors lire les romans mettant en scène le commissaire Perrin de façon indépendante? Oui, et on peut y trouver du plaisir. Cela dit, je me souviens d'avoir lu "L'assassinat du président Bush" isolément à sa sortie, et d'avoir eu l'impression qu'il y manquait quelque chose, malgré une structure adroite. En le lisant en contexte, j'ai compris qu'on était vraiment dans une saga où la satisfaction du lecteur est nettement supérieure s'il suit vraiment le personnage de roman en roman. Cette impression est accentuée par certains textes, proposés dans "Le 13 enquêtes du commissaire Perrin", qui font figure de récits de transition plus courts. On pense en particulier à "D'un blanc douteux" ou à "L'inavouable secret du commissaire Perrin". Accentuée, elle l'est aussi, surtout dans les derniers opus, par la récurrence des personnages. Ainsi, Winter, le gourou de secte manchot qui apparaît dans "Perrin a peur dans le noir" va hanter tous les romans qui suivront. Cela vaut d'ailleurs aussi pour des personnages plus anecdotiques, tels que Vazyriadis, derrière lequel il est permis de voir le politicien vaudois Josef Zisiyadis – une récurrence à la Balzac, pour le coup.
Lire "Les 13 enquêtes du commissaire Perrin", c'est donc suivre toute la vie d'un flic, avec ses succès, ses échecs, ses enquêtes qui ne se terminent pas tout à fait comme on le voudrait. Perrin, c'est un flic vaudois, normal, qui prend de l'âge et de la bouteille, que l'auteur montre avec ses qualités et ses défauts, ses méthodes parfois astucieuses et hors norme sans jamais bousculer l'ordre établi avec trop de vigueur. Alexandre Perrin, c'est aussi un bonhomme qui n'oublie jamais l'humain lorsqu'il parle à quelqu'un, même s'il n'en pense pas moins. C'est encore un gars qui a une femme, un chalet, des enfants qu'on voit grandir en arrière-plan, des options de carrière, des vacances sans cesse gâchées par des relances professionnelles qu'il essaie désespérément de concilier avec une existence normale. Bref, loin du flic surhomme essoufflé après une enquête, Alexandre Perrin est avant tout, plus que d'autres, un citoyen comme vous et moi, qui s'offre même le luxe de parler vaudois à l'occasion. Ce qui le rend infiniment adorable et attachant.
Michel Bory, Les 13 enquêtes du commissaire Perrin, Lausanne, BSN Press, 2021.
Le site des éditions BSN Press.
Lu dans le cadre du Défi des Mille.