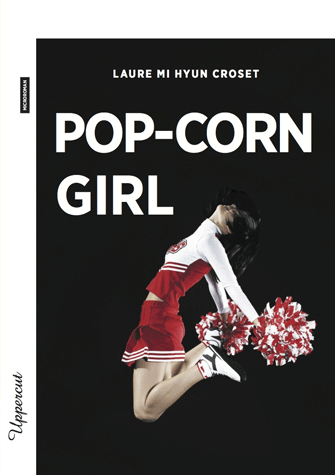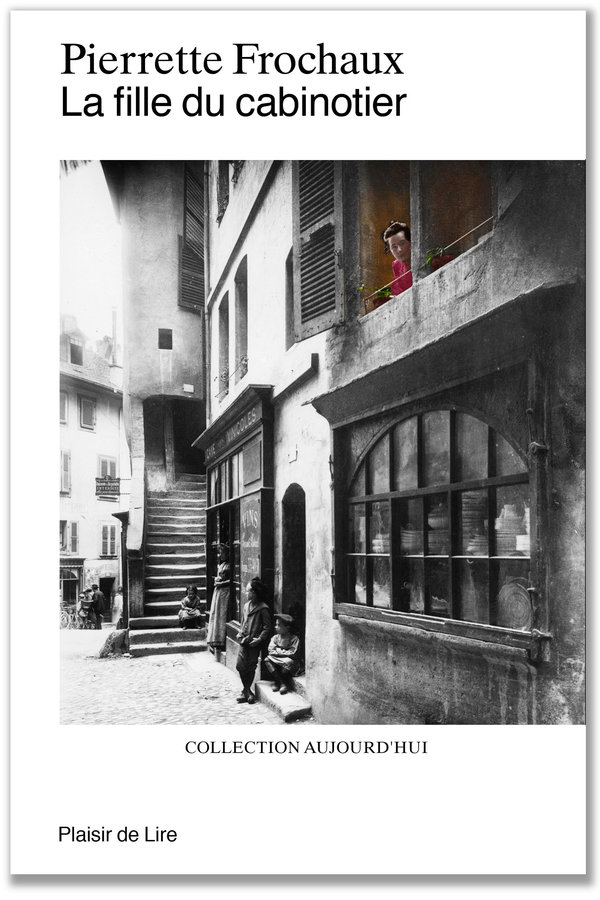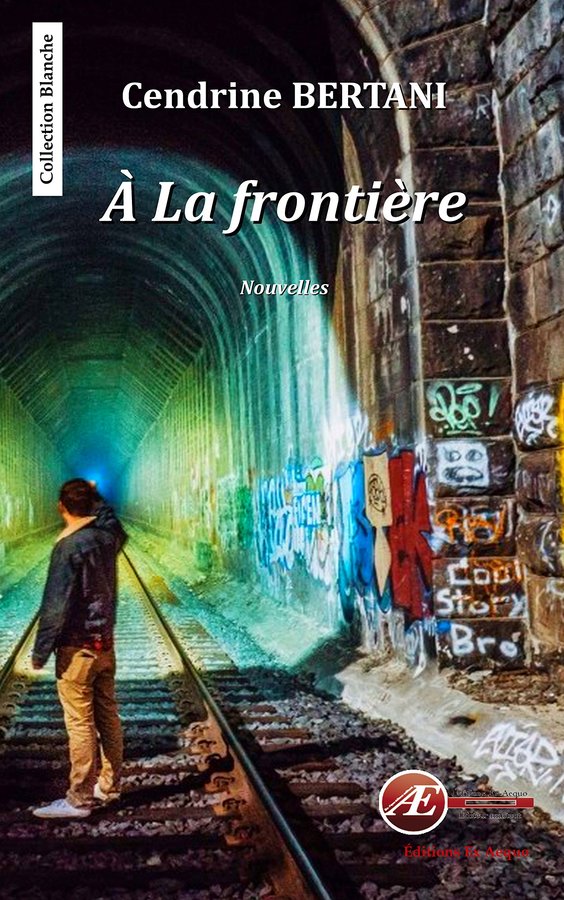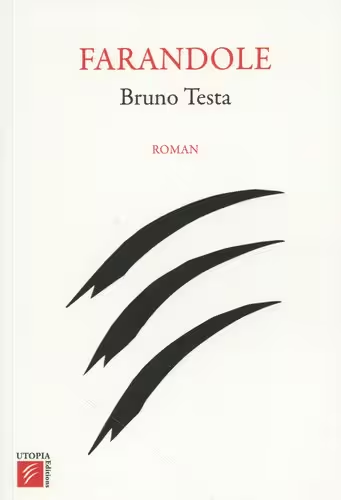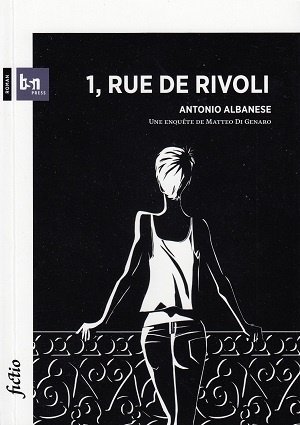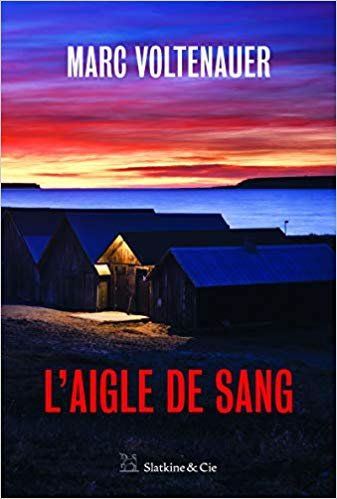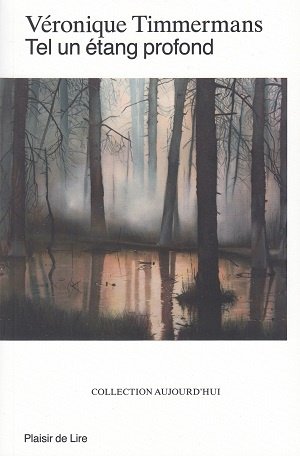
Véronique Timmermans – Perdre un être cher et apprendre à vivre avec l'absence. Telle est la trame de "Tel un étang profond", le tout dernier roman doux-amer de Véronique Timmermans. Le lecteur y est invité à suivre le personnage d'Elise, jeune femme complexe comme nous le sommes tous, au travers de son parcours de survivante. Un parcours à la ligne claire, après un début trouble qui, situé en novembre 2000, reflète l'ignorance, le flou, l'incrédulité face à la terrible perte accidentelle d'Yves, son compagnon.
On trouve l'image clé qui donne son titre au roman en page 84, l'étang profond étant celui des yeux d'Elise pour Julian, son médecin, devenu son amant. Judicieuse, l'image entre en résonance avec les constantes évocations forestières du roman, où il sera question de promenades en forêt, de bûcherons et de pézizes orangées qui donnent au récit quelques notes vives – la dernière de ces notes colorées concluant l'ouvrage de façon violente, précisément en forêt.
Point d'éclats par ailleurs dans ce roman à la tonalité calme qui dessine presque dix ans d'une vie apparemment ordinaire, en effet. Ces dix ans sont narrés à la manière d'un faux journal à quatre mains, daté comme il se doit. Il donne tour à tour la parole à Elise, bien sûr, et à son médecin, Julian, qui deviendra son nouveau compagnon. Deux personnages que la vie a rapprochés, mais que l'auteure prend soin de rendre différents l'un de l'autre.
Le personnage d'Elise se place du côté de l'introspection, une introspection qui fait écho aux événements de la vie quotidienne, impactés par l'omniprésence paradoxale de l'absent auquel elle pense constamment: une rencontre, une couleur, une odeur l'y ramènent, de même que les liens privilégiés qu'elle a conservés avec les parents d'Yves. Les rêves eux-mêmes s'en mêlent! L'auteure a le chic pour rendre ces réminiscences naturelles, sans lourdeurs, sans obsession.
Quant à Julian, s'il s'avère un amoureux sincère, il fait figure de pièce rapportée qui compose avec son vécu et ses aspirations. S'il a des amis, c'est avant tout un personnage foncièrement solitaire, qui aime boire sa bière seul, sans être dérangé, que ce soit à l'opéra ou dans un bar. Amant sincère d'Elise, époux puis père attentif de leurs enfants, il trace sa route, optimiste, en particulier en acceptant un poste prestigieux à Boston, ouvrant la porte aux aléas des amours à distance.
Que font-ils ensemble? La relation entre Elise la traumatisée et Julian le médecin s'avère tortueuse, avec des velléités de séparations et le besoin des retrouvailles. Mais l'auteure ne juge pas, laissant leurs points de vue aux personnages, dans une rédaction distancée à la troisième personne. Roman du deuil, roman faussement apaisé, "Tel un étang profond", en illustrant les élans et les intermittences du cœur, est aussi le livre de la difficulté à s'attacher à nouveau, alors que la personne d'Yves se dessine en creux à chaque tournant. Peut-on lui survivre? Situé le 8 septembre 2009, le tout premier chapitre de "Tel un étang profond" pose la question, résonnant avec le dernier chapitre et faisant de ce roman le récit d'une tentative, d'une boucle de vie.
Véronique Timmermans, Tel un étang profond, Lausanne Plaisir de lire, 2019.
Le site des éditions Plaisir de lire, celui de Véronique Timmermans.
Lu par Francis Richard.