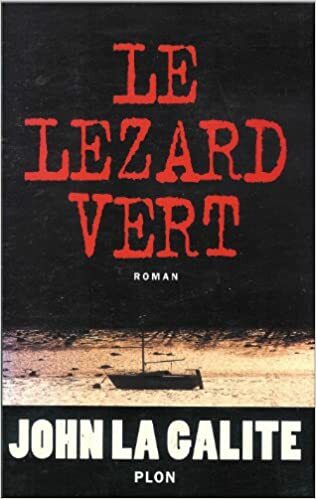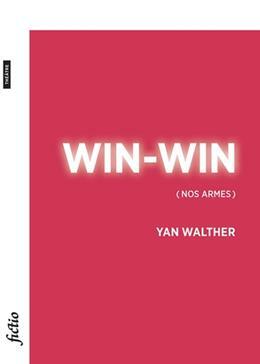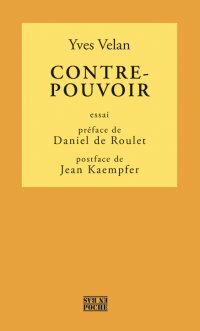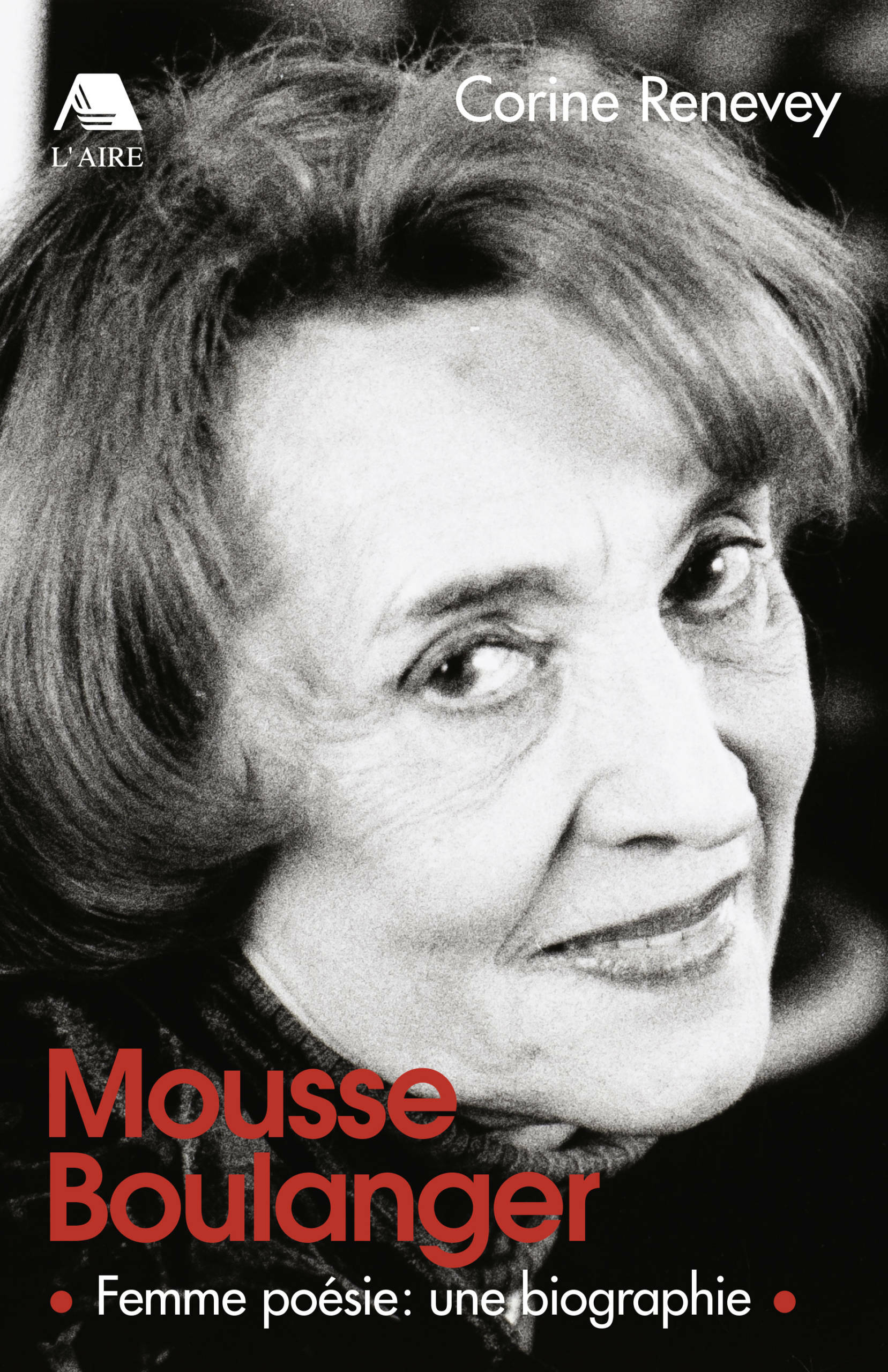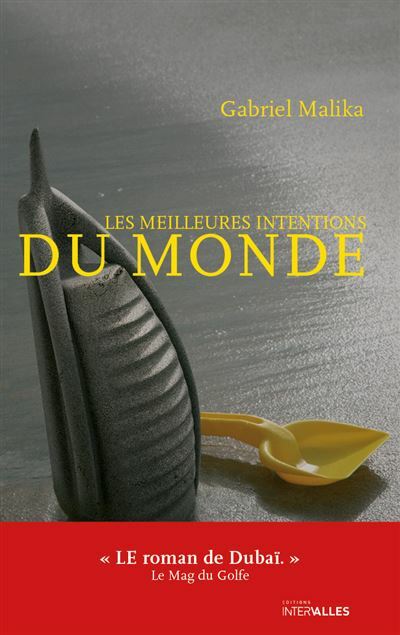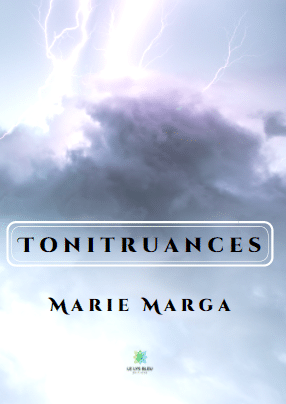John La Galite – Aujourd'hui passé à l'auto-édition, l'écrivain John La Galite a fait paraître ses premiers romans chez Plon. C'est là, en particulier, que voit le jour son tout premier opus, "Le Lézard vert". Il s'agit d'un thriller à l'américaine qui, paru en 1997, flatte le goût du lecteur pour l'exotisme en situant son intrigue en Californie et dans les îles avoisinantes.
Voyons comment ça commence... le lecteur suit Wayne, un homme jeune au parcours familial un peu compliqué: c'est un enfant pas vraiment désiré, vite orphelin de père et constamment tenu à l'écart par sa mère, dont l'obsession est de faire carrière à Hollywood. Lorsque sa mère meurt à son tour, trop tôt bien sûr, il hérite d'une fortune qui fait de lui une sorte d'héritier désœuvré qui navigue sur la côte Ouest des Etats-Unis et baise mollement les femmes qui se présentent à lui. Tout bascule lorsqu'il choisit d'acheter un bateau à voile et de sillonner les mers avec Lisa, qui l'initie à la cocaïne. Quel est le mystère du "Gallant Lady", précédemment "Nijinski"?
Structurée en trois parties, la construction du roman est astucieuse. L'auteur enchâsse en effet, au cœur de son propos, le récit des cahiers de bord retrouvés sur le navire – sauvé d'un naufrage dû à un ouragan puis renfloué. Le lecteur est alors plongé dans un autre univers, dessiné par les manuscrits trouvés à bord: celui d'une équipe de gens plus ou moins artistes qui font une croisière entre plus ou moins amis. Ainsi se dessine l'histoire du navire qui sert de décor pour l'essentiel du roman. Il y a du fric là-dedans, pas moins de 50 millions de dollars à se partager, et aussi beaucoup de drogue et d'alcool. Et un certain Shylock, qui exige sa livre de chair... Comme ces manuscrits ne donnent pas la clé de l'intrigue, Lisa, qui les a découverts, va se montrer curieuse pour démêler les fils – c'est tout l'enjeu de la troisième partie, qui fait figure de retour dans le monde réel après une partie médiane hallucinée.
Il est frappant de relever que l'auteur soigne le traitement de cet élément de décor qu'est le bateau, allant jusqu'à lui donner une histoire inquiétante. C'est un lieu hanté, dont le passé en fait une embarcation maudite: celles et ceux qui l'empruntent pour naviguer sont-ils condamnés à mourir? Quant à changer de nom, c'est, pour un bateau, changer de masque. Mais l'embarcation reste la même, avec son âme. L'auteur souligne enfin le côté énigmatique du voilier en y installant un chat borgne et bizarre, El Greco. Ce nom fait référence à l'artiste, bien sûr – et l'auteur mobilise du reste les références littéraires et culturelles pour donner de l'étoffe à son histoire et faire rêver le lecteur. On pense à Shakespeare avec l'insaisissable Shylock, ou à l'imaginaire qui naît des vaisseaux fantômes façon Wagner.
Le lecteur aurait certes aimé des personnages parfois un peu plus typés (qui est Wynona, qui est Rachel? On les confond un peu, même si l'une des deux sera plus mémorable en définitive) et un rythme encore plus vif, plus percutant – même si l'auteur, accélérant l'alternance de points de vue tout à la fin du récit, est conscient de la question et crée une illusion réussie de sprint final. Est-ce pour autant un roman devenu fade, à une génération de distance? Certes non. L'auteur ficelle parfaitement son intrigue, la mène avec sérieux, y insère son lot de retournements de situation surprenants, et a l'art d'y glisser parfois des histoires qui tiennent le lecteur en haleine, quitte à se laisser entraîner dans des mystifications malicieuses. Celle du "Lézard vert" éponyme, par exemple. Qu'est-ce que c'est que ce McGuffin? C'est à découvrir dans le premier roman de John La Galite.
John La Galite, Le Lézard vert, Paris, Plon, 1997.
Le site de John La Galite.