Alain Clavien – Comment la presse suisse se finance-t-elle? Voilà une question sur laquelle la presse nationale elle-même s'avère plutôt discrète. Ce monde souterrain de gros sous, l'historien Alain Clavien, spécialiste des médias, a choisi de l'explorer. Il en résulte la foisonnante étude "L'argent de la presse suisse", parue tout dernièrement. Et si l'ouvrage est sous-titré "Les années Publicitas", c'est parce que Publicitas, agence de publicité dominante en Suisse au cours du vingtième siècle, a marqué toute la période sous revue, entre 1890 et 1990.
Le premier chapitre plante le décor et s'avère instructif dans la mesure où il explique le fonctionnement des "fermiers d'annonces": ce sont des agences qui louent des pages de journaux, par exemple une sur une feuille de quatre pages, charge à elle de la remplir d'annonces diverses et variées et d'en tirer profit. Le modèle se développe à mesure qu'émerge une société de consommation qui implique de vendre des produits, voire des marques. Pour les journaux, c'est pratique, du moins au début: plus besoin de prospecteur.
Ce modèle permet aussi une mutation du paysage journalistique suisse, qui passe d'un modèle de feuilles d'avis partisanes portées par des gens de conviction prêts à accepter des déficits à des structures professionnelles de type "société anonyme", non orientées politiquement, poussées à la croissance et au bénéfice, ne serait-ce que pour rétribuer les actionnaires. Ainsi, relève l'auteur, le journal, en l'absence de subventions d'État, est vendu deux fois: une fois aux fermiers d'annonces, une fois au lectorat – qui, grâce à la publicité, paie son journal moins cher.
L'auteur utilise le fermier d'annonces Publicitas comme fil rouge de son ouvrage et suit, jusqu'au bout, les archives disponibles et accessibles. On les découvre riches, malgré quelques lacunes; elles mettent au jour un monde où l'on cultive le secret. Les éditeurs de journaux ont ainsi l'interdiction de discuter entre eux des conditions d'un contrat avec l'agence de publicité; ces contrats, quant à eux, ne brillent pas par leur transparence: les éditeurs ne savent rien du chiffre d'affaires de Publicitas (non publié pendant longtemps), et Publicitas ne peut qu'estimer le tirage d'un journal, à défaut, longtemps, d'un décompte officiel contrôlé – ce sera le rôle de la REMP, fondée en 1964.
La position de Publicitas va évoluer au fil des années. L'auteur va montrer comment elle va prendre influence directement dans les journaux auxquels elle fournit des réclames, au risque de compromettre la liberté de la presse. L'auteur donne quelques exemples de la puissance des annonceurs, capables de retirer leurs billes dès qu'un article leur déplaît. Le jeu des rapports de force va se révéler plus favorable aux éditeurs dans la seconde moitié du vingtième siècle, lorsque l'annoncer aura besoin des titres de presse pour exister, alors que le marché des annonces, mûr, devient plus difficile et moins lucratif – et que les journaux, par le jeu des concentrations et de la constitution de groupes de presse, sont en mesure de peser sur leur partenaire en matière de réclames, ne serait-ce que par la menace de créer leur propre régie publicitaire.
L'auteur va jusqu'à évoquer les tentatives de publications gratuites en Suisse: les tentatives ont été nombreuses, mais aujourd'hui, seul survit, sur papier pour quelques mois encore, le "20 minutes" dans ses déclinaisons en français, allemand et italien. Mettant à part le destin de Publicitas (qui fera faillite en 2018, mais une partie de ses archives demeure sous embargo aujourd'hui), l'auteur esquisse les tendances actuelles, avec la fuite de l'argent des annonces vers les supports en ligne après avoir fait les beaux jours de la radio et de la télévision: pour lui, le modèle du "journal vendu deux fois", dominant tout au long du vingtième siècle, est en déclin. Cela tombe mal, à l'heure où, l'auteur le mentionne aussi, le lectorat n'est plus disposé à payer pour s'informer: il y a été habitué, et se contente aujourd'hui assez bien des gros titres sur Internet.
Gros acteurs et gros sous: c'est ce dont il sera question dans cet ouvrage, bien plus que de journalistes marquants ou de scoops à l'impact historique. Au-delà d'une relation qui expose que les acteurs de la presse jouent le jeu du capitalisme, l'auteur signale aussi les débats sur le caractère spécifique du domaine de la presse, et notamment sur son rôle, pris très au sérieux en Suisse, dans le fonctionnement démocratique du pays: pas de démocratie sans information de qualité.
Alain Clavien, L'argent de la presse suisse, Neuchâtel, Livreo-Alphil/Les routes de l'histoire, 2025.
Le site des éditions Livreo-Alphil.
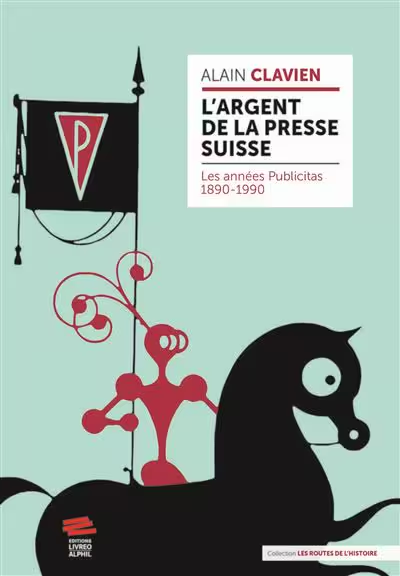

En France, l'information est aux mains de milliardaires et, en Suisse, c'est très différent tout étant pareil, en fait.
RépondreSupprimerTrès intéressant. Merci.
Denis.
Merci de votre passage, Denis! Peut-être que la différence réside essentiellement dans les aides de l'Etat à la presse? De tels soutiens ont été rejetés en 2022 par le peuple suisse, laissant la presse se débrouiller pour ainsi dire seule. L'avenir dira ce qu'il en sera des bons vieux journaux... Je vous souhaite un bon dimanche!
SupprimerAh, et c'est un élément que j'ai oublié de mentionner dans ce billet: le livre parle des financements privés de la presse et des médias suisses, et n'évoque pas les possibles soutiens publics dont elle peut bénéficier (conditions spéciales d'envoi des journaux, redevance radio et tv, etc.).
Supprimer