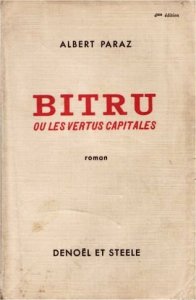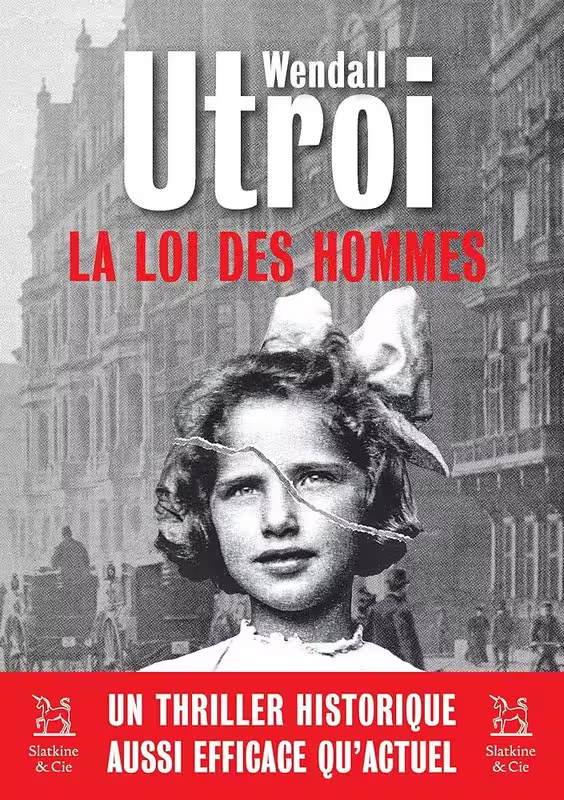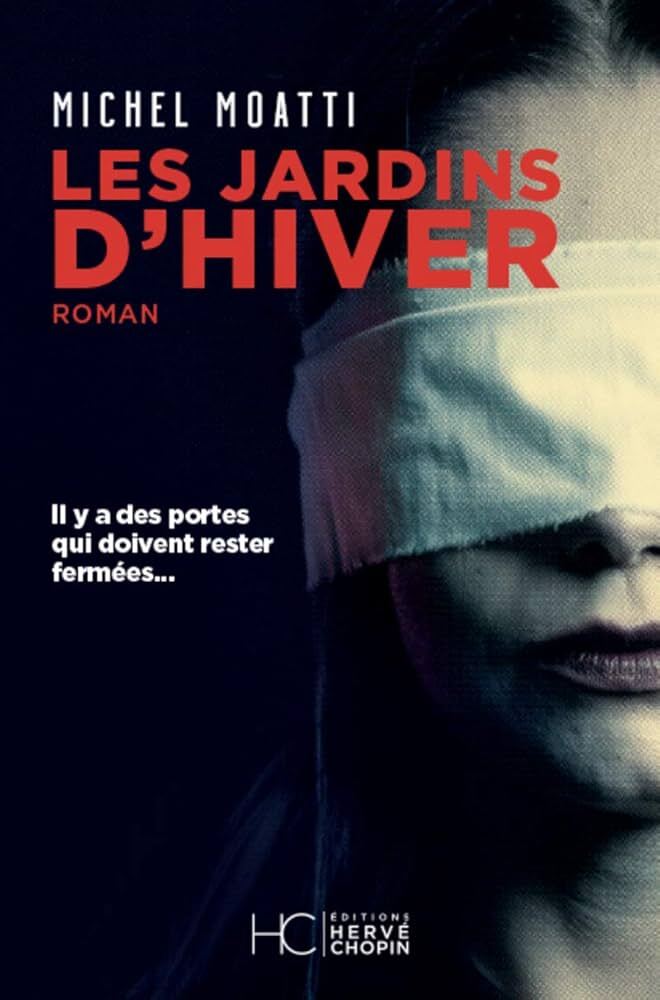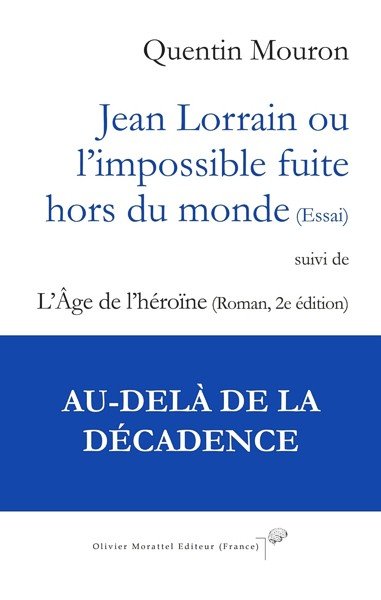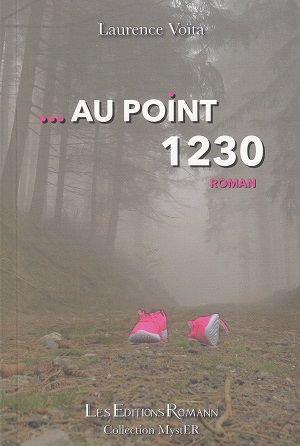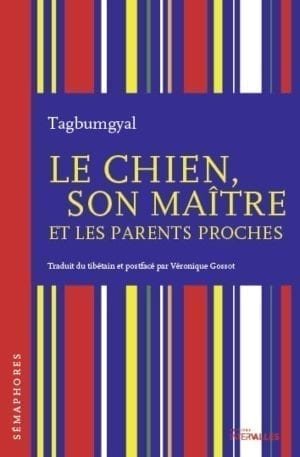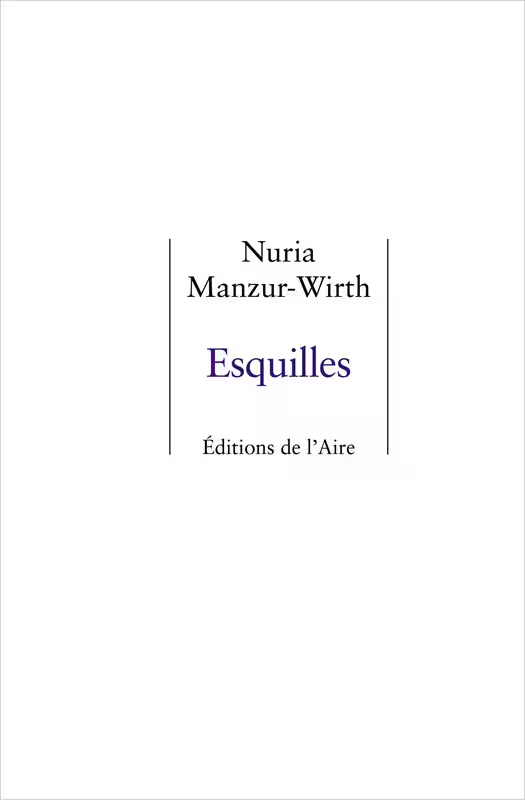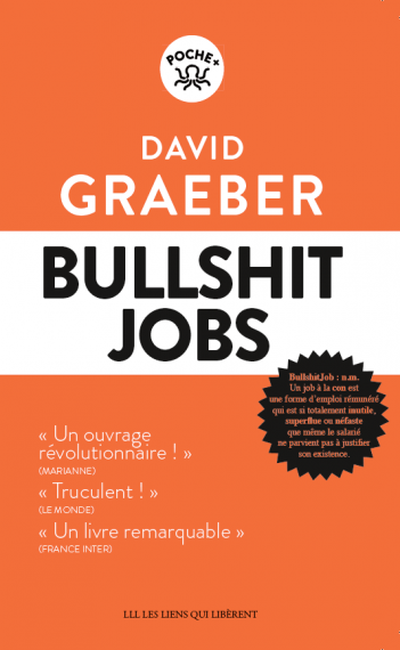samedi 31 octobre 2020
Fringale et ripailles à l'Arche de Noé: Bitru est de retour
vendredi 30 octobre 2020
Ce diable d'homme nommé Bitru
jeudi 29 octobre 2020
Une intrigue policière qui ne manque pas de sel, avec Marc Voltenauer
Marc Voltenauer – Et voici une intrigue policière qui ne manque pas de sel! Le titre du roman «Les protégés de Sainte Kinga», quatrième opus du romancier suisse Marc Voltenauer, évoque le monde de la mine à travers les Salines de Bex, décrivant avec minutie une prise d'otages étonnante. Autant dire qu'Andreas Auer, policier récurrent des récits de l'auteur, a du pain sur la planche, et que son équipe va être au taquet pendant plus de 50 heures.
Les premières pages de ce roman pourront paraître un peu longues et didactiques au lecteur avide de rythme: l'auteur y prend en effet le temps de présenter le site des Salines de Bex et de rappeler telle ou telle légende qui les entoure, à l'instar de celle de Jean Bouillet, dit «Bracaillon». C'est pourtant dès ce début que l'auteur installe le motif de l'imaginaire du sel, constamment présent tout au long du livre. Cela, même s'il se fait discret pour laisser à l'intrigue la place qui lui revient de droit.
L'intrigue elle-même met en scène un preneur d'otage improbable, grimé en Charlot, qui joue son rôle jusqu'à être muet: il communique par écrit via sa tablette avec le négociateur de la police cantonale vaudoise, Bakary. Est-il seul? Quelles sont ses motivations? Ont-elles un lien avec les otages? Ceux-ci paraissent pour le moins hétéroclites: il y a là du personnel, une classe d'école et six membres d'un groupuscule d'extrême-droite. L'auteur jongle en virtuose avec ce petit monde, menant de front un propos qui fait alterner justice historique, lutte contre l'homophobie et recherche d'argent.
Le titre «Les protégés de Sainte Kinga» fait référence à la sainte patronne des mineurs, vénérée en Pologne, un pays qui joue son rôle dans l'intrigue. Il est à relever qu'un des personnages se nomme également Kinga, comme en écho: en sa qualité de jeune équipière d'Andreas Auer, c'est en quelque sorte sous sa protection que les otages pris au piège dans la mine se trouvent. La présence d'une sainte dans le titre fait en outre référence à quelques allusions religieuses, présentes tout au long du roman – et la Fraternité sacerdotale Saint Pie X n'est que l'une d'entre elles.
On aurait pu craindre, en lisant le début de cet ample roman, une intrigue manichéenne où un gentil gauchiste vient mater les méchants fascistes. Il n'en est rien: en mettant en scène un preneur d'otage exalté, l'auteur interroge les limites de ce que l'on est en droit de faire pour rétablir la justice telle qu'on la conçoit. Peut-on aller jusqu'à faire justice soi-même, à tuer, à passer en somme du côté obscur? Ce questionnement affleure de temps à autre, par exemple au moment de l'amère dernière page, ou par le biais des commentaires de la prise d'otage publiés sur les réseaux sociaux – ceux-ci sont en effet très vite au courant, par la grâce d'une presse aux aguets.
Foisonnant, tendu dès lors qu'il entre dans le vif de son sujet, le quatrième roman mettant en scène Andreas Auer offre également un éclairage précis du fonctionnement de la police cantonale vaudoise en cas de situation exceptionnelle. Les aspects techniques et procéduraux sont détaillés avec rigueur, mais l'auteur n'oublie pas l'état d'esprit de ses personnages, tous empreints d'une profondeur qui les rend humains, palpables, qu'ils soient anges ou démons... ou les deux.
Et comme l'écrivain n'oublie pas ses amis et collègues en écriture, il va jusqu'à indiquer que l'un de ses personnages a lu tous les romans de Nicolas Feuz. Un clin d'œil amical en retour: dans «L'engrenage du mal», son dernier roman paru il y a quelques mois, l'auteur neuchâtelois Nicolas Feuz a lui-même placé un roman qui a lu tous les romans de Marc Voltenauer...
Marc Voltenauer, Les protégés de Sainte Kinga, Genève, Slatkine & Cie, 2020.
Le site de Marc Voltenauer, celui des éditions Slatkine & Cie.
Lu par Badgeekette, Catherine, MHF, Ogrimoire, Real Potato Geek, Sam.
dimanche 25 octobre 2020
Dimanche poétique 468: Louis Veuillot
jeudi 22 octobre 2020
Wendall Utroi, quand la noirceur des bas-fonds londoniens résonne avec l'actualité
Wendall Utroi – L'ambiance est au thriller historique: le lecteur de "La loi des hommes" de Wendall Utroi est invité à plonger dans le Londres du temps de Jack l'Eventreur, marqué par une misère noire qui a laissé émerger un secteur d'activité économique sordide et impitoyable: la prostitution.
Citer Jack l'Eventreur, c'est fixer la période. Mais l'auteur suit la piste d'un autre scandale, celui de Cleveland Street, tout aussi véridique. Dans le rôle des victimes, il y a de jeunes garçons officiellement employés des Postes. Du côté des consommateurs, des hommes de la haute société, désireux d'assouvir des instincts homosexuels que la loi d'alors réprouve. Pour donner une idée du niveau, un seul nom: le Duc de Clarence.
L'auteur construit dès lors son intrigue sur la base d'un personnage imaginaire, Wallace Hardwell, chargé d'enquêter dans le plus grand secret afin d'étouffer le scandale. Lui-même ne sait rien des tenants et des aboutissants de son enquête. En guise d'éléments à étudier, seuls lui sont livrés trois témoins, deux femmes et un homme – qui tous ont trouvé leur compte dans le monde de la prostitution, dans ce qu'il a de plus sordide, dans le cadre d'une forme de "Loi des hommes", justement.
C'est là qu'intervient le talent de l'écrivain. Le roman est en grande partie construit sur la base des interrogatoires que Wallace Hardwell effectue auprès de ces personnes dans les locaux de Scotland Yard. Le romancier reconstruit ces interrogatoires de façon crédible et fine, jusque dans leurs ambiances: c'est au rythme de ceux-ci que le lecteur découvre l'intrigue, peu à peu, parfois dans un désordre apparent. Omniprésents, ces dialogues font passer l'enquêteur pour un véritable maïeuticien, capable de faire naître la vérité en faisant parler ses interlocuteurs.
Si Wallace Hardwell est un habile inspecteur, il est aussi marqué par une certaine naïveté. L'enquête va donc l'amener dans des méandres qui le révoltent à titre personnel. Il y a la tentation de la torture, à laquelle certains de ses collègues policiers cèdent plus facilement que lui. Mais il y a aussi, pour lui et pour le lecteur, la découverte d'un univers à la noirceur insoupçonnée.
Le lecteur pourrait penser que tout cela est du passé, et qu'en France en tout cas, on a passé le temps des élevages de vierges, des certificats de virginité et des prostituées de même pas treize ans. Vraiment? Romancier historique, l'écrivain ne manque pas d'ancrer son récit dans l'actualité de notre début de vingt et unième siècle. Il le fait à travers le biais de Jacques, cantonnier en son village près de Dunkerque: dans le cadre de son activité d'entretien du cimetière, c'est lui qui a découvert le témoignage de Wallace Hardwell, qui a pris la forme d'un manuscrit enterré à ses côtés.
Et en fin de roman, il évoque la révolte de Jacques face à une législation française qui ne fixe pas d'âge de majorité sexuelle et ce, depuis 1980. Si le dernier chapitre peut dès lors paraître didactique, il réussit à mettre en perspective une situation paradoxale, à l'exemple de l'affaire Sarah, de Pontoise, supposée consentante à 11 ans – c'était en 2018: les mineurs français de notre temps sont-ils mieux protégés contre les agressions sexuelles de toute sorte que leurs ancêtres anglais de l'époque qui a suivi le scandale de Cleveland Street?
En une fresque sociale historique à la Charles Dickens qui se lit tout seule et raconte l'enquête d'une vie, l'écrivain Wendall Utroi fait donc coup double: il révèle un scandale un peu oublié qui s'est produit au dix-neuvième siècle du côté de Londres, et souligne de manière à la fois évidente et inattendue tout ce qu'il conserve d'actualité en ce début de vingt et unième siècle.
Wendall Utroi, La loi des hommes, Genève, Slatkine & Cie, 2020.
Le site de Wendall Utroi, celui des éditions Slatkine.
Lu par Francis Richard, Ingrid Fasquelle.
lundi 19 octobre 2020
Michel Moatti: biographe, qui es-tu?
Michel Moatti – Qui est vraiment l'écrivain Jorge Neuman? Mathieu Ermine, un jeune homme français exerçant les fonctions de bibliothécaire à Buenos Aires le prend en autostop durant les années de dictature militaire en Argentine. Visiblement en état de choc, il lui confie ses papiers puis, après une nouvelle entrevue, disparaît avec une bonne part de son secrets. Des secrets que Mathieu Ermine prétend percer. C'est là-dessus que commence "Les jardins d'hiver", dernier roman de Michel Moatti.
Présentant Mathieu Ermine comme un thésard et un biographe, l'écrivain pose dans "Les jardins d'hiver" la question de la véracité de toute transcription de vie par un tiers. Revenu à Paris, Mathieu Ermine apparaît en effet comme fier de ses travaux: il a réussi sa thèse, et sa biographie de Jorge Neuman se vend bien.
Mais ce succès n'est pas exempt de fragilités. Le romancier met en effet en scène une série de personnages qui remettent en question la qualité de son étude. Biographe d'un tiers, devient-on dès lors menteur, même lorsqu'on a toutes les cartes en main? En tout cas, ceux qui mettent Mathieu Ermine à l'épreuve ont des raisons de le faire: certains sont présentés comme des proches de l'écrivain disparu, d'autres ont une autorité académique. Certains d'entre eux ont même connu plus longuement l'écrivain, et seraient donc plus autorisés à en parler.
Mis en contact avec la diaspora argentine à Paris, Mathieu Ermine va être ainsi poussé à éclairer les zones d'ombre qu'il a laissées dans son travail de recherche. On le sent vulnérable, conscient d'être passé à côté de pas mal de choses qu'il avait pourtant sous la main: tel élément consigné dans les papiers de Neuman lui paraissent par exemple trop personnels pour être rendus publics, si cruciaux qu'ils soient.
Cela débouche sur quelques scènes troublantes, par exemple lorsqu'il écoute avec Claudia le tortionnaire Vidal à travers les murs d'un appartement parisien. Mais force est de relever que la narration, alternant le point de vue de Mathieu Ermine, des extraits dactylographiés des documents de Jorge Neuman et des témoignages de tiers recueillis lors de procès, n'est pas exempte de longueurs: sans perdre en sobriété, ces différents points de vue auraient pu être mieux profilés dans leur tonalité, notamment celui de Neuman.
Reste que le romancier argentin apparaît comme la victime d'un régime dictatorial cruel; sa fille et son épouse en font aussi les frais. Au-delà de l'histoire d'un écrivain imaginaire créé pour les besoins de l'intrigue à partir d'auteurs ayant réellement existé, cependant, l'intérêt des "Jardins d'hiver" réside dans la représentation réaliste et glaçante qu'il donne de la période de dictature militaire, sobrement nommée "Processus de réorganisation nationale" par ses acteurs. Réaliste? Oui: si Jorge Neuman est imaginaire, certains éléments et épisodes aux noms apparemment pittoresques, comme la Nuit des Crayons, ont malheureusement réellement existé. Comme quoi la réalité dépasse la fiction...
Michel Moatti, Les jardins d'hiver, Paris, Hervé Chopin, 2020.
Le site des éditions Hervé Chopin.
dimanche 18 octobre 2020
Dimanche poétique 467: Rainer Maria Rilke
jeudi 15 octobre 2020
Résonances de Jean Lorrain à Quentin Mouron
Quentin Mouron – Parue à l'enseigne des éditions Olivier Morattel à Dole, la dernière publication de Quentin Mouron s'avère atypique. Elle inclut en effet une étude littéraire sur l'écrivain français Jean Lorrain (1855-1906), "Jean Lorrain ou l'impossible fuite du monde", et la réédition de "L'Âge de l'héroïne", un roman de Quentin Mouron lui-même. Force est cependant de constater, en lisant ce livre, que le rapprochement est pertinent. Même s'il est à double tranchant.
"Jean Lorrain ou l'impossible fuite du monde" est présenté comme un essai. Occupant les trois quarts de l'ouvrage, ce texte apparaît plutôt comme une étude, une monographie sérieuse et ambitieuse qui s'intéresse à Jean Lorrain, un écrivain oublié, inscrit dans la mouvance décadentiste et dont on se souvient surtout, aujourd'hui, qu'il s'est battu en duel avec Marcel Proust.
L'auteur se livre avant tout à une mise en perspective: pour partir de ce qui est connu, il dessine une filiation (Baudelaire, Maxime Du Camp) et positionne Jean Lorrain par rapport à Joris-Karl Huysmans. Un rapprochement attendu, mais aussi une manière de distinguer l'un de l'autre: si Huysmans semble admettre la possibilité d'échapper au monde, par exemple en créant son propre monde comme le fait un Des Esseintes dans "A rebours", Jean Lorrain semble acter qu'une telle abstraction est impossible – pas même par la distanciation satirique, à laquelle Jean Lorrain renonce au fil de ses œuvres.
Selon cette étude, Jean Lorrain s'inscrit dans une littérature confrontée à la modernité née de la révolution industrielle, et se démarque du naturalisme. L'auteur met en évidence le rapport des personnages de Jean Lorrain à l'unique et à la série, allant jusqu'à suggérer que le besoin de se singulariser à la manière d'un Des Esseintes peut devenir une nouvelle manière d'être pareil aux autres. Cette étude met d'ailleurs en évidence le thème du masque, cher à Jean Lorrain. Qu'une personne soit masquée et elle se distinguera, mais si tout le monde se masque, tout le monde sera pareil.
Quant à l'enfantement, il peut être vu comme une manière de produire des humains de manière industrielle – Schopenhauer et son mépris du vouloir-vivre sont passés par là, avant Nietzsche et sa pulsion de vie. D'où une réflexion sur les sexualités non reproductives chères à Jean Lorrain et aux décadents: alors qu'on valorise une hétérosexualité féconde, Jean Lorrain assume son homosexualité, d'une manière décomplexée à une époque qui la condamne. L'œuvre de l'écrivain, quant à elle, lorgne du côté de la nécrophilie aussi.
Nous ferons grâce à l'auteur de quelques coquilles, la plus curieuse étant une parenthèse indiquant "("broder quelques conneries sur la "fonction du monologue")" en page 81. La rigueur du propos fait de "Jean Lorrain ou l'impossible fuite du monde" une étude importante, approfondie, sur un écrivain passé au-dessous des radars et que, du coup, l'on a envie de redécouvrir.
A ce titre, "L'Âge de l'héroïne", qui occupe le quart restant du tout dernier livre publié par les éditions Olivier Morattel, peut constituer une mise en appétit, tant on y retrouve les thèmes et questionnements littéraires chers à Jean Lorrain, entre autres sur le besoin de singularisation, au travers de livres à la rareté surjouée dont le caractère précieux s'estompe tant ils sont nombreux dans une librairie.
S'il commence par une improbable scène d'accouplement plus ou moins consenti entre un beau parleur et une libraire du côté de Berlin, ce roman prend rapidement les allures d'un western moderne, avec ses porte-flingues et sa prostituée qui taille des pipes en série – en notre temps, le sexe non reproductif est aussi devenu une industrie. Quant à la libraire, qui occupe le début et la fin du propos, est-elle vraiment libraire? "Vous avez la forme d'une libraire, Mademoiselle Schulz", dit un personnage, trébuchant peut-être sur un masque à la Jean Lorrain.
Quant au mot d'"héroïne" dans le titre, il renvoie certes à l'un ou l'autre personnage féminin, mais suggère aussi les drogues modernes, qui résonnent avec les paradis artificiels du dix-neuvième siècle qui traversent l'œuvre de Jean Lorrain (opium, et surtout éther). Faut-il dès lors voir "Jean Lorrain ou l'impossible fuite du monde" comme manière de préface à "L'Âge de l'héroïne"? En tout cas, force est de constater que Quentin Mouron, figure singulière des lettres romandes comme il y en a quelques-unes, a su installer, l'espace d'un roman, une résonance avec Jean Lorrain. Alors, Mouron, héritier ou épigone de Lorrain? Au lecteur d'en juger.
Quentin Mouron, Jean Lorrain ou l'impossible fuite hors du monde, suivi de L'Âge de l'héroïne, Dole, Olivier Morattel Editeur, 2020.
Le site de Quentin Mouron, celui des éditions Olivier Morattel.
Lu par Francis Richard, Jean-François Fournier.
mercredi 14 octobre 2020
Des cochons grillés en Sardaigne et à Neuchâtel
Fabio Benoit – Angel est de retour... et il n'est pas content. À tel point que l'écrivain Fabio Benoit, commissaire à la police judiciaire de Neuchâtel, peut lui consacrer un troisième roman, après "Mauvaise personne" et "Mauvaise conscience". "L'Ivresse des flammes" permet de revenir sur un canton de Neuchâtel aux prises, à tout le moins, avec un mystérieux pyromane qui a déjà fait des siennes dans "Mauvaise conscience". Ainsi se dessine une trilogie...
En préambule, on dirait que Neuchâtel devient en quelque sorte la capitale suisse romande du polar, voire du crime. Il y a en effet deux ou trois convergences entre l'œuvre de Fabio Benoit et celle de Nicolas Feuz. On retrouve ainsi le fameux BAP ou "bâtiment administratif des Poudrières", surnommé la "Boîte à poulets", qui pourrait faire figure de "36" neuchâtelois. De plus, les deux auteurs, qui dessinent le canton de Neuchâtel de manière réaliste, exercent un métier proche de la police et de la justice. Enfin, il y a une affaire de réseaux: si Nicolas Feuz évoque la mafia albanaise, c'est aux mafieux italiens que Fabio Benoit s'intéresse.
Cet intérêt se manifeste par la mise en scène non exempte de romantisme d'une poignée de bergers sardes jaloux de leur indépendance et de leur capacité à gérer le territoire vers Olbia, en particulier face à la 'Ndrangheta, mafia calabraise, désireuse de développer ses activités du côté de la Sardaigne. Pas de trafic de drogue ni de blanchiment d'argent via des hôtels par ici! Mais les bergers sardes ont leurs propres manières de faire la loi. On découvre ainsi un éleveur dont les porcs sont savoureux parce qu'ils sont anthropophages...
Par le biais d'Angelo Chiesa dit Angel, l'auteur fait rebondir son intrigue dans le canton de Neuchâtel. Il développe massivement le personnage d'Angel, relatant son enfance torturée et la violence dont il a été victime, mais aussi acteur. Le lecteur aura donc son content de scènes de tortures, relatées avec juste ce qu'il faut de cruauté. Surtout, l'écrivain joue sur les résonances d'un bout à l'autre d'une vie: l'incendie de la ferme du frère d'Angel, à La Brévine, rappelle un autre incendie, survenu bien plus tôt en Sardaigne. Victime du feu à deux reprises, Angel et son frère Aldo! Mais qui a gratté l'allumette?
S'il creuse le sillon de son personnage d'Angel, l'écrivain ne néglige pas ses personnages secondaires pour autant. Ils lui offrent une certaine liberté qui lui permet de s'amuser. On sourira ainsi de la misophonie de tel parrain mafieux, ainsi que de l'alibi sentimental d'un pompier qu'on a cru pyromane: la flamme qu'il tente d'éteindre n'est pas celle qu'on a cru. "Trop facile", suggère la criminologue québécoise Marianne Tremblay, qui apporte au roman quelques savoureuses expressions de la Belle Province. Quant aux cochons d'Aldo, enfin, ils jouent un rôle de leitmotiv animal sympa, après Lola (le lapin blanc, apparu dans "Mauvaise conscience") et les perruches d'Angel.
Pour davantage de finesse et de profondeur encore, l'écrivain choisit de multiplier les points de vue, les titres des chapitres faisant office de commentaires incitatifs de l'auteur. Le lecteur suit ainsi tantôt les enquêteurs, les victimes d'incendies, mais aussi de personnages aussi improbables que le notaire Cornelius Eck. Fin connaisseur des interrogatoires de police (il en a fait l'objet d'une remarquable étude, intitulée "Les secrets des interrogatoires et des auditions police", avec Olivier Guéniat), enfin, l'écrivain met un point d'honneur à réussir des dialogues et interrogatoires persuasifs, allant jusqu'à planter le bon décor, par exemple un local dépourvu de toute décoration qui pourrait permettre à la personne interrogée de s'abstraire de ce qui se passe.
Le lecteur reste ainsi captivé par ce thriller solidement construit, documenté comme il se doit pour davantage de réalisme – l'auteur est allé vivre en Sardaigne pour s'imprégner de la mentalité locale. "L'ivresse des flammes" paraît clore une trilogie, avec ses personnages morts ou tirés d'affaire, par exemple grâce à un ticket de loterie gagnant (tiens, comme dans "... au point 1230" de Laurence Voïta – sauf que ce n'est pas pareil). Mais l'intrigue pourrait bien receler quelques portes ouvertes ou à ouvrir pour un nouveau volume autour d'Angel.
Fabio Benoit, L'ivresse des flammes, Lausanne, Favre, 2020.
Le site des éditions Favre.
dimanche 11 octobre 2020
Dimanche poétique 466: Louise Glück
samedi 10 octobre 2020
Laurence Voïta et les aléas du gros lot
Laurence Voïta – Qui aurait pu imaginer qu'un ticket de loterie gagnant peut tuer? L'écrivaine Laurence Voïta imagine une telle situation dans son dernier roman, un polar littéraire intitulé "... au point 1230". Tout commence sur une plage située dans le canton de Vaud. Le premier chapitre décrit les lieux, la morte, et donne d'emblée de premières informations par le biais d'un témoin.
L'enjeu de "... au point 1230" pèse en effet 3,5 millions de francs suisses, de quoi faire des envieux. Curieusement, Jacques, le gagnant, physiothérapeute de son état, n'en a pas très envie, et décide de se débarrasser de son ticket gagnant. Quelqu'un le retrouve, elle s'appelle Nathalie, et quelque temps plus tard, c'est elle qu'on retrouve morte. Elle est enseignante au lycée local, ce qui fait quelques remous. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bien entendu, la police va s'en mêler, autour de Bruno, presque sexagénaire présenté comme un flic à l'ancienne qui se fie à son intuition mais sait gérer ses troupes quand il faut faire preuve d'autorité. L'auteure excelle d'ailleurs à dessiner la psychologie des inspecteurs, jeunes et moins jeunes, mis sur le coup. Elle les décrit longuement; mieux encore, elle les montre en action, en particulier lors d'une réunion où les répliques fusent de manière crédible, vers la fin du roman, lorsqu'on approche de la vérité. Avec tous ces policiers aux bagages variés, le lecteur s'excite, quand bien même ce ne sont pas des génies: juste des humains qui recherchent la vérité.
Pour donner de l'épaisseur à ses personnages, la romancière va les montrer en action. Elle donne par exemple à voir le mutique Jacques renonçant à dire à sa famille qu'il a gagné le gros lot ou le couple composé de Nathalie et Greg, dont chacun des membres vit avec ses parts d'ombre dont l'autre semble s'accommoder – le lecteur, en revanche, en saura plus, ce qui fera peser un moment les soupçons sur le personnage de Greg: peu recommandable en apparence (mère alcoolique, père absent, passage en institution, résilience sui generis: les grands classiques!), est-il pour autant coupable?
Quitte à impliquer de longs flash-back pour les uns et les autres, cette recherche d'épaisseur touche aussi les policiers. Certains seconds rôles fonctionnent sur un faisceau sommaire de traits de caractère, quitte à paraître agaçants même s'ils sonnent justes, à l'instar de Gérald, macho et ramenard. Le lecteur est amené à s'attacher en priorité à Bruno, ce chef d'équipe qui joue aux trains électriques avec sa petite-fille qui connaît tout du chemin de fer – il y a de la tendresse dans la description que la romancière fait de la relation entre Bruno et la petite Julie. Une "petite" Julie qui fait écho à d'autres personnages féminins vus par ledit Bruno comme "petites"...
... suggérant, et Bruno en est conscient, un certain paternalisme de sa part. C'est que discrètement, la romancière glisse quelques observations sur le regard que le monde porte sur les femmes, par exemple sur ce que signifie une paire de chaussures de sport roses – celles de Nathalie, qui reviennent comme un leitmotiv. Il y a aussi quelques hommes peu élégants ou trop sûrs d'eux dans ce roman. Nous avons parlé du cassant Gérald; mais il y aussi Paul Piguet, enseignant qui assume mal son statut de bellâtre passé de mode et a désormais des manières de porc (ce que son nom de famille peut suggérer, pour peu qu'on switche vers l'anglais...), mais dont plus d'une étudiante a été amoureuse il y a quelques lustres. A commencer par l'agente Sophie Costa, en première ligne pour l'enquête.
Il y a des ambiances dans "... au point 1230", mais aussi beaucoup de psychologie: au fil des pages, on sent que l'écrivaine prend plaisir à voir les âmes se frotter entre elles. Elle déroule une intrigue policière classique et bien ficelée pour aboutir à la vérité attendue – au terme d'un ultime retournement de situation qui, comme de bien entendu, sait parfaitement surprendre son lecteur, qui se souviendra que jouer au Loto n'est pas exempt de risques.
Laurence Voïta, ... au point 1230, Montreux, Les Editions Romann, 2020.
Lu par Francis Richard, Laura Maxwell, Sangpages Valérie.
vendredi 9 octobre 2020
Le chien comme révélateur des travers humains, avec Tagbumgyal
Tagbumgyal – Un moment de lecture au Tibet, ça vous tente? Traduit en diverses langues, l'écrivain Tagbumgyal compte parmi les auteurs tibétains les plus reconnus de sa génération. En publiant "Le chien, son maître et les parents proches" dans une traduction de Véronique Gossot, les éditions Intervalles offrent un aperçu représentatif de ce qu'il crée.
Et force est de constater que s'il y a un motif qui relie les trois nouvelles de ce livre, c'est bien celui du chien. Un motif cher à l'écrivain! Il lui permet, par contraste, de mettre à nu les travers des gens ordinaires vivant au Tibet au temps de la très athée Révolution culturelle – mais pas seulement, puisque ces travers et sentiments sont de toujours et de partout.
Intitulée "Le chien, son maître et les parents proches" a des allures de conte fantastique, fondé sur l'idée de la réincarnation, installée dès l'incipit, qui évoque Bouddha lui-même: "Le Maître compatissant a enseigné qu'il n'est pas d'être vivant qui n'ait été notre mère."
L'auteur fait dès lors s'entrechoquer la croyance religieuse, qui marque les comportements des personnages, et une Révolution culturelle qui a décidé de se débarrasser des chiens errants. Qu'en est-il de ce chien rouge auquel Köntho, personnage principal de la nouvelle, tient? Cela, sans oublier la question des parents proches: tout commence lorsque Köntho expulse sa mère de son domicile pour y vivre avec sa jeune épouse. Geste sacrilège, qui fait de Köntho un chien, précisément, aux yeux de certains.
C'est que du chien à l'homme, il n'y a pas grand-chose. L'auteur brouille dès lors la frontière avec les espèces. C'est tout le jeu de "Journal de l'adoption d'un hapa" – faux journal, soit dit en passant, puisque la nouvelle n'en adopte pas du tout la forme. Ici, l'écrivain met en scène un chien qui a la parole et a bien retenu sa leçon d'hommerie. Tout y passe, en un astucieux crescendo: ambitions professionnelles, avances ambiguës à l'attention d'une secrétaire, flagornerie.
Le chien, d'une race improbable nommée hapa, entre en résonance avec des personnages humains dont il révèle les travers exacerbés, à commencer par la violente jalousie du narrateur. Et comme symbole concret, le personnage favorisé par le hapa voit ses bottes admirablement cirées. Lèche-bottes, avez-vous dit?
Et des chiens, il y en a aussi dans "Le vieux chien s'est soûlé", qui met en scène un garçonnet qui va à l'école. Un chien saoul, c'est tout un monde: la bête a lapé le vomi de son maître, qui était ivre à l'excès. Encore une fois, on traque les chiens autour de l'école, parce qu'ils renvoient une mauvaise image. Vraiment? Les volte-face des uns et des autres soulignent l'ambivalence des humains pris dans des logiques de hiérarchie et de séduction de plus fort que soi, y compris dans un contexte dérisoire que l'auteur gonfle, à des fins de caricature.
C'est que mine de rien, on sourit en lisant "Le chien, son maître et les parents proches", un recueil de nouvelles traversé par une subtile ironie. Elle transparaît dans la mention de hiérarchies locales risibles à force d'être subdivisées et pourtant exagérément vénérées, ainsi que dans ces comportements si humains, éventuellement influencés par la superstition, par l'ambition ou par le poids des traditions familiales qu'il s'agit de mettre au jour. Le lecteur s'identifie par ailleurs aux personnages du livre, souvent masculins, toujours parfaitement ordinaires, en proie à un monde littéraire réaliste qui va à l'essentiel: les rapports entre humains.
Tagbumgyal, Le chien, son maître et les parents proches, Paris, Editions Intervalles, 2020. Traduction du tibétain et postface de Véronique Gossot.
Le site des éditions Intervalles.
Lu par Yves Mabon,
mardi 6 octobre 2020
Partir ou rester? Le destin d'une famille hongroise en 1956
Anna Szücs – Rester ou partir? Telle est la question finale du roman "L'Anatomie d'une décision", signé Anna Szücs. Paru tout dernièrement en Suisse, ce roman basé sur du vécu invite le lecteur à replonger dans l'insurrection de Budapest, vue d'une petite ville hongroise. C'était en 1956. Tout commence par un incipit qui, habilement, ne laisse rien entendre des événements à venir: "Ce matin-là, comme à son habitude, Imre Spiegel arriva à son bureau de la place Marx quelques minutes avant huit heures." Voilà un personnage qui paraît réglé comme une horloge suisse, et que l'Histoire va chambouler...
L'écriture de ce livre paraît simple et efficace, ce qui est un bon choix pour relater de manière réaliste la vie quotidienne dans une petite ville de Hongrie dans les années 1950. C'est avec ces mots, neutres, que l'auteure dessine pour commencer une situation où un commerce organise une pénurie, en faisant parler ses cadres. Le lecteur en conclut que c'est la routine...
... une routine chamboulée, on l'a dit. L'auteure choisit de serrer le rythme de la narration, consacrant des chapitres détaillés aux jours du soulèvement, presque heure par heure. On sent dès lors chez les uns et les autres l'envie de rassurer, la tentation de manifester, la difficulté à choisir le bon camp en une période d'incertitude. Ces sentiments sont vus de près, autour du personnage d'Imre Spiegel certes, mais aussi de sa famille élargie: c'est l'occasion pour la romancière de faire s'entrechoquer les différents points de vue sur une insurrection synonyme de pressions pour les gens en place. Anatomie d'une difficile réflexion à laquelle Imre devra répondre.
Roman historique nourri par des témoignages familiaux, "L'anatomie d'une décision" résonne de plus d'une thématique restée actuelle. On pense avant tout à l'antisémitisme, qui naît dans une cour de récréation au détour d'un jeu de billes qui a mal fini pour l'un des joueurs. Instillé par des adultes, il s'avère incohérent et primaire. De plus, il entre en résonance avec ce qu'a pu vivre la famille Spiegel au temps pas si lointain des nazis: les déportations sont évoquées, de même que ceux qui n'en sont pas revenus. Sans compter l'image récurrente du foie gras qui n'est pas bon à Vienne: est-ce que cela ne cache pas autre chose?
L'auteure glisse par ailleurs, en page 29, une allusion aux championnats du monde de football de 1954, disputés en Suisse: alors que les horreurs de l'expansionnisme nazi sont fraîches dans les esprits, y aurait-il eu une connotation de possible revanche politique à sa finale sportive, opposant la Hongrie à l'Allemagne au stade du Wankdorf à Berne? En tout cas, les mouvements de foule semblent avoir été aussi importants en Hongrie que ceux de l'insurrection de Budapest.
Autre élément qui résonne avec notre actualité: le déboulonnage des statues. Au travers du personnage d'Imre, l'auteure suggère que ces actes de vandalisme ont pu naître d'une ignorance rageuse: "Hamburger était juif, il était aussi communiste, mais avant tout il avait été un homme compétent et dévoué". Voilà un humain complet dont on veut détruire une image en prétextant une partie de sa personnalité, dont le lecteur ne saura rien!
Reste qu'Imre assume d'être juif, fier des qualités qu'on prête aux siens et aussi ancré dans la réalité de sa petite ville hongroise de Zalaegerszeg, dont il connaît les rouages. Vivant à l'aise, il est aussi parfaitement humain, foncièrement attachant: on le trouve séducteur dans sa belle voiture, travailleur, on le voit aussi attentionné et responsable, père de famille exemplaire en somme. Il n'en faut pas moins pour qu'en fin de roman, la difficile décision qu'il prend pour toute sa famille paraisse juste.
Anna Szücs, L'Anatomie d'une décision, Genève, Encre Fraîche, 2020, illustrations d'Anna Szücs.
Le site des éditions Encre Fraîche.
Lu par Eva Vamos, Francis Richard.
lundi 5 octobre 2020
Avec Muriel Gilbert à la redécouverte de cet inépuisable réservoir de curiosités délicieuses qu'est le français
Muriel Gilbert – Amis des mots et de la langue française, voici un ouvrage fait pour vous. Vous reprendrez bien... Un bonbon sur la langue? est un recueil de chroniques signées Muriel Gilbert, qui répond régulièrement aux questions posées par les auditeurs de son émission sur la radio française RTL.
On y trouve quelques classiques, qui ne le sont manifestement pas pour tout le monde: il est bon de se rappeler l'art des quelque et quel(s) que, ne serait-ce que pour démarrer la dictée de Mérimée d'un bon pied. Quelques finesses de l'accord du participe passé sont aussi abordées: faut-il écrire Muriel s'est servi du gâteau ou Muriel s'est servie du gâteau? Indice: les deux mon capitaine, mais ça ne veut pas dire la même chose!
Surfant sur les demandes de ses auditeurs – parfois des enfants – l'auteure de ce recueil se retrouve sur des terrains inattendus, faisant face à des questions très pertinentes mais qu'on ne se pose pas forcément. Ainsi, pourquoi beau-frère ou belle-mère? Ils ne sont pas forcément beaux... Et hop: on plonge dans l'histoire du sens des mots en français. On touche même aux fondamentaux tels que l'histoire de l'ordre des lettres dans l'alphabet latin.
L'ouvrage est celui d'une correctrice franco-française s'il en est, et on le décèle lorsqu'elle aborde une erreur de typographie commise sur la couverture de l'édition de poche de l'un de ses ouvrages: elle regrette qu'une espace ait sauté entre un mot et la ponctuation qui le suit. Or, si l'art de la typographie à la française aime les espaces, la typographie suisse privilégie le collage lorsqu'il n'est techniquement pas possible de placer une espace fine (1).
Si l'auteure assume son côté conservateur en ce qui concerne la langue française et la manière de l'écrire, elle répète que l'usage seul commande. Elle assume donc le fait qu'une erreur mille fois répétée pourra entrer dans le dictionnaire un jour – et indique même que c'est déjà arrivé. C'est même l'une des raisons qui créent les savoureuses irrégularités du français, fruit du verbe des hommes (et des femmes) d'hier, d'aujourd'hui et de demain. La nouvelle orthographe recommandée a même droit de cité dans les pages de l'ouvrage.
Un ouvrage branché sur l'actualité, soit dit en passant, puisqu'un certain nombre de chroniques évoquent les mots nés de l'épidémie du coronavirus. Il sera donc question de déconfinement (pas encore dans les dictionnaires), du genre de COVID-19, de postillons ou même de rouvrir ou réouvrir les écoles. Des choses parfois basiques, que l'auteure s'amuse à approfondir en alliant érudition et tonalité pétillante.
Revoir ses fondamentaux et les approfondir, découvrir de nouvelles anecdotes sur la langue française: au fil des pages, Muriel Gilbert guide avec le sourire ses lecteurs à travers les méandres de ce beau parler français qui n'a pas fini de dévoiler ses délicieux mystères. Et pour ceux qui n'en ont pas assez, l'auteure va même jusqu'à citer des livres et des sites Internet pour aller encore plus loin.
Muriel Gilbert, Vous reprendrez bien... Un bonbon sur la langue?, Paris, La Librairie Vuibert, 2020.
Le site de Muriel Gilbert, celui des éditions Vuibert.
(1) Et telle est ma pratique sur ce blog, suivant le Guide du typographe romand.
dimanche 4 octobre 2020
Dimanche poétique 465: Philippe Desportes
samedi 3 octobre 2020
Nuria Manzur-Wirth, la poésie comme une respiration au fil des pages
Nuria Manzur-Wirth – "Esquilles", voilà un titre bien trouvé pour un recueil de poésie constitué entièrement en fragments. Fragments d'os, fragments de souffle? Que le lecteur se réjouisse: il aura tout cela. Et s'il le faut, il apprendra, pris par la main par la poétesse Nuria Manzur-Wirth.
"Esquilles" assume un caractère hermétique dès sa première partie, "De voix et de souffle". Il n'est pas toujours évident de suivre le sens du propos porté par la poésie de l'écrivaine, pétri par de nombreuses images étonnantes liées au corps humain.
Dans cette première partie, la poétesse introduit le thème du souffle. Plus que le sens des mots, le lecteur se laissera donc surtout transporter par les rythmes, qui se montrent syncopés au fil de césures hardies qui suscitent l'envie d'une scansion qui respire à sa manière, au fil également des blancs typographiques.
Respiration? Tiens, justement, la deuxième partie du recueil s'intitule "Anatomie du souffle". L'écrivaine incite son lectorat à apprendre à respirer, puis se lance dans des textes où la forme est première. Elle peut prendre la forme d'éclats, les mots épousant graphiquement leur sens, ou même d'un puissant calligramme comme dans "Trajet osseux du souffle".
Certes, les textes de cette deuxième partie sont sortis de textes d'apparence scientifique. La poétesse leur confère une dimension supplémentaire de poésie en leur donnant littéralement forme. Le lecteur est ainsi épaté par le gris typographique des pages: des éclats, des dessins. Les mots ne disent pas tout...
... d'autant moins que la troisième partie, "Anatomie comparée", confronte les langues. Le lecteur est-il polyglotte? Il le faut, un peu, pour slalomer entre le français, l'espagnol, l'anglais, l'allemand et même l'anglais. Mais est-ce si important? Encore une fois, plus que le sens strict du propos, le lecteur apprécie l'imbrication quasi amoureuse des vers écrits en langues diverses. Une imbrication qui impose même un sens de lecture inhabituel, obligeant le lecteur à revenir sur ses pas, à aller et venir, à trouver sa voie pour créer un sens possible.
Voilà bien un recueil de poésie hors norme, présenté en un format A4 généreux qui laisse toute la place à des poèmes qui soufflent au fil des blancs. Ils peuvent paraître un peu cérébraux, surtout si l'on s'arrête à leur sens premier. Mais ils respirent surtout comme un être humain, capable d'images et de parole en langues diverses. Au moins autant que le verbe, la mise en forme du propos ne peut qu'éblouir le lecteur. Mais face à une telle esthétique, est-on encore lecteur? Celui qui lit "Esquilles" est davantage un observateur esthète, et un humain qui respire avec la poétesse.
Nuria Manzur-Wirth, Esquilles, Lausanne, L'Aire, 2020.
Le site des éditions de l'Aire.
jeudi 1 octobre 2020
Au cœur des jobs à la con
"Bullshit jobs" est l'ouvrage d'un chercheur qui assume un positionnement anarchiste. On le constate dès le départ: l'auteur insiste sur le fait que les jobs à la con prospèrent aussi dans une société capitaliste et libérale où tout ce qui est de trop devrait être élagué. Il est permis de voir du manichéisme dans le propos. Mais il arrive aussi à l'auteur de renvoyer gauche et droite dos à dos, comme les deux facettes d'un même establishment.
L'auteur relève que le secteur privé a aussi ses employés qui ne servent à rien, voire qui nuisent à leur entourage – et rappelle que ce n'est pas l'apanage de la fonction publique ou des régimes communistes. C'est par touches qu'il définit le job à la con, en y intégrant la part de subjectivité inhérente à celui qui l'exerce et se sent inutile. Et si ces employés inutiles et navrés de l'être sont quand même engagés, c'est pour des raisons qui ont entre autres à voir avec le prestige, par exemple une secrétaire embauchée juste parce qu'un chef sans secrétaire, ça ne fait pas sérieux.
La nomenclature des différentes catégories de jobs à la con a un côté provocateur, avec ses larbins, ses porte-flingue, ses rafistoleurs, ses cocheurs de cases et ses petits chefs. Il convient de rappeler que David Graeber distingue les "jobs à la con", radicalement inutiles mais souvent bien payés, des "jobs de merde", souvent très utiles mais pas reconnus à leur juste valeur. Décomplexé, il va jusqu'à se demander si tueur à gages ou mafieux est un job à la con (et sa réponse, argumentée, est négative).
L'auteur développe une vision tous azimuts du type d'emploi qu'il dénonce. "Bullshit jobs" s'intéresse ainsi à l'évolution du rapport des humains à l'emploi et au travail, faisant endosser sa part de responsabilité à une morale issue du christianisme et qui valorise le travail plutôt que l'oisiveté – il aborde même les fluctuations du rapport de l'homme au temps, suggérant qu'un emploi à horaires fixes toute l'année n'a rien de naturel, mais que l'humain est conditionné à l'accepter dès ses années d'école.
De façon plus ciblée, il dit aussi comment un job à la con peut déstabiliser un collaborateur qui découvre rapidement qu'il ne sert à rien. On le verra déstabilisé parce qu'il n'ose pas avouer qu'il s'ennuie, ni qu'il fait autre chose (faire le wikignome, étudier la rythmique de la musique indienne, etc.); on le verra aussi développer des stratégies pour paraître occupé. Et comme l'auteur s'intéresse à l'humain, il fonde l'essentiel de son argumentation sur de nombreux témoignages, amplement cités et ordonnancés. Cela lorgne vers la notion de syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui, étudiée par Peter Werder et Philip Rothlin, puis par Christian Bourion, mais l'auteur ne cite pas cette notion.
Quant aux origines des jobs à la con, l'auteur les identifie dans une société vue comme classiste (les riches concèdent des places, mais n'en donnent pas le mode d'emploi à ceux qu'ils engagent), raciste (on propose aux minorités raciales des emplois apparemment brillants, mais ayant un impact nul) voire sexiste/patriarcale. Le lecteur peut même suspecter un réflexe luddiste dans une entreprise qui refuse l'automatisation de tâches ingrates par l'informatique, proposée par un titulaire d'un job à la con, simplement parce que cela réduirait la part de travail de certains barons.
Que faire, alors? En un dernier chapitre, l'auteur développe l'idée d'un revenu universel de base. D'une tonalité militante, son discours y est clairement favorable, quitte à éluder les difficultés qu'une telle option présente. Il résonne avec le postulat de départ: la productivité a tellement augmenté qu'on devrait avoir aujourd'hui une semaine de travail de 15 heures - or, nous le savons, ce n'est pas le cas.
Tiens! A plus d'une reprise, "Bullshit jobs" résonne avec "La Fin du travail" de Jeremy Rifkin. Mais alors que ce dernier voit la fin du travail d'un œil inquiet (on relèvera avec amusement que si Graeber voit émerger des emplois de petits chefs partout, Rifkin souligne les dégâts sociaux de leur disparition...), David Graeber la voit d'un bon œil, moyennant l'introduction d'un revenu de base.
Nous avons tous une part de bullshit dans notre job actuel, et "Bullshit Jobs" permet d'y réfléchir – en observant des emplois radicalement inutiles et délétères. C'est un petit livre qui peut paraître parfois un peu rapide. Mais c'est aussi un opus extrêmement documenté, aux arguments solides. Et à l'instar d'autres ouvrages américains du même genre (on pense aux "Nouveaux cobayes" de Dan Lyons), il est parfaitement accessible, agréable et même drôle à lire. Et délibérément polémique, bien sûr.
David Graeber, Bullshit Jobs, Paris, Les Liens qui libèrent, 2019.
Le site des éditions des Liens qui libèrent.