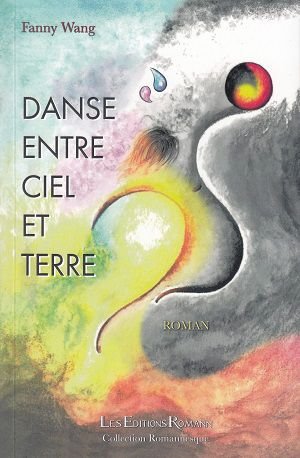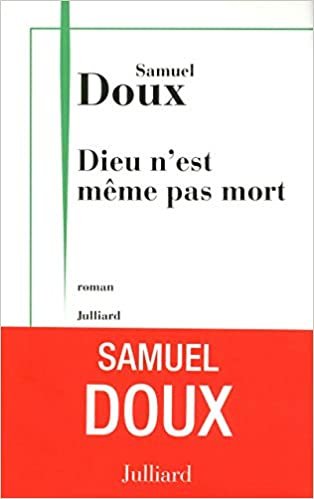Isabelle Gagnon – Voilà deux jumeaux, Alix et Paul, liés par leur gémellité mais aussi par un secret de famille qu'il faut liquider. Ils sont français, Paul s'est exilé au Québec alors qu'Alix vit avec Marie, sa copine, à Paris. Attirée par le vide, Alix traverse la Grande Gouille pour faire face au Monstre avec Paul. Tuer avec ce flingue qu'elle a acquis? Simplement savoir? Le lecteur le découvre au fil des pages du court roman "Du sang sur les lèvres" d'Isabelle Gagnon.
"Du sang sur les lèvres" est porté par une interrogation lancinante, celle qui fait tourner les pages: qui est ce "Monstre", ce Mark Foster? Pour commencer, c'est par touches que la romancière éclaire ce personnage clé de la jeunesse d'Alix et Paul. Le regard évolue aussi: au début, Mark Foster, travailleur proposant ses services aux parents d'Alix et Paul, paraît presque sympathique avec ses airs de hippie. Et c'est presque en fin de roman que le lecteur découvre ce qui vaut à Mark Foster son terrible surnom. Et aussi l'envie de revanche de deux enfants épris d'absolu familial... et devenus grands depuis.
"Du sang sur les lèvres" est traversé par la relation brindezingue entre deux jumeaux, un frère et une sœur. Qui est le plus fort des deux, qui domine? Constamment attirée par le vide, Alix se présente dans le prologue du roman, descriptif d'un moment d'enfance, comme celle qui domine le tandem, obsédée par l'idée de prendre soin de son frère, mettant à jour ce qu'elle considère comme sa fragilité intrinsèque, malgré sa force physique.
Plus tard, et c'est là que le lecteur la vit, la relation a des airs plus complexes, chacun ayant ses faiblesses que l'auteure explore de façon brève mais juste. A chacun son addiction, par exemple: si Paul aime aller aux filles, Alix picole sec. Il en résulte une relation fraternelle bizarre mais solide. Aux yeux des rares tiers, elle paraît en outre trompeuse au gré d'un jeu d'identités troublant: on croit souvent que Paul et Alix, faux jumeaux mais vrais complices, sont amants. Mensonge encore, face à la société: Paul et Alix deviennent Pierre et Clothilde – les noms des parents, presque sacrés pour Alix – face à certaines relations auxquelles il est bon de mentir.
C'est qu'un secret de famille doit se régler dans le secret, semble-t-il. Ainsi, la romancière place son intrigue dans la localité de Pohénégamook, au Québec, à deux pas du Maine, fief de Stephen King, de l'autre côté de la frontière. Ce coin du Canada permet à l'action de se dénouer loin des regards indiscrets, dans une ultime scène à la fois logique et fatale.
Vengeance il y aura donc, radicale, et ça fait du bien même s'il faut le payer de sa vie, ou vivre avec le poids des morts. Rapide et tranchant, "Du sang sur les lèvres" relate, dans un cadre sauvage où l'on aime chasser et pêcher, l'histoire d'un gars revenu à l'état sauvage, Paul, qu'Alix, certes parée d'un rôle de protectrice qu'elle veut bien endosser, ne parviendra plus à civiliser à nouveau.
Isabelle Gagnon, Du sang sur ses lèvres, Marseille, Le mot et le reste, 2021. Première édition: Montréal, Héliotrope, 2015.
Le site des éditions Le mot et le reste, celui des éditions Héliotrope.
Lu par Fanny Haquette, Les Passions de Chinouk, Passion Polar, Ray Pedoussaut, Richard.