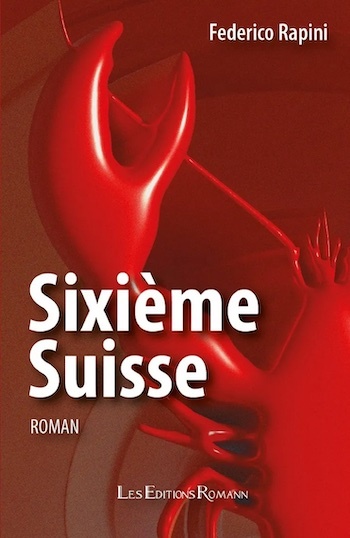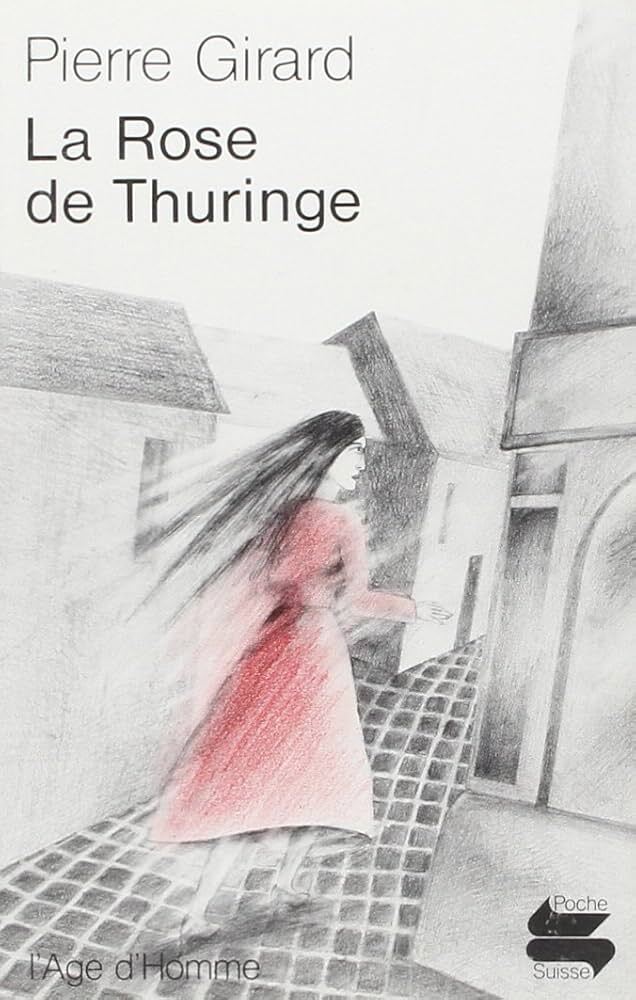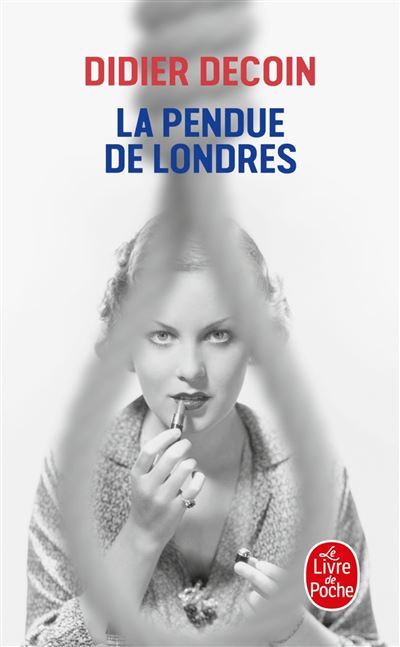Gilbert Pingeon – C'est dans la forme courte que l'écrivain suisse Gilbert Pingeon excelle. Et cette brièveté fulgurante apparaît déjà dans le titre de ce roman, "T", qui évoque le destin tragique du Titanic et le fait résonner avec des événements ultérieurs au parfum d'hybris: bombe atomique, Holocauste, attentats du 11-Septembre. Sans oublier de convoquer mine de rien des drames plus intimes, tels que celui d'un enfant qui ne veut pas manger sa soupe: "Enfin Jonas! Ce n'est tout de même pas la mer à boire!".
C'est en séquences courtes que l'auteur décline sa vision en mosaïque du destin du Titanic. Ces séquences installent le rapport de force à la manière d'un match entre deux puissances: celle de l'humain, portée par Sir Titan, Nick de son prénom, et celle de la nature, incarnée par Herr Berg, Ice de son prénom ("Duel sous la lune", p. 14 ss). Rapport de force éternel, mais qui, l'auteur le dit au fil du roman, finit par entraîner l'humain dans un élan de force autodestructeur. Et l'humour n'est pas absent lorsqu'il s'agit, pour le romancier, de souligner la vanité de l'action vite débordée de l'humain.
La vie sur le Titanic? L'auteur la dépeint avec un talent certain, faisant mine de céder au pittoresque pour dire la confiante insouciance des passagers, multipliant les points de vue au gré de courtes séquences. Il sait capter tel homme de peine du navire, tel richard insouciant jusqu'au bout, et va jusqu'à faire résonner le splendide menu du restaurant de bord avec l'inquiétude qui se fait jour alors que Berg (Ice de son prénom) a laissé son irréparable balafre sur le navire invincible.
Mais voilà: rien ne manque de ce qu'on sait du navire et de son destin: les sept musiciens de l'orchestre jouent jusqu'au bout, les naufragés font résonner leur funèbre mélopée jusque vers trois heures du matin, le lecteur revoit la barbe blanche du capitaine Smith et découvre les statistiques des survivants, et surtout des survivantes. "Les femmes et les enfants d'abord"? Cette question même, l'auteur la pose, avec un brin de mauvaise foi masculine. Tout juste, enfin, si l'auteur ne fait pas parler les rivets du navire...
Il est vrai cependant qu'en jongleur littéraire, l'auteur confère à chacune de ses courtes séquences une musique et une voix particulière, sans cesse changeante, incarnant ses personnages et nourrissant les situations mises en scène avec plus d'un clin d'œil artistique – il suffit de penser aux titres des séquences, parfois empruntés à des œuvres artistiques bien connues ou pas, pour s'en convaincre.
À la fois dense et fulgurant, paru à l'occasion du centenaire de la catastrophe du Titanic, "T" utilise la mythologie de ce navire pour tracer sans concession le côté annonciateur, référentiel, de cet événement fondateur du vingtième siècle tout en excès. Un signal que, dit l'auteur, tragique, l'humanité n'a pas su entendre ni comprendre. Un message à retenir? Pour rejoindre l'écrivain, et c'est le début de la postface de ce bref roman: "A chaque baptême sa catastrophe annoncée"...
Gilbert Pingeon, T, Lausanne, L'Age d'Homme, 2012.
Le site des éditions L'Age d'Homme.
Lu par Francis Richard.