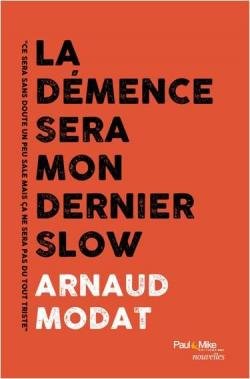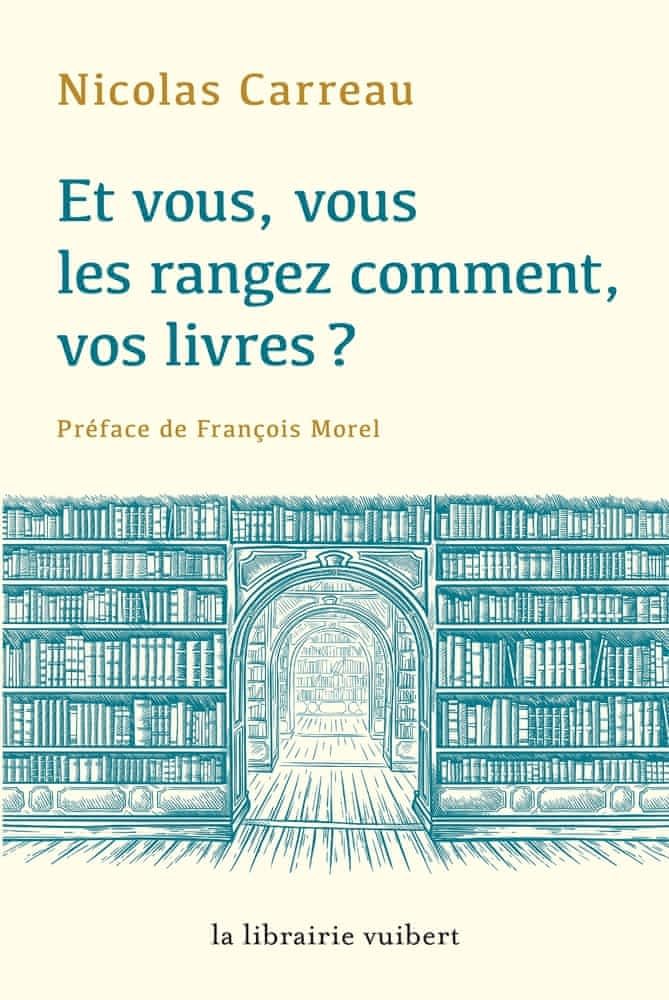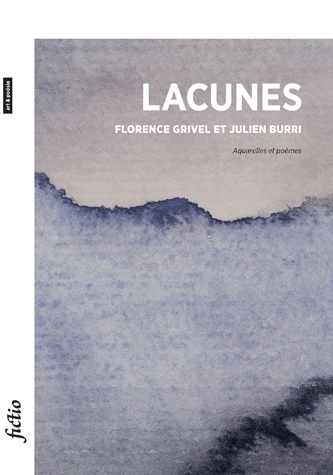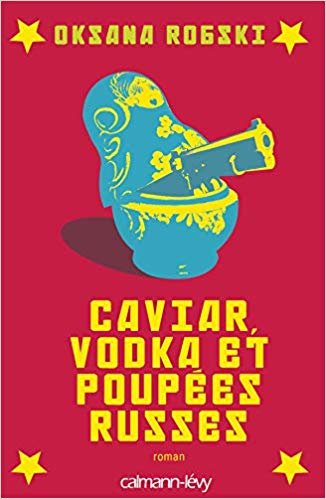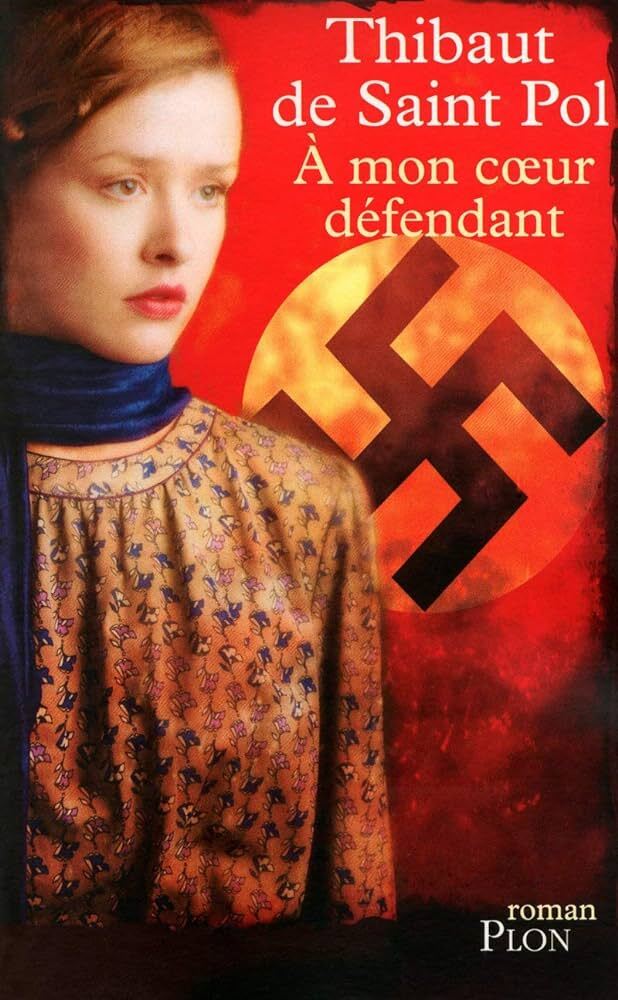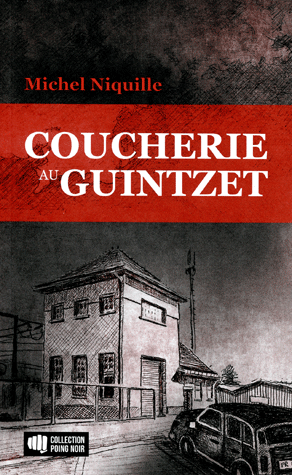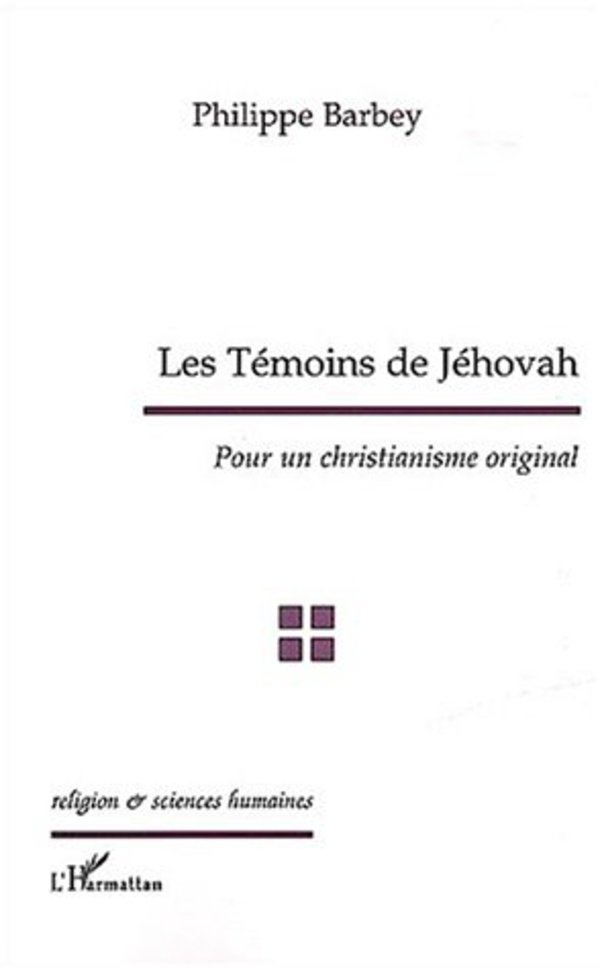
Philippe Barbey – Sans doute avez-vous eu affaire à ces gens qui vont deux par deux annoncer la bonne nouvelle, soit en sonnant aux portes, soit en se tenant debout, bien vêtus, aux côtés d'un stand plein de revues et de livres, dans l'espace public. Ce sont les Témoins de Jéhovah, qu'on adore détester. Pour ma part, j'ai voulu en savoir plus.
C'est pourquoi j'ai lu "Les Témoins de Jéhovah, pour un christianisme original", travail de recherche scientifique réalisé par le sociologue des religions Philippe Barbey.
L'unitarisme, une réflexion intéressante
L'intérêt majeur de cet ouvrage est de rappeler ce qui fait la spécificité des Témoins de Jéhovah du point de vue théologique et chrétien: le rejet du dogme de la Sainte Trinité – nommé "antitrinitarisme" ou "unitarisme", pour souligner l'unicité de Dieu, sans Fils ni Saint-Esprit à la fois d'égale nature et distincts. Un rejet dont l'auteur explique très bien les origines, en se plaçant dans une perspective historique en phase avec l'ambition des Témoins de Jéhovah de retrouver un christianisme originel (plutôt qu'original d'ailleurs), proche de la simplicité des premiers chrétiens.
Les arguments sont là: il n'est pas question de Sainte Trinité dans la Bible, que les Témoins de Jéhovah étudient à fond, et si ce dogme complexe a trouvé sa place dans le christianisme, selon l'auteur, c'est aussi parce qu'il a été imposé, également sur fond de concurrence avec les polythéismes en vogue au temps des Romains – l'auteur rappelle que les Egyptiens païens regroupaient volontiers leurs divinités par trois. Dès lors, l'auteur déroule une histoire de l'antitrinitarisme, avec Michel Servet, réformateur critique radical, balancé par Calvin, condamné à mort et exécuté à Genève, en point de mire.
Il va de soi qu'une telle perspective ne peut que donner à réfléchir à un catholique pratiquant, ne serait-ce qu'en creux: au fond, qu'est-ce que la Sainte Trinité? Et qu'y a-t-il vraiment dans la Bible? C'est là que l'auteur se penche sur l'histoire des Témoins de Jéhovah eux-mêmes, obédience née à la fin du dix-neuvième siècle sous l'impulsion de Charles Taze Russell sous le nom des "Étudiants de la Bible". Il est intéressant de relever que l'auteur consacre plus d'un paragraphe à expliquer les raisons de comportements spécifiques aux Témoins de Jéhovah, mais qui peuvent paraître étranges, voire choquants: refus de la transfusion sanguine, neutralité politique radicale, pacifisme à tout crin. Des positions qui valent la suspicion envers les adeptes – détaillée en fin de livre, la situation des Témoins de Jéhovah en Allemagne, en Italie et en URSS en témoigne. Un choix de pays parlant, puisque ce sont justement ceux où des régimes (nazisme, fascisme, communisme) les ont persécutés.
Pourtant, c'est là que le bât blesse. D'abord parce que l'auteur n'évoque aucun pays où les Témoins de Jéhovah ont pu s'épanouir sans (trop de) crainte – ne seraient-ce que les Etats-Unis, où ce mouvement a vu le jour. Plus largement, cette approche descriptive est parfois ternie par certains points de vue orientés de l'auteur, qui peuvent relever davantage de la victimisation religieuse que de l'étude analytique et scientifique. Ainsi, l'auteur ne se demande à aucun moment si le prosélytisme dynamique voire intrusif des Témoins de Jéhovah ne peut pas paraître dérangeant envers une population qui n'est pas acquise à sa cause et s'attend, de la part des religions et de leurs adeptes, à une certaine discrétion. N'y aurait-il pas d'autres méthodes pour convertir?
Religion ou secte?
Dans la troisième partie de son livre, le sociologue interroge le rapport des Témoins de Jéhovah à la laïcité à la française. Certes, les Témoins de Jéhovah ont pu être considérés comme une secte. Questionnement légitime face à un mouvement méconnu! On se souvient cependant que la fin du vingtième siècle a vu émerger toutes sortes de dérives liées au New Age ou à des initiatives privées souvent davantage soucieuses du compte en banque de leur gourou que du salut post-mortem de leurs adeptes. Dès lors, le profane se demande si les Témoins de Jéhovah sont quelque chose de ce genre.
L'auteur paraît avoir une opinion arrêtée, certes argumentée: les Témoins de Jéhovah sont une religion chrétienne issue de la Réforme et non une secte. Sur le papier, OK: on l'a vu, l'unitarisme se défend du point de vue théologique et théorique. Cela dit, et on le regrette, il évite soigneusement, dans tout son livre, de poser les questions qui fâchent au sujet des Témoins de Jéhovah, et suggèrent une dérive sectaire: une pratique qui envahit la vie privée et oblige à vendre des livres et revues, une iconographie spécifique sujette à caution, un appât du gain peu en phase avec le message de modestie proclamé, la difficulté à apostasier, la question d'Armageddon.
Il ne sera pas question non plus, dans "Les Témoins de Jéhovah", d'affaires de pédophilie ou d'emprise de la part d'Anciens parfois enclins à abuser de leur respectable statut. Or, pour dire si nous avons affaire à une religion sincère, à une secte ou à quelque chose entre les deux (et, l'auteur l'indique, les Témoins de Jéhovah visaient un statut de religion en France en 2003, date de publication du livre), toutes ces questions sont essentielles.
Entre érudition et impression de parti pris
On le comprend, l'impression laissée par une telle lecture ne peut qu'être mêlée. Certes, l'érudition dont l'auteur fait preuve pour dessiner les racines judéo-chrétiennes de l'unitarisme force l'admiration: nombreuses sont les citations d'autres auteurs, ainsi que de la Bible elle-même, source première de doctrine pour les Témoins de Jéhovah. A ce titre, la première partie du livre est clairement la plus éclairante, celle qui interpelle le plus. Cet ouvrage a par ailleurs le mérite d'être l'un des rares à traiter à fond des Témoins de Jéhovah, que tout le monde croit connaître. A ce titre, il demeure important.
Pour la suite, cependant, découvrant un récit en forme de storytelling qui vante le dynamisme des Témoins de Jéhovah et occulte les questions gênantes, le lecteur conserve le sentiment tenace d'une étude orientée, insuffisamment critique, qui n'a pas toujours la distance scientifique nécessaire. Par conséquent, on peut se demander si, sous couvert scientifique, l'auteur lui-même n'est pas Témoin de Jéhovah et ne prêche pas, sans mauvais jeux de mots, pour sa propre paroisse.
Philippe Barbey, Les Témoins de Jéhovah, pour un christianisme original, Paris, L'Harmattan, 2003.
Le site de Philippe Barbey, celui des éditions L'Harmattan.