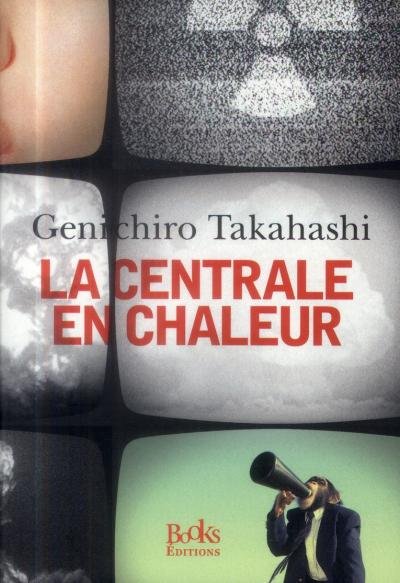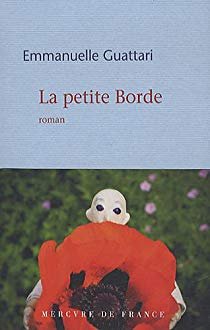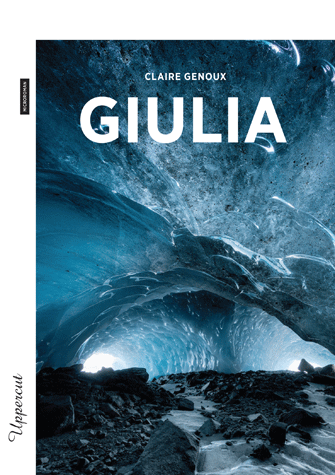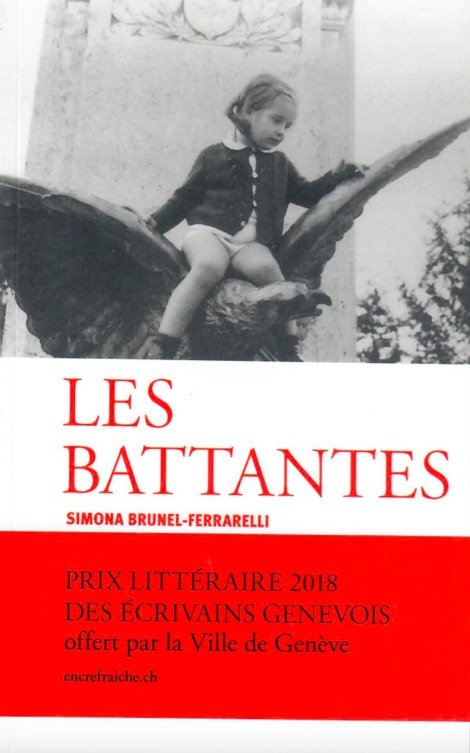Jean Dutourd – Un déjeuner suffit-il à faire un livre? L'écrivain Jean Dutourd répond par l'affirmative. Et c'est ainsi qu'en 1947, son premier roman voit le jour: c'est "Le déjeuner du lundi". Roman? Il est permis de voir là, plutôt, une autofiction, puisque l'écrivain, de son propre aveu, s'est largement inspiré de repas partagés avec son père et son oncle pour trousser cet ouvrage. D'un autre côté, on dit aussi qu'avec "Le déjeuner du lundi", Jean Dutourd a inventé le Nouveau Roman. Voyons ce qu'il en est...
L'intrigue est mince: sur 342 pages, l'écrivain relate un repas partagé entre hommes, repas rituel puisqu'il a lieu tous les lundis. Le titre aurait même pu être "Un déjeuner du lundi" puisque sans doute, le moment décrit dans ce livre relève d'une synthèse romancée, cristallisée, de plusieurs déjeuners.
Et qui est à table? Jean bien sûr, qui comme Marcel Proust dans "A la recherche du temps perdu" dit certes son prénom, mais jamais son nom de famille, afin de laisser au lecteur non désenchanté le choix, certes très théorique tant les indices du contraire sont nombreux, de considérer ce récit comme de pure imagination. Mais il n'est pas seul...
Ils sont trois...
Avec lui, il y a le père de Jean, sexagénaire portant beau, dentiste de son état, dont on aime le verbe truculent et le caractère de "veuf devenu célibataire", riche en préceptes définitifs sur la vie et les femmes, amphitryon habitant un logement peuplé de bibelots et de meubles guère authentiques, abondamment décrits: emphatique, le bonhomme aime à paraître, à raconter ses hauts faits, mais il y a quelque chose de fabriqué et de peu massif là-derrière. Un homme en contreplaqué, en faux bois comme ses meubles en faux Louis XIII? En tout cas un homme qui aime paraître, qui séduit cependant son lecteur autant que ses trois maîtresses.
Vieilli avant l'âge, l'oncle est d'une autre trempe: fonctionnaire, vêtu d'une tenue de ski incongrue, ses revenus sont médiocres, à l'instar de sa personne, peu désireuse de se mêler de conflits: on le sent neutre comme un Suisse, on le voit timoré, on aimerait lui mettre des gifles parfois. On l'apprécie cependant pour son appétence pour les énigmes intellectuelles et les jeux de mots. Et aussi pour le caractère châtié de son langage, qui fait contraste avec la vigueur de la parole du père. En somme, l'oncle, c'est Marc Bonnant caricaturé par anticipation, le calembour en plus.
Quant à Jean, c'est Jean Dutourd dans sa version romancée, avec l'évocation de ses débuts chaotiques de journaliste toujours fauché aspirant à être écrivain à succès, de sa jeune famille et de son passé de résistant évadé.
Un hommage à l'art de la conversation
Et les trois hommes se mettent à discuter... et c'est là qu'émerge le génie de l'écrivain. Les voix de chaque personnage sont bien caractérisées, et l'on ne se perd jamais dans ces dialogues où la parole est reine, installés comme des répliques de théâtre: le non-verbal n'apparaît guère dans ces séquences. De plus, c'est avec une finesse d'orfèvre que l'écrivain dessine les méandres d'une discussion qui peut virer sur un seul mot, passe allègrement du particulier astucieux au général pontifiant, de l'anecdote de guerre au jeu de mots finaud ou potache, en passant par la contrepèterie et par les considérations sur les difficultés de l'approvisionnement (nous sommes en 1946) ou sur les femmes qui, décidément, ne sont plus ce qu'elles étaient.
Les paroles échangées sont radiographiées à fond, jusqu'aux intonations et aux accents: l'oncle est bourguignon, le père est auvergnat, et leur manière de rouler les "r" diffère donc. De même, l'un dit "bougrement", l'autre "bigrement", et cela, selon Jean le narrateur et observateur, est porteur de sens, révélateur des caractères.
Ces conversations, enfin, sont le lieu d'alliances à deux contre un, sans cesse changeantes. "Le déjeuner du lundi" apparaît ainsi comme un hommage rendu à l'art de la conversation à la française, dont les racines pointent aux XVIIe et XVIIIe siècles.
De la description au reportage
Le lecteur du "Déjeuner du lundi" est surpris d'emblée par une longue séquence descriptive qui occupe les premières dizaines de page du livre. C'est tout un microcosme que l'écrivain met en place, donnant à voir la rue parisienne où habite le père de Jean, avec une attention particulière accordée aux gens, avant de zoomer progressivement sur l'appartement, transformé en cabinet médical.
Cela pourrait paraître assommant, et il est vrai que dans les premières pages, l'auteur recourt à un style sobre, proche de l'observation d'un reporter. On ne s'ennuie cependant jamais: l'auteur aime filer la métaphore, que ce soit pour décrire telle concierge aux allures de canard ou l'outil de travail du dentiste, vu tel un arbre.
Le ton du reportage reste cependant une constante: en journaliste gonzo avant l'heure, Jean, tour à tour, relate le repas auquel il est invité et le commente, avec acuité. C'est à travers lui que le lecteur sait ce qu'il y a sur la table, mais aussi quels sont les ressorts des discussions et relations humaines – y compris avec Hélène, la bonne, que chacun considère à sa manière. Tout cela, avec une limite: si l'écrivain montre beaucoup, il dit aussi énormément, alors qu'on apprécie aujourd'hui le principe du "show don't tell", qui privilégie l'idée de montrer.
La structure même de ce récit aux allures de reportage adopte une manière de crescendo: peu à peu, le récit gagne en saveur, en truculence, en humour. L'auteur ne le souligne guère, mais le lecteur a le droit de penser que c'est là l'effet de la bouteille de bourgogne et des fines de la fin du repas, partagées jusqu'à perdre la notion du temps. Ou simplement le résultat du plaisir de plus en plus décontracté qu'apporte le partage de ce que le père appelle "un balthazar".
Nouveau Roman?
Il convient dès lors de souligner la modernité formelle du "Déjeuner du lundi", roman construit en trois parties (entrée, plat, dessert) qui mêle dialogues ciselés et descriptions, sur la base d'une intrigue minimale et autofictive, tout cela dans le contexte particulier de cet immédiat après-guerre où les Français sont encore tributaires des tickets de rationnement et du marché noir. Cette modernité n'exclut certes pas des références qui, familières en 1946, pourront paraître obscures au lecteur d'aujourd'hui: qui sont Mac-Nab ou Clara Tambour? Mais il convient de noter qu'il est déjà relativement novateur de citer ces artistes de la chanson, genre qu'on dirait mineur, dans une œuvre d'une certaine ambition littéraire...
Et dès lors, peut-on considérer que "Le déjeuner du lundi", certes pleinement ancré dans son temps, est aussi un Nouveau Roman avant l'heure? L'hypothèse séduit: l'intrigue est mince, les personnages sont ordinaires, les descriptions ont la précision d'une photographie haute résolution, façon Alain Robbe-Grillet. Il semblerait qu'on coche les bonnes cases du Nouveau Roman, l'une après l'autre...
Alors non mais oui: certes, "Le déjeuner du lundi" n'est pas le lieu de l'invention du Nouveau Roman, puisque les racines de cette approche puisent plus loin, dans "L'Education sentimentale", voire dans les procédés systématiquement déceptifs de "Jacques le Fataliste et son maître" de Denis Diderot. Cela dit, Jean Dutourd réussit avec "Le déjeuner du lundi" un magnifique "roman sur rien", comme le dirait précisément Gustave Flaubert. Du coup, ce récit qui colle au réel et assume l'héritage de Marcel Proust, Laurence Sterne et Louis Aragon apparaît, et c'est d'autant plus méritoire que c'est l'œuvre d'un tout jeune écrivain, comme un jalon important vers la manière des Sarraute, Butor et Robbe-Grillet – la sécheresse technique en moins. Il est injuste de l'oublier! Pétri de tendresse, fin et drôle, généreux et émouvant, surtout moderne sans être rebutant, "Le déjeuner du lundi" a toujours eu ses inconditionnels. J'en suis: ce compte rendu reflète les impressions de ma troisième relecture...
Jean Dutourd, Le déjeuner du lundi, Paris, Robert Laffont, 1947/Folio, 1986, Gallimard, 1980 pour la préface.
Challenge Je (re)lis des classiques, avec VivreLivre et Nathalie.