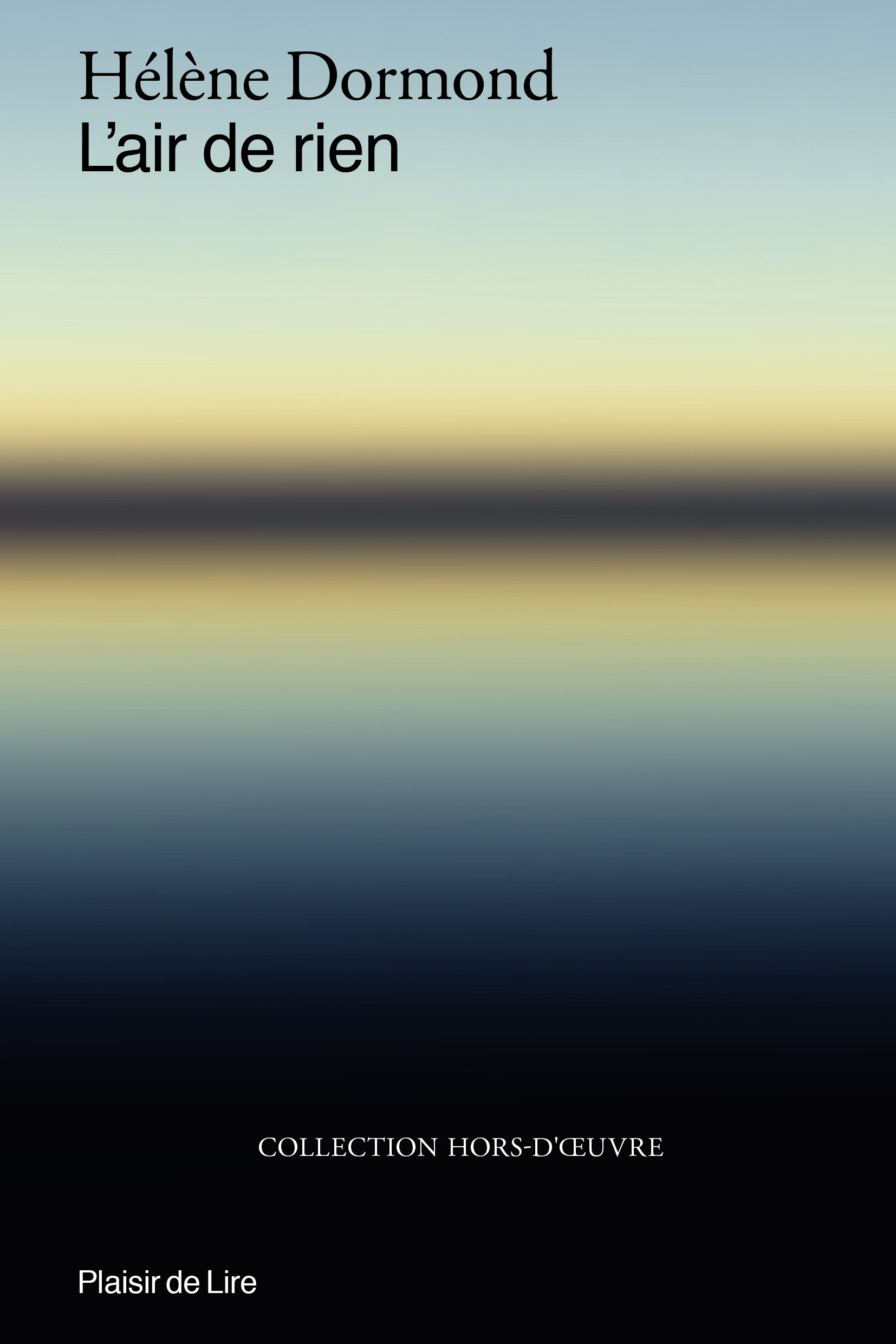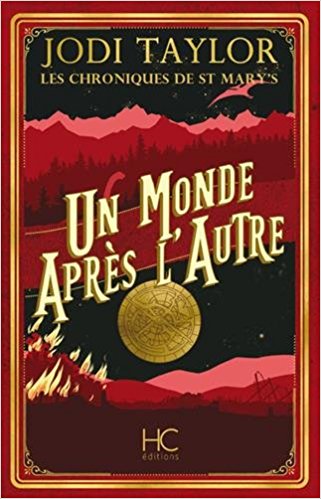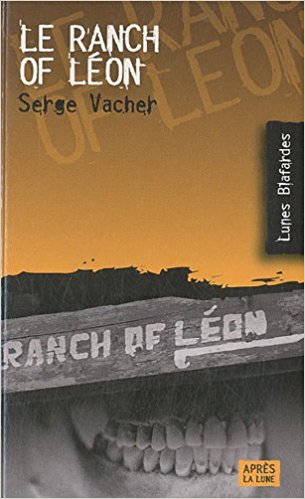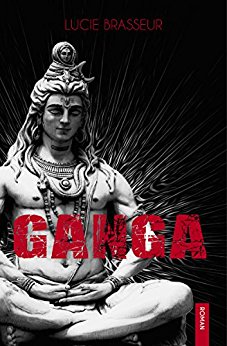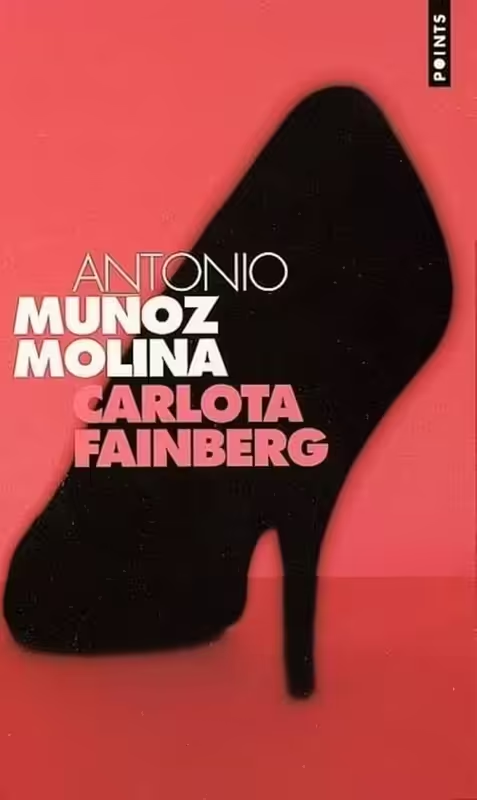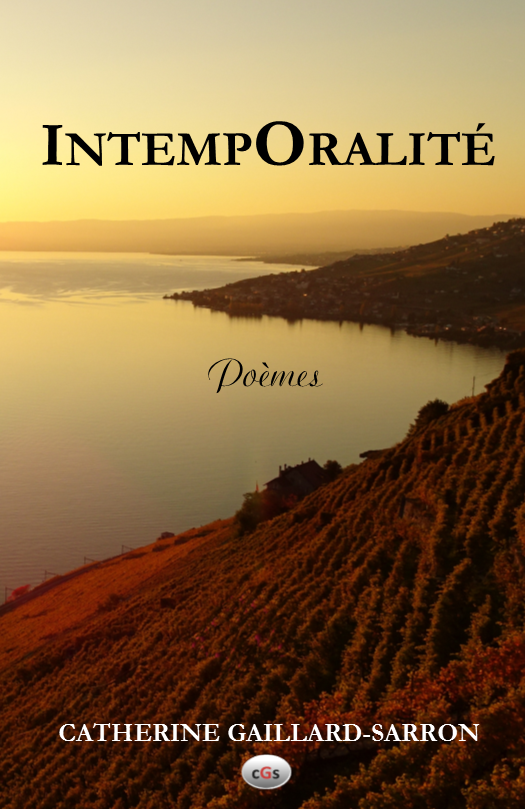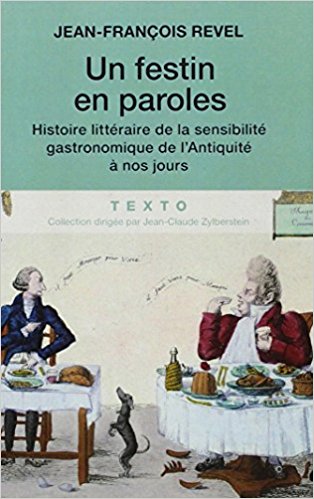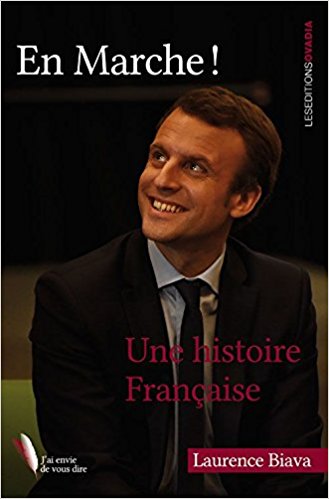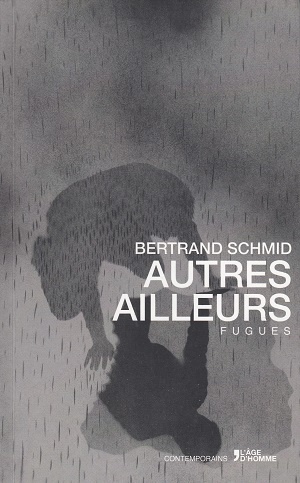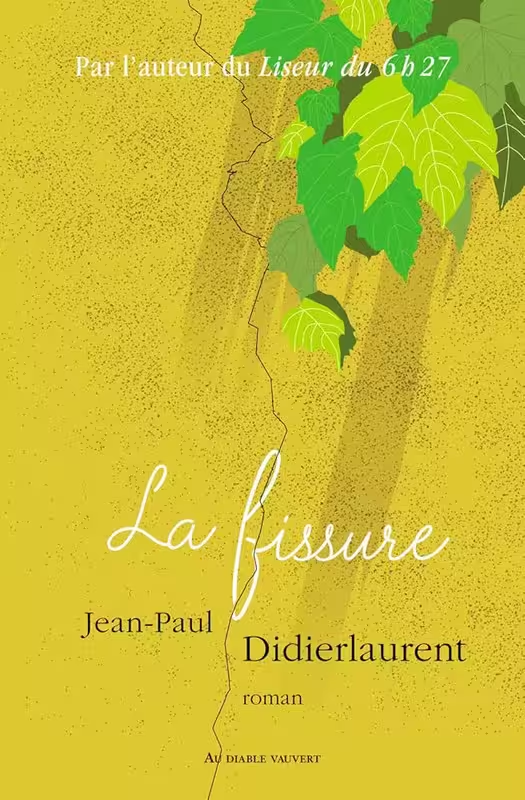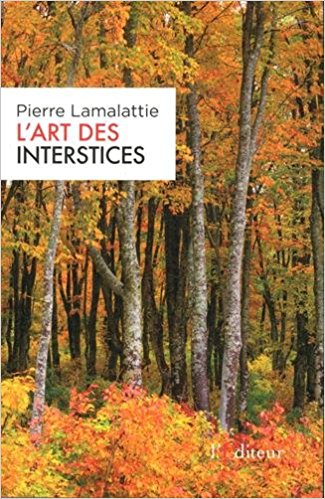
Pierre Lamalattie – Il flotte comme un parfum de sous-bois sur le dernier roman de Pierre Lamalattie, "L'art des interstices", qui s'intéresse aux humains en général, et aux artistes en particulier, qui essaient de se faire une place à l'ombre des géants, un peu comme la flore des sous-bois tente de prospérer sous les arbres.
D'où la notion d'interstices, protéiforme et récurrente dans le livre: ces interstices, ce sont ces lieux où la vie s'insère malgré tout, ces voies étroites qui permettent d'arriver à quelque chose, voire d'aller loin, quitte à se serrer un peu. L'idée est que de même que l'herbe pousse entre les interstices des pavés, l'humain en général, et l'artiste en particulier, peut grandir dans les interstices que des plus grands que lui veulent bien laisser libres. Et, peut-être, qu'évoluer dans ces interstices peut amener un supplément de liberté.
Concrètement, comment cela se présente-t-il? Une fois de plus, après "Précipitation en milieu acide", l'écrivain parle à la première personne du singulier et adopte un ton travaillé pour arriver à une simplicité d'écriture maximale qui, par contraste, met en évidence les éléments passionnés ou emportés qui arrivent parfois. Le narrateur est un journaliste veuf qui élève seul sa fille Seine, une post-adolescente de 17 ans qui se cherche alors qu'elle est près d'achever son lycée. Le récit va s'attacher à décrire cette relation, qui va s'approfondir au fil de visites rendues à des artistes pour réaliser une série de reportages culturels destinés à un journal spécialisé dans la pêche: le père écrit les articles, la fille prend des photos. Et peu à peu, trouve sa voie.
Journaliste dans un périodique périphérique, le narrateur peut adopter une posture d'observateur qui lui assure un sain recul et une certaine liberté de ton. C'est ainsi qu'on le voit exposer son point de vue sur l'art contemporain, qu'il faut "comprendre", comme il le dit souvent, sur un ton critique. Pour le lecteur, les visites chez les artistes (l'auteur cite des artistes qui existent réellement, soit dit en passant, tels que François Schuyten ou Adrian Ghenie...) ont quelque chose de répétitif, même si elles montrent la diversité possible des démarches de l'art d'aujourd'hui, montrées de façon attachante: de l'artiste scandinave original aux expositions où les galeries exposent ce qu'elles ont de plus cher et où l'on parle anglais même à Paris, en passant par une description sensible et réussie du Rolex Learning Center de Lausanne, tout y passe, avec une prédilection pour la "nouvelle figuration".
Critique, acerbe même, le narrateur l'est en revanche pour les grands artistes internationaux et pour l'art contemporain, jugé détaché du réel et interchangeable; il ne manque pas de rire un peu avec les sanisettes bleu-blanc-rouge de Lars Ramberg à Oslo, par exemple, ni de faire sauter quelques chiens en baudruche signés Jeff Koons. Enfin, tout autant qu'à travers les artistes rencontrés, le personnage de Florian, fonctionnaire terne et artiste passionné, permet à l'auteur de poser la question de la figuration en art, vue comme suspecte ou populaire (suspecte car populaire?), ainsi que celle de la possibilité d'une pratique artistique à l'ancienne, datée mais techniquement irréprochable: a-t-elle encore un public, ou celui-ci préfère-t-il l'art-placement?
Au-delà de ce regard affûté sur l'art contemporain dans toutes ses déclinaisons, l'auteur se montre aussi critique des petits et grands travers humains de notre temps, exposés dans le cadre de la ville de Paris. On y voit des gens bizarres, des dépressifs (dont la famille de feu l'épouse du narrateur). L'auteur s'amuse en particulier à voir comment peut se dégonfler une cérémonie solennelle de remerciement à un touriste américain noir qui a sauvé une fille – Seine, la fille du narrateur – de la noyade: est-ce parce que ledit touriste est, dans son pays, un politicien du parti de Donald Trump? L'auteur le laisse subtilement entendre... Côté vocabulaire, l'auteur, à la manière de Didier Goux dans "Le Chef-d'œuvre de Michel Houellebecq", se plaît à souligner les tics de langage actuels en les mettant en italiques, ainsi qu'à rappeler les poncifs d'un certain politiquement correct actuel: féminisme convenu (à travers Barbara, top manager et sœur de Florian), anticapitalisme cheap. Il assure aussi lorsqu'il s'agit de mettre dans la bouche de certains de ses personnages des discours en langue de bois massif.
Exploration ample et riche de la biodiversité des interstices, des bois et des sous-bois, succession attachante ou grinçante de portraits d'artistes et de gens ordinaires, "L'Art des interstices" a tout d'un véritable récit: il semble emprunter beaucoup à la vie de Pierre Lamalattie lui-même, ce que suggère par ailleurs le prière d'insérer. Le lecteur s'attache à ce père, ainsi qu'à Seine, sa fille, en marche pour trouver sa voie et acquérir la confiance en soi qu'il faut pour affronter le monde. Une marche qu'inaugure la fin ouverte de "L'Art des interstices".
Pierre Lamalattie, L'Art des interstices, Paris, L'Editeur, 2017.
Lu par Blog des Arts, Didier Goux, Dominique Cozette, Les Rapins.
Le site de Pierre Lamalattie, celui de L'Editeur.