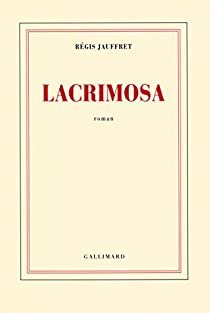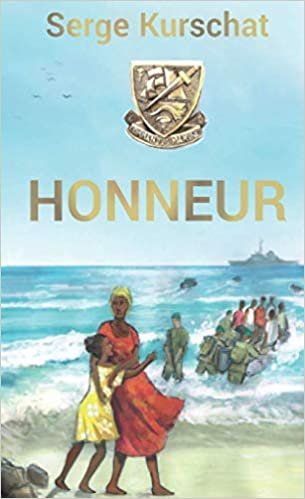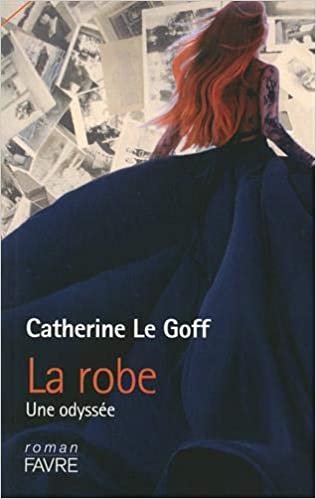Pages
dimanche 31 janvier 2021
Dimanche poétique 484: Henri de Régnier
jeudi 28 janvier 2021
Des lettres pour déconstruire le deuil, l'amour, la littérature
Régis Jauffret – Ecrire une lettre à ceux qui sont dans l'au-delà: plus d'un en a sans doute rêvé. Recevoir une réponse? C'est moins évident. Tel est pourtant l'hypothétique aller et retour épistolier que l'écrivain Régis Jauffret met en mots dans "Lacrimosa". Du côté des anges, on trouve Charlotte. Et du côté de la vie terrestre, un romancier bizarre qui fait figure de narrateur.
Surprise: loin de s'inscrire dans le sillon banal de la passion impossible, la dynamique du récit s'avère électrique. Entre les deux personnages, le jeu s'avère pour ainsi dire conflictuel. L'auteur pose ses balises d'emblée: dans sa première lettre, l'écrivain mis en scène dans "Lacrimosa" vouvoie soudain sa défunte amante, la mettant ainsi curieusement à distance.
Ce qu'elle relève! Ce n'est que le prélude à une démystification méthodique de l'épistolier demeuré vivant. Cela, en tant qu'être humain, en démasquant ses faiblesses et hypocrisies, par exemple des larmes surjouées au moment des funérailles. Mais les lettres de Charlotte, ricanantes, sont aussi une déconstruction de l'art de l'écrivain, systématiquement réduit à ses artifices, à son jeu de masques.
Pourtant, les lettres de l'écrivain ont aussi leur chic. Le lecteur gourmand en apprécie la musique cynique et grinçante, pétrie de vannes volontiers cruelles contre les uns et les autres. Et il sera servi! Mais l'écrivain du roman n'en fait-il pas un peu trop? Ses lettres pourraient alors apparaître comme une tentative de reconquête de sa part, mû par le désir d'aimer un fantôme. Ou un squelette...
Décalée, l'ambiance de "Lacrimosa" est aussi piquante, pour ne pas dire abrasive. Elle véhicule une tentative réussie de démystification des amours impossibles, des figures imposées du deuil (il faut pleurer, il faut prier), et de l'art d'écrire des livres, en y épinglant tant qu'à faire des gens qu'on a intimement connus. Et comme l'écrivain amoureux n'est pas nommé, il est permis de se dire que c'est à lui-même que Régis Jauffret, en virtuose désenchanté, fait ainsi procès.
Régis Jauffret, Lacrimosa, Paris, Gallimard, 2008.
Le site des éditions Gallimard.
Ils l'ont aussi lu: Cecibondelire, Excessif, Laure Limongi, Laxenia, L'empreinte des mots, Litt & Ratures, Stéphie, Tony Shaw, Tout pour les femmes.
lundi 25 janvier 2021
L'âme du violon, de la violoniste et de l'histoire
Yoann Iacono – Les violons ont une âme, dit-on. Est-ce pour cela que la cohabitation avec leur violoniste peut s'avérer incroyablement compliquée, comme dans un couple à vagues, où chacun a ses secrets malgré lui? Telle est la question qui traverse "Le Stradivarius de Goebbels", premier roman de l'écrivain français Yoann Iacono.
Il s'agit d'un roman historique, précisons-le d'emblée: l'auteur évoque librement le destin de la violoniste japonaise Nejiko Suwa, qui a reçu de Joseph Goebbels en personne un violon d'exception, attribué au légendaire luthier Stradivarius. Le donateur est aussi empoisonné que le cadeau: qui sait à qui ses équipes l'ont confisqué, se demande bien sûr le lecteur d'aujourd'hui, qui devine trop bien la vérité. Certes, l'auteur mène l'enquête, comme pour confirmer – on ne saura rien de l'instrument qui lui était familier avant.
Mais le cœur du roman est ailleurs: il réside dans la relation intime que Nejiko Suwa, jeune prodige prometteuse, s'efforce de construire avec ce violon, qu'elle a reçu solennellement et qu'elle est moralement contrainte de jouer en tant que musicienne d'orchestre, violon solo de la Philharmonie de Berlin.
L'auteur dessine ici une forme de lutte: le violon a son âme, imprégnée des souffrances de ceux qui l'ont joué avant elle et qui veulent être entendus. De l'autre côté, il y a une violoniste qui, sûre de son talent au point d'avoir quitté Tokyo et sa famille pour se perfectionner à Paris, se retrouve démunie face à un instrument qui lui résiste, semblant même lui imposer ses tempos.
Le souci est-il chez la violoniste? On pourrait penser à une manière de dystonie de fonction, telle qu'exposée par Aude Hauser-Mottier dans "La musique de la douleur". S'il ne va pas jusque-là, l'auteur évoque bien entendu les doutes qui traversent la violoniste, et qui vont la plonger dans des états dépressifs sévères. Mais, on l'a dit, l'instrument d'exception offert par Joseph Goebbels à Nejiko Suwa a sa vie à lui. L'écrivain en fait ainsi un personnage à part entière, creusant son histoire, challengeant son identité, rappelant ses propriétaires et leurs voix – à commencer par le souvenir de Lazare Braun, Juif déporté.
Que dire des ambiances, des décors? À partir d'un fait historique qu'on a pu oublier, l'écrivain dessine avec précision le décor des nazis triomphants puis défaits, le dernier concert offert à Hitler et à sa garde rapprochée au printemps 1945. Il évoque aussi le sort des Japonais, alliés des Allemands et déportés aux Etats-Unis par la puissance gagnante.
Et pour compléter l'histoire, il trace un parallèle entre le génocide perpétré par le régime nazi et les crimes de guerre japonais à l'encontre de la Chine. Tout cela résonne dans l'art musical de Nejiko Suwa, que l'auteur donne à voir comme la marionnette passive, juste musicienne, d'un jeu de guerre et de diplomatie qui la dépasse et à laquelle elle n'était pas préparée.
Pour le côté brillant, et pour flatter encore un peu les mélomanes qui ne manqueront pas de goûter ce roman, l'auteur rappelle encore les personnages de Hans Knappertsbuch et de Wilhelm Furtwängler, chefs d'orchestre immenses dont il donne à voir la mince ligne de crête qui leur permet d'exercer leur génie sans disgrâce, mais aussi sans jouer le jeu infâme des nazis. En contrepoint enfin, il y aura pas mal de jazz, en particulier avec Miles Davis ou Boris Vian à Paris, puisque le narrateur, Félix Sitterlin, est un trompettiste de jazz qui s'est retrouvé, par le hasard des années, sur le chemin de Nejiko Suwa.
Yoann Iacono, Le Stradivarius de Goebbels, Paris, Slatkine & Cie, 2021.
Le site des éditions Slatkine & Cie.
Lu par Le boudoir du livre, TLivres.
dimanche 24 janvier 2021
Dimanche poétique 483: Charles Baudelaire
vendredi 22 janvier 2021
"Théoda", le regard mûr d'une enfant sur son petit monde
 S. Corinna Bille – Une enfant parle. C'est Marceline. Sa voix à la fois ordinaire et singulière, c'est celle qui traverse "Théoda", premier roman de l'écrivaine suisse d'expression française S. Corinna Bille, paru en 1944. Est-ce l'auteure, un peu? Sans doute. "Théoda" est porté par le fil rouge d'un amour interdit, qui apparaît en pointillé jusqu'à l'issue tragique. L'auteure y accroche tout ce qu'a pu être la vie paysanne d'un Valais revisité ("La Vallée" – la romancière Sonia Baechler s'en est souvenue dans "On dirait toi", en 2013), en des temps immémoriaux.
S. Corinna Bille – Une enfant parle. C'est Marceline. Sa voix à la fois ordinaire et singulière, c'est celle qui traverse "Théoda", premier roman de l'écrivaine suisse d'expression française S. Corinna Bille, paru en 1944. Est-ce l'auteure, un peu? Sans doute. "Théoda" est porté par le fil rouge d'un amour interdit, qui apparaît en pointillé jusqu'à l'issue tragique. L'auteure y accroche tout ce qu'a pu être la vie paysanne d'un Valais revisité ("La Vallée" – la romancière Sonia Baechler s'en est souvenue dans "On dirait toi", en 2013), en des temps immémoriaux.Voix singulière? Marceline est une fillette d'une dizaine d'années lorsqu'elle se raconte dans "Théoda". Alors qu'aujourd'hui, un écrivain aurait tendance à surjouer les mots des gamins, la romancière valaisanne prête à Marceline des mots bien pesés, très écrits. L'impression laissée au lecteur d'aujourd'hui est donc celle d'une narratrice qui, pour son âge, apparaît très mûre, promenant sur son entourage un regard à la fois distancié et personnel, empreint aussi d'une poésie exprimée avec le naturel de l'évidence. On y croit aujourd'hui encore, sachant qu'autrefois, l'enfance ne pouvait se payer le luxe de se prolonger jusqu'à trente ans et au-delà.
Qui est Marceline, d'ailleurs? Ce "J'étais la huitième" qui ouvre le roman indique qu'elle est une voix parmi d'autres, à peine autorisée, celle d'un personnage ni cadet ni aîné, juste moyen tendance basse au sein du classement d'aînesse familial: "En tout, nous étions onze". Pourtant, sa parole compte, c'est celle que l'auteure va chercher: les derniers seront les premiers, dit-on.
Cette écriture est aussi celle de l'économie, de la rapidité même – celle qu'on peut apprécier dans des nouvelles, genre où S. Corinna Bille a brillé également. Aucun mot n'est de trop, les phrases conservent une construction simple, susceptible d'accrocher chacune et chacun. Cette simplicité, c'est sans doute aussi celle de l'univers villageois et montagnard où l'intrigue se noue.
Voyons cet univers. L'auteure le présente comme pour ainsi dire immuable, rythmé par les saisons et les rituels. Elle sait dire aussi ce que des choses banales aujourd'hui pouvaient avoir de précieux autrefois, à l'exemple d'une raclette dégustée avec ou sans religieuse, avec un doigt de vin blanc. Pourvoyeuse de rituels s'il en est, la religion et les fêtes plus ou moins tolérées par le catholicisme omniprésent sont présentes aussi: il y aura Noël, les masques de carnaval, la "Fête de Dieu". Sur tous ces rites, ces moments de vie parfois rares ou oubliés, l'auteure fait glisser un regard fluide: ce n'est pas du folklore, c'est la vie.
Il y a aussi un coup d'œil spécifique, mine de rien, sur la condition des femmes, astreintes à jouer leur rôle dans une société où chacune et chacun doit tenir sa place – souiller sa robe de noces, par exemple, ça ne se fait pas. Mais face à la mort, dans le chapitre "L'Echafaud", avant-dernier du roman, hommes ou femme, les condamnés sont tous égaux – la narration des trois exécutions successives, liquidées en une petite matinée, paraît en conséquence indifférente.
Et pourtant: c'est bien vers Théoda que convergent les fils de l'intrigue, Théoda qui fait figure d'étrangère parce qu'elle vient d'un autre village et qu'elle a épousé Barnabé, frère aîné de la narratrice. Nous les avons toutes et tous connus, ces gens venus d'ailleurs et qui s'installent dans notre petit monde confortable: un nouveau venu de loin dans notre classe d'école, par exemple, et qui exprime simplement sa personnalité que l'on peut percevoir en décalage et qui nous interroge. De Théoda, on a pu dire ce que dit un homme assistant à l'exécution qui clôt le roman, dans un résumé lapidaire et glaçant: "Elle aussi c'était une bâtarde. On voit bien qu'elle n'aurait pas dû naître: ils sont plus beaux que les autres, ils ont plus d'esprit, mais ils ne savent pas vivre..."
C'est cette différence qui suscite une forme de fascination mêlée de médisance au village. C'est pourtant sur un autre terrain, plus intime, que son sort va se sceller. Economie du style toujours, l'idée tient en trois mots, ceux de Marceline, porteuse malgré elle d'un lourd secret: "Ils étaient ensemble" (p. 45). Sachant que Barnabé n'est pas inclus dans le "Ils": ménage à trois mots, mais pas à trois êtres.
Rémi Carroz le personnage décapité, amant de Théoda, a-t-il été l'aïeul de S. Corinna Bille? C'est ce que laisse entendre une dédicace de l'écrivaine à l'éditeur et écrivain suisse romand Bertil Galland. L'écrivaine part ainsi de choses vécues ou lues pour recréer un univers qui vit centré sur lui-même (la lucarne vers le monde est bien restreinte, représentée par le personnage du légionnaire Léonard, frère de la narratrice, et ses rares lettres), autour d'un rythme de vie qui paraît aussi immuable que la ronde des saisons, et qu'une affaire de mœurs vient brièvement détraquer. C'est que le dernier chapitre rappelle que Marceline existe. Et qu'elle a changé depuis le début du roman, puisqu'elle n'est désormais plus une fillette.
S. Corinna Bille, Théoda, Albeuve, Castella, 1978, préface de Georges Anex. Première édition en 1944.
dimanche 17 janvier 2021
Dimanche poétique 482: Danielle Risse
samedi 16 janvier 2021
Sierra Leone et Congo: un ancien raconte
Serge Kurschat – Après l'étude historique "Pierre-Nicolas Chenaux, le révolté gruérien", l'écrivain et historien Serge Kurschat nous revient avec un récit court et beaucoup plus personnel, "Honneur". Un beau mot, noble, porté haut tout au long de ce livre qui assume le fait d'être la relation fidèle aux noms près d'une tranche de vie de l'écrivain, intense, entre Congo et Sierra Leone. C'est que Serge Kurschat, actuellement écrivain et instructeur de self-défense en Suisse, a également été fusilier marin pour l'armée française – un "béret vert badgé à gauche". Troupe d'élite, dit-il: en être, tel est le premier honneur.
Si l'auteur souligne que tout est vrai dans "Honneur", force est de constater qu'il sait agencer cette vérité dans une volonté d'en faire un roman. On commence bien loin du cœur de l'action, lorsqu'un père de famille, Baptiste, reçoit par lettre une invitation à participer à une soirée de bienfaisance à New York. L'événement est exceptionnel, et l'auteur le souligne: le courrier n'arrive qu'une fois par mois dans son patelin mexicain, et chaque lettre est un événement. Atteint dans sa santé – mais n'est-ce pas un prétexte? – Baptiste hésite à y aller, son fils le persuade. Et c'est parti pour un immense flash-back...
Le lecteur amateur de militaria appréciera certes la description de l'adversité, des mouvements de troupes face à des adversaires hostiles à l'armée française présente entre la Sierra Leone et le Congo – nous sommes dans les années 1997. L'auteur émaille son livre de photos de son équipe, pour donner corps à ce propos. Mais s'il est précis pour dire l'action, il est souvent rapide aussi. Comme si l'essentiel n'était pas là.
Et justement, l'essentiel est bel et bien ailleurs. Et ce n'est pas pour rien que l'écrivain place au cœur de son récit la rencontre entre Baptiste dit Tac-Tac, le radio d'un bateau d'évacuation de réfugiés, et Ishmael, alias Demi-Portion, un gamin qui a fui les combats. Tel est le cœur du texte, et c'est à New York que tout va se dénouer. Séquence émotion garantie! Prenant une place prépondérante dans "Honneur", nourrie même par une histoire amoureuse, l'histoire d'Ishmael glisse dans le récit le thème des enfants soldats de Sierra Leone, abordé également par Jean-Claude Derey dans son roman "Les anges cannibales".
Entre-temps, l'auteur a eu le temps d'évoquer aussi les liens des militaires français avec les civils, en particulier ces Français pas toujours reconnaissants pour la protection conférée par les troupes, ou alors imbues d'elles-même. Il y aura aussi ce ministre qui rencontre les officiers mais se garde bien d'aller saluer les hommes de terrain. Ou ces collèges militaires pas toujours exactement à l'écoute. Honneur toujours: le combattant ravale sa rancœur, ne fait que faire preuve d'un sens aigu du devoir. Mais il n'oublie pas – ce que rappelle un "Je me souviens" à la Georges Perec, hommage sans concession, qui offre au lecteur une synthèse de la vie d'un militaire soudain plongé avec d'autres, toute une escouade, au cœur d'une guerre oubliée des médias.
Serge Kurschat, Honneur, auto-édition, 2020.
Le site de Serge Kurschat.
Lu par Irène Ferrari.
jeudi 14 janvier 2021
Catherine Le Goff, une robe pour traverser le vingtième siècle
dimanche 10 janvier 2021
Dimanche poétique 481: Jean-Pierre Claris de Florian
vendredi 8 janvier 2021
Vivre en homme, malgré soi
Emmanuelle Favier – Premier roman d'Emmanuelle Favier, "Le courage qu'il faut aux rivières" assume son caractère de fiction, fondé sur la tradition pourtant bien réelle des "vierges jurées", présente en Albanie entre autres, et qui veut que certaines femmes, en certaines circonstances, renoncent à leur condition de femme – dans le contexte d'une société clairement patriarcale. Au travers de quelques personnages, la romancière imagine ainsi ce que peut être une telle existence.
On le comprend: vivre comme un homme à la suite de diverses circonstances pas forcément volontaires, ça peut avoir ses avantages. Les vierges jurées mises en scène dans "Le courage qu'il faut aux rivières" ont ainsi le droit de fumer, s'habillent comme des garçons. L'auteure relève que Manushe, l'un des personnages, porte une montre: c'est innocent vu comme cela, mais dans un tel contexte, c'est le fait d'un homme, les femmes n'étant pas autorisées à en porter. Ces "avantages" symboliques n'enlèvent pas de la tête du lecteur tout ce qu'une telle existence peut avoir d'aliénant.
"Le courage qu'il faut aux rivières" met en scène des femmes qui sont contraintes de vivre un sexe, ou un genre, qui qui leur a été assigné et n'est pas le leur. La première partie est vue à travers le personnage de Manushe, villageoise vivant en homme et n'ayant connu que cela. Tout bouge dès lors qu'Adrian fait irruption dans sa vie: elle doit l'héberger, et une relation trouble, dépassant les devoirs sacrés de l'hospitalité, s'installe entre ces deux personnages. Et pour que le trouble ne soit pas là où le lecteur le croit, l'auteure joue un jeu à double détente: en effet, Adrian n'a pas le genre de son prénom, ni celui de ses manières galantes. Ce que la grammaire, fluide au fil du roman, louvoyant entre il et elle, souligne.
Dès lors, alors que le lecteur s'est attaché à Manushe dans la première partie du livre, c'est Adrian qui va prendre toute la lumière dans la deuxième partie du livre, la plus longue aussi. Celle-ci va détailler ce que peut être la vie d'une femme qui vit en homme, qui a été conditionnée pour le faire et qui, de façon coutumière, n'a pas le droit de revenir à son sexe biologique. L'auteure place face à face un village et une ville. Si le village apparaît évidemment engoncé dans des traditions d'un autre temps, la vie en ville ne s'est pas radicalement débarrassée des vieux réflexes non plus.
Astuce d'écriture: la troisième partie renoue avec la première, avec le point de vue d'Adrian cette fois-ci – on le relève au plus tard lors de la première réplique d'Adrian, déjà vue au début du roman. Et l'ouvrage repart, évoquant la promesse d'une autre vie, entre deux personnages, Manushe et Adrian, que la vie a intimement soudés, qui se sont réapproprié leur corps et sont enfin au clair avec elles-mêmes.
Pour ses personnages, l'auteure dessine un contexte aux allures archaïques et immuables en allant à l'essentiel, aux personnages et aux choses de toujours. Les traits de modernité, une montre ou une voiture, paraissent dès lors presque anachroniques. Jamais l'auteure ne juge, et c'est là sa force: elle se contente, et c'est beaucoup, d'observer ces personnages évoluer dans ce contexte, vivant avec les injonctions d'une société étrange qui impose un certain trouble dans le genre.
Emmanuelle Favier, Le courage qu'il faut aux rivières, Paris, Albin Michel. 2017.
Le site des éditions Albin Michel.
Lu par Antigone, Ariane, Butcher Book, Domiclire, Emma, Femmes de lettres, Gambadou, Itzamna, Henri-Charles Dahlem, Je lis et je raconte, Jostein, Lailai, La Marmotte à lunettes, Léa Touch Book, L'Ivresse littéraire, Madimado, Marie-Eve, Mes mots mes livres, Murielle, Nicole Grundlinger, Noémie, Sabeli, Une souris et des livres.
lundi 4 janvier 2021
Mindy Klasky, le mec était trop idéal...
Mindy Klasky – Il n'est pas évident de trouver l'homme de sa vie lorsqu'on est une bibliothécaire de trente ans dotée de talents de sorcière. Jane Madison en sait quelque chose! "Comment trouver (rapidement!) l'homme idéal?" constitue le second tome de la trilogie qui relate ses aventures, après "Comment je suis devenue irrésistible". La romancière américaine y associe avec un bonheur certain les genres de la romance et du merveilleux.
Alors oui: à l'instar de la blogueuse du "Monde éditorial", le lectorat français peut être désarçonné par cette alliance entre deux genres a priori distants, d'autant plus que rien, sur le livre, ne l'en avertit. Le titre français est accrocheur mais passe-partout, au contraire du titre original anglais qui, lui, est explicite. Pour ne rien arranger, la quatrième de couverture est du même tonneau et même le personnage féminin qui trône en couverture, si charmant qu'il soit, n'a rien de Jane Madison, si ce n'est des cheveux roux.
Mais passé la surprise, voyons ce que ce roman a dans le ventre...
... Il s'agit donc du tome deux d'une trilogie. Quelques éléments sont supposés connus depuis le premier volume de la série, par exemple l'étrangeté du personnage de Neko, à la fois chat et humain ou, de façon plus générale, les rapports pas toujours évidents que Jane Madison entretient avec les hommes qui l'entourent sans arrière-pensée romantique, tels que David, gardien et coach en sorcellerie. On relève cependant que certains éléments sont dûment rappelés, par exemple l'installation de Jane Madison dans un cottage dont le sous-sol est bourré de livres et d'objets de sorcellerie.
Et voilà: Jane Madison se retrouve face à un homme absolument splendide et impeccable, Graeme, bien sous tous rapports à la puissance dix, attentionné, sexy, matériellement à l'aise. Trop bien pour être honnête? Telle sera la question qui va traverser tout le roman. De façon classique, l'auteure va donner la parole aux amies et amis de Jane qui la mettront en garde, mais longtemps, elle n'en aura que faire – plongeant aussi le lecteur dans le doute: une façade si parfaite peut-elle masquer de sombres desseins?
Jane Madison est d'ailleurs une trentenaire d'aujourd'hui, jonglant avec le sourire (plus ou moins) entre divers rôles au risque de se disperser. Bibliothécaire, elle se retrouve plus souvent qu'à son tour à tirer des cafés pour les lecteurs ou à gérer la marmaille qui vient assister à ses lectures familiales. Sorcière, elle affûte ses sortilèges pour intégrer une société très sélect. Amoureuse, elle vit soudain une vie sentimentale bien remplie. Humaine, elle a une mère et une grand-mère encombrantes. Cela, au risque d'oublier la fidèle amie Melissa, pâtissière de son état. Une telle diversité d'activités permet à l'auteure d'alterner quiproquos et gags de situation, tout en développant des personnages secondaires assez cocasses – et de suggérer la question de la charge mentale et de sa gestion.
Quant au motif des sorcières, il est devenu indissociable d'un certain féminisme moderne qui entend dégommer les stéréotypes négatifs qui leur collent à la peau. Certes, la société que Jane Madison cherche à intégrer n'efface rien à ces stéréotypes en raison de son côté arbitrairement exclusif: pas de sympathie à rechercher de ce côté. Mais c'est là que Jane Madison brille pourtant, qu'elle domine – en particulier David et Neko, des gars, certes présents lors des réunions de la société, mais relégués dans un fumoir à part dont on ne saura pas grand-chose. La sorcellerie est donc présentée comme un lieu de domination féminin, porté par la magie. Un écho au talent presque magique avec lequel Jane Madison maîtrise en jongleuse sa vie aux multiples facettes, si prosaïques qu'elles soient. Attachante, elle constitue finalement la meilleure pub pour réhabiliter les sorcières d'antan!
Le motif des sorcières est du reste présent dans l'œuvre de Shakespeare, qui s'insère tout naturellement dans l'imaginaire du personnage de la bibliothécaire et chercheuse Jane Madison. Le lectorat le plus au fait de l'œuvre du dramaturge anglais, ou simplement celui qui l'a travaillée à l'école, se délectera donc des citations qui émaillent "Comment trouver (rapidement!) l'homme idéal?", traçant un jeu de piste astucieux, intégré avec souplesse à l'intrigue.
Cela dit, en fin de roman, Jane Madison n'aura pas de réponse à la question qui constitue le titre de ce roman – tout au plus une ouverture annonciatrice d'un troisième livre, "Jane, l'amour, la vie... et les hommes!". Et en refermant le livre, le lecteur (ou la lectrice) aura eu le plaisir de suivre une intrigue bien troussée, soucieuse des détails – qu'il s'agisse des péripéties ou des arcanes de la magie. Attention cependant: si, en se fiant au titre, le lectorat francophone s'attend à une nouvelle version des "Tribulations de Tiffany Trott" d'Isabel Wolff, où une femme d'âge moyen recherche désespérément un homme par voie de petites annonces (ce qui nous vaut une galerie de mecs navrants), il risque d'être déçu. Mieux vaut donc oublier ce titre et se laisser porter par la magique légèreté du roman de Mindy Klasky.
Mindy Klasky, Comment trouver (rapidement!) l'homme idéal?, Paris, Harlequin, 2011, traduction de Nadine Ginape-Mercier.
Le site de Mindy Klasky, celui des éditions Harlequin.
Lu par Dunky, Esmeraldae, Le Monde Editorial, Ursula Dubois.
dimanche 3 janvier 2021
Dimanche poétique 480: Jean Godard
vendredi 1 janvier 2021
Bonne année 2021!
... il est l'heure de changer de millésime! Visiteurs de passage, amis fidèles de ce blog, je vous souhaite une excellente nouvelle année! Que la santé soit bonne, et que la nouvelle année vous apporte encore bien davantage: du succès, une vie plus aisée au quotidien, quelques bonnes tables, des chantées sans fin à la chorale, de la culture ailleurs que sur écran, des mains serrées et des embrassades comme s'il en pleuvait!
Source de l'image: Messages d'amour.