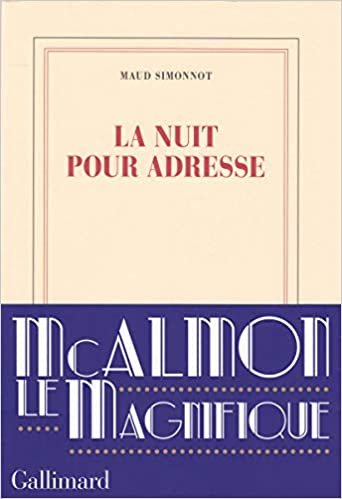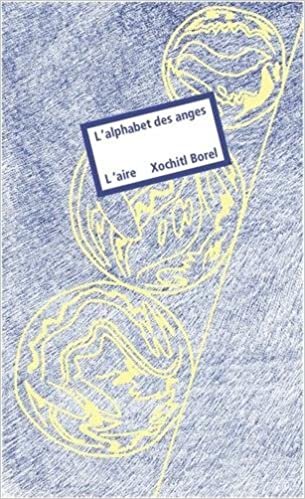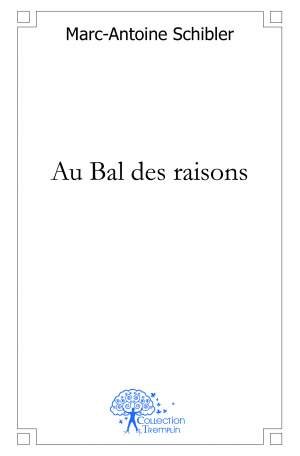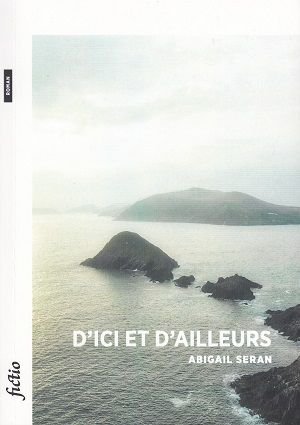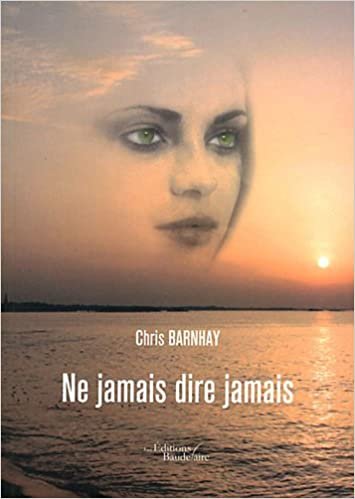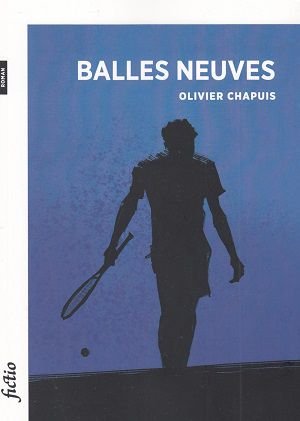Maud Simonnot – Les Américains à Paris, c'est tout un poème. Surtout pendant les années 1920. Surtout s'ils sont écrivains. Avec "La nuit pour adresse", publié chez Gallimard, l'écrivaine Maud Simonnot fait revivre cet univers, tissé de beuveries homériques jusqu'au bout de la nuit, de littérature flamboyante et d'humanité exacerbée, pour le pire comme pour le meilleur. Cela, en plaçant au cœur de son propos Robert McAlmon, écrivain et éditeur américain, fugace protecteur des arts à la manière anglophone du côté du Quartier latin.
L'écrivaine s'adonne à un exercice qui pourrait paraître ingrat, mais s'avère essentiel: aller voir les gens oubliés, hommes comme femmes, qui se sont trouvés un jour ou l'autre à l'origine de la gloire des autres – des êtres généreux auxquels on n'a pas toujours su dire merci. "McAlmon le magnifique", comme le dit le bandeau de couverture, est ainsi présenté comme un personnage généreux, en termes financiers mais aussi de réseau, à l'origine du succès d'auteurs tels que James Joyce ou Ernest Hemingway.
James Joyce? Avec "La nuit pour adresse", le lecteur ne peut que se laisser envoûter par le talent narratif de l'écrivaine rappelant les vicissitudes liées à l'édition d'"Ulysse": impression au loin, demandes de corrections de dernière minute par l'auteur. L'auteure ne manque pas de désenchanter le mythe, cependant: certaines exigences relèvent de la lubie alcoolisée davantage que du pur génie. Mais l'esprit est dans le vin, n'est-ce pas?
Parlons-en, du vin: au travers de McAlmon et de la nuée d'écrivains qui l'entourent, l'auteure dessine le petit milieu des écrivains anglophones concentrés du côté du Quartier latin, et plus précisément d'une librairie, Shakespeare and Company. Les amoureux de Paris savent qu'elle se trouve face à Notre-Dame; mais au temps de Robert McAlmon, elle était plus au sud, vers l'Odéon, et Sylvia Beach en était la protectrice, accueillant et facilitant la carrière d'auteurs dont les noms résonnent encore aujourd'hui, peu ou prou: Djuna Barnes, John Glassco, Louis Aragon même. Et comme nous sommes dans les années folles, le carburant est bel et bien l'alcool, généreusement consommé et partagé dans des bars et brasseries aussi mémorables que le Dôme ou la Rotonde.
Mettant en scène des caractères aussi forts que ceux des écrivains, l'auteure ne manque pas d'évoquer la difficulté qu'on peut avoir à s'accorder. Cela commence par le mariage de convenance de McAlmon avec une certaine Bryher, riche à millions. Plus tard, il y aura l'amitié non sans nuages de McAlmon avec Ernest Hemingway, présenté comme un auteur viriliste, féru de tauromachie et considérant l'homosexualité comme une faiblesse – mais rappelant aussi, et c'est un programme pour "La nuit pour adresse", que "Paris est une fête". Dans ces conditions, la confrontation peut prendre la forme d'un combat de boxe improvisé...
Enfin, la romancière place quelques hypothèses pour expliquer l'effacement de Robert McAlmon, poète et surtout soutien essentiel à toute une génération d'écrivains anglophones, une "génération perdue" comme qui dirait. On y trouve de l'ingratitude, de l'oubli, du ressentiment parfois. L'auteure prend cependant la défense du décalé McAlmond, dandy bisexuel, rappelant que si utile qu'il ait été, ni nanti ni universitaire, il n'était pas raccord avec son milieu – qui n'a d'ailleurs pas brillé par sa gratitude. McAlmon, écrivain perdu de la génération perdue? Certes.
De "La nuit pour adresse", le lecteur retient le talent de conteuse de l'écrivaine, capable de captiver son lectorat à partir d'éléments qui, sous leur apparence anecdotique, s'avèrent révélateurs – on pense là à l'épisode du chien mort, offrant à Hemingway l'occasion de poser en écrivain face aux passagers d'un train. Dans le monde gris des amitiés et des rognes, des amours et des emmerdes, elle réussit à faire revivre tout un univers artistique aussi flamboyant qu'une nouvelle bohème, lubrifiée par l'argent facile.
Maud Simonnot, La nuit pour adresse, Paris, Gallimard, 2017.