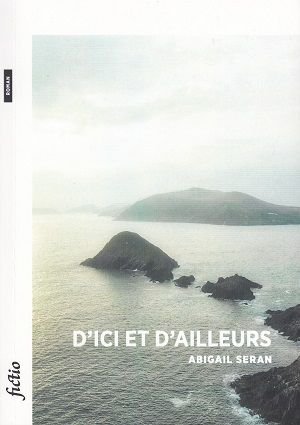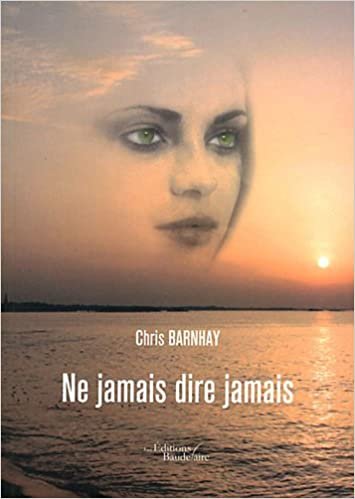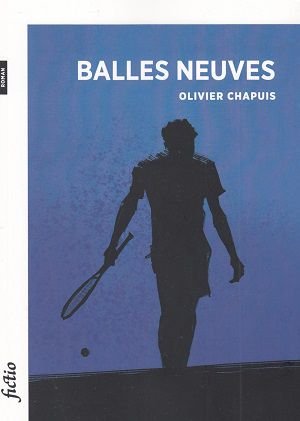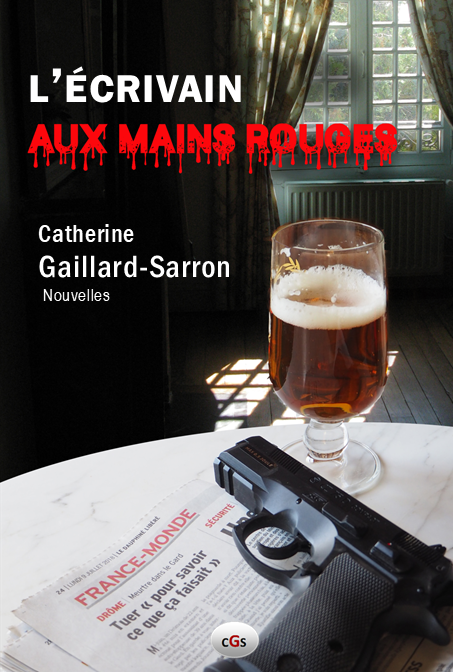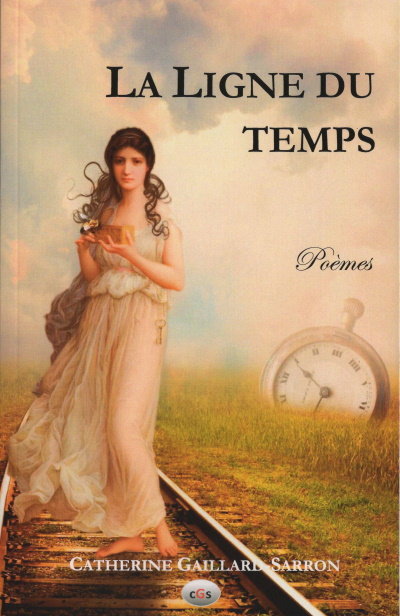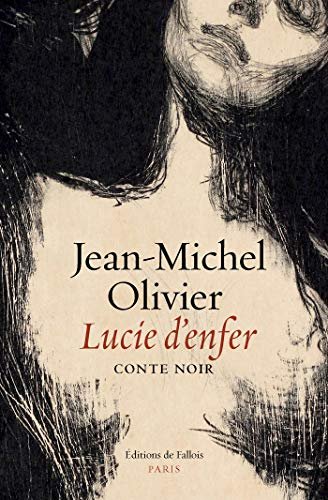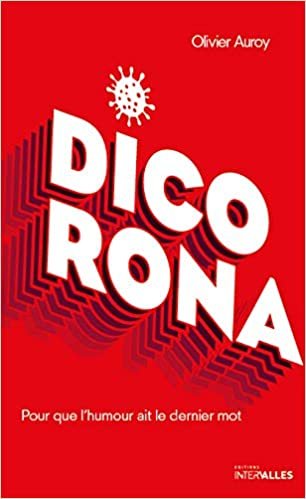Abigail Seran – Trois semaines avec mon oncle: tel aurait pu être le titre de "D'ici et d'ailleurs", le dernier roman de l'écrivaine valaisanne Abigail Seran. Vaste et dense, c'est aussi un livre du retour aux sources. En effet, c'est à travers les yeux de Léanne, dite Léa, que le lecteur aborde l'intrigue.
Léanne ou Léa, d'ailleurs? Ce changement de prénom illustre parfaitement la rupture qui marque le début dans la vie de ce personnage. Léanne devient responsable marketing d'une grosse entreprise, à la force du poignet, ce qui lui permet de se payer des objets de marques chères et citadines et, croit-elle, de considérer de haut les gens des petites villes – y compris ceux de celle d'où elle vient. Autre vie, autre prénom... mais les circonstances vont la ramener dans la cité où elle a grandi.
L'auteure pose dès lors un dispositif qui rythme le roman: Léa est impérieusement chargée de rendre visite chaque jour à l'Oncle Luc, sur demande de sa mère, femme joviale mais au quotidien rigoureusement réglé, qui a choisi de partir en vacances en fin d'automne. L'oncle, lui, vit dans un établissement médico-social et paraît divaguer. Comme vacances, il y a plus sexy, et ce point de départ peut sembler un prélude à l'ennui – d'autant plus que "D'ici et d'ailleurs" prend son temps pour se mettre en place.
Mais il n'en est rien: peu à peu, l'ouvrage prend de la vitesse et finit par happer son lecteur. D'abord, les journées ne se ressemblent pas dans la petite ville où Léa redevient Léanne. Redevenir Léanne, c'est retrouver les copains d'école, qui ont trouvé leur voie dans la région, voire un homme plus âgé qui fut l'a émue autrefois. Le charme va-t-il renaître? Face à ces retrouvailles sporadiques, l'auteure va apporter des réponses nuancées, mais en suggérant à plus d'une reprise que les relations mortes, désenchantées, ne reprennent pas – alors que d'autres, solaires et merveilleuses, peuvent soudain s'imposer, à l'instar de Gloria, la voisine, et de son fils Nathan.
Il est à noter que l'alcool joue un rôle constant de révélateur dans ce roman. L'auteure a la sagesse de ne pas juger la consommation considérable d'alcool de Léa, la considérant plutôt comme une donnée qui offre des potentialités et délie les langues, voire les audaces. Quitte à ce que cela débouche sur un fiasco à l'occasion.
C'est cependant vers l'Irlande que tout va se dénouer, du côté de Kylemore Abbey, et que le lecteur va savoir qui est "Niv". Un indice: à l'instar du français, le gaélique irlandais ne se prononce pas comme il s'écrit, et la romancière joue avec cela pour créer du mystère. C'est à travers les livres, aussi, que Léa, soudain captivée, va se plonger dans l'existence de cet Oncle Luc qui pour elle, au départ, n'est qu'un vieillard qui divague. Romancier, en effet, il a aussi vécu ses années les plus intenses du côté des îles sauvages de la verte Erin.
Contrainte de renouer avec ses racines, Léa finit transformée par ce séjour a priori imposé. Signe littéraire: en fin de roman, peu importe que Léa soit nommée Léa ou Léanne – signe que le retour aux sources a été couronné de succès. Le lecteur aura même droit au pincement au cœur d'une Léanne qui dort pour la toute dernière fois dans sa chambre d'enfant. Et en refermant le livre, il gardera le sentiment d'avoir lu un roman chargé d'émotion sur les liens complexes et fascinants qui relient les humains entre eux, par-delà les générations.
Abigail Seran, D'ici et d'ailleurs, Lausanne, BSN Press, 2020.
Le site d'Abigail Seran, celui des éditions BSN Press.