"Bullshit jobs" est l'ouvrage d'un chercheur qui assume un positionnement anarchiste. On le constate dès le départ: l'auteur insiste sur le fait que les jobs à la con prospèrent aussi dans une société capitaliste et libérale où tout ce qui est de trop devrait être élagué. Il est permis de voir du manichéisme dans le propos. Mais il arrive aussi à l'auteur de renvoyer gauche et droite dos à dos, comme les deux facettes d'un même establishment.
L'auteur relève que le secteur privé a aussi ses employés qui ne servent à rien, voire qui nuisent à leur entourage – et rappelle que ce n'est pas l'apanage de la fonction publique ou des régimes communistes. C'est par touches qu'il définit le job à la con, en y intégrant la part de subjectivité inhérente à celui qui l'exerce et se sent inutile. Et si ces employés inutiles et navrés de l'être sont quand même engagés, c'est pour des raisons qui ont entre autres à voir avec le prestige, par exemple une secrétaire embauchée juste parce qu'un chef sans secrétaire, ça ne fait pas sérieux.
La nomenclature des différentes catégories de jobs à la con a un côté provocateur, avec ses larbins, ses porte-flingue, ses rafistoleurs, ses cocheurs de cases et ses petits chefs. Il convient de rappeler que David Graeber distingue les "jobs à la con", radicalement inutiles mais souvent bien payés, des "jobs de merde", souvent très utiles mais pas reconnus à leur juste valeur. Décomplexé, il va jusqu'à se demander si tueur à gages ou mafieux est un job à la con (et sa réponse, argumentée, est négative).
L'auteur développe une vision tous azimuts du type d'emploi qu'il dénonce. "Bullshit jobs" s'intéresse ainsi à l'évolution du rapport des humains à l'emploi et au travail, faisant endosser sa part de responsabilité à une morale issue du christianisme et qui valorise le travail plutôt que l'oisiveté – il aborde même les fluctuations du rapport de l'homme au temps, suggérant qu'un emploi à horaires fixes toute l'année n'a rien de naturel, mais que l'humain est conditionné à l'accepter dès ses années d'école.
De façon plus ciblée, il dit aussi comment un job à la con peut déstabiliser un collaborateur qui découvre rapidement qu'il ne sert à rien. On le verra déstabilisé parce qu'il n'ose pas avouer qu'il s'ennuie, ni qu'il fait autre chose (faire le wikignome, étudier la rythmique de la musique indienne, etc.); on le verra aussi développer des stratégies pour paraître occupé. Et comme l'auteur s'intéresse à l'humain, il fonde l'essentiel de son argumentation sur de nombreux témoignages, amplement cités et ordonnancés. Cela lorgne vers la notion de syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui, étudiée par Peter Werder et Philip Rothlin, puis par Christian Bourion, mais l'auteur ne cite pas cette notion.
Quant aux origines des jobs à la con, l'auteur les identifie dans une société vue comme classiste (les riches concèdent des places, mais n'en donnent pas le mode d'emploi à ceux qu'ils engagent), raciste (on propose aux minorités raciales des emplois apparemment brillants, mais ayant un impact nul) voire sexiste/patriarcale. Le lecteur peut même suspecter un réflexe luddiste dans une entreprise qui refuse l'automatisation de tâches ingrates par l'informatique, proposée par un titulaire d'un job à la con, simplement parce que cela réduirait la part de travail de certains barons.
Que faire, alors? En un dernier chapitre, l'auteur développe l'idée d'un revenu universel de base. D'une tonalité militante, son discours y est clairement favorable, quitte à éluder les difficultés qu'une telle option présente. Il résonne avec le postulat de départ: la productivité a tellement augmenté qu'on devrait avoir aujourd'hui une semaine de travail de 15 heures - or, nous le savons, ce n'est pas le cas.
Tiens! A plus d'une reprise, "Bullshit jobs" résonne avec "La Fin du travail" de Jeremy Rifkin. Mais alors que ce dernier voit la fin du travail d'un œil inquiet (on relèvera avec amusement que si Graeber voit émerger des emplois de petits chefs partout, Rifkin souligne les dégâts sociaux de leur disparition...), David Graeber la voit d'un bon œil, moyennant l'introduction d'un revenu de base.
Nous avons tous une part de bullshit dans notre job actuel, et "Bullshit Jobs" permet d'y réfléchir – en observant des emplois radicalement inutiles et délétères. C'est un petit livre qui peut paraître parfois un peu rapide. Mais c'est aussi un opus extrêmement documenté, aux arguments solides. Et à l'instar d'autres ouvrages américains du même genre (on pense aux "Nouveaux cobayes" de Dan Lyons), il est parfaitement accessible, agréable et même drôle à lire. Et délibérément polémique, bien sûr.
David Graeber, Bullshit Jobs, Paris, Les Liens qui libèrent, 2019.
Le site des éditions des Liens qui libèrent.
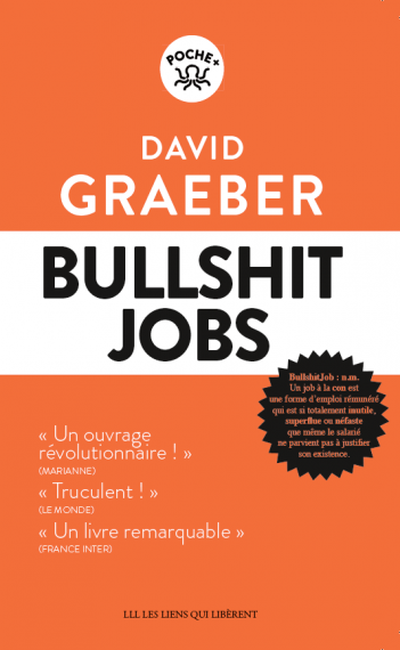
Ce n'est donc pas un pavé ? J'avais peur qu'il soit trop long.
RépondreSupprimerIl n'a rien d'insurmontable: c'est 436 pages, en format de poche, et c'est écrit de manière agréable et accessible, non exempte d'humour. A essayer!
SupprimerA essayer, d'accord - à trouver en bibliothèque dès que possible?
RépondreSupprimerJe pense que j'y trouverai des résonances avec d'autres auteurs (Dominique Méda?)...