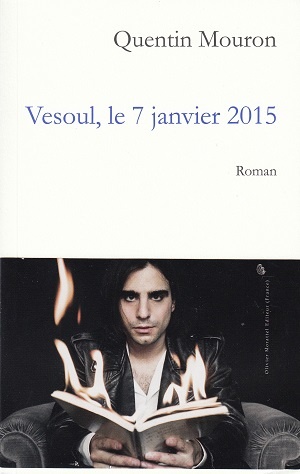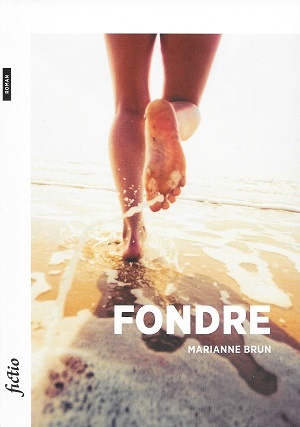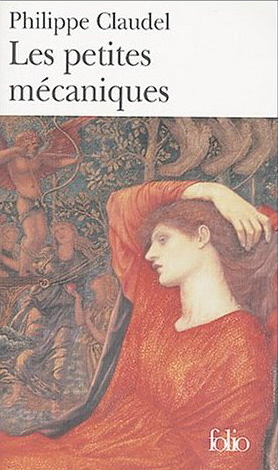Emmanuel Carrère – C'est demain, le 31 janvier, que le juge devrait décider si Jean-Claude Romand pourra bénéficier d'une liberté conditionnelle, après plus de vingt ans de prison. On se souvient de ce personnage faux et fascinant qui a réussi, pendant dix-huit ans, à se faire passer pour un médecin-chercheur employé à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève, après avoir raté ses examens de deuxième année de médecine – une histoire de mensonge qui s'est terminée par des meurtres sordides et traumatisants. Après un tel parcours, aurait-il mieux valu que Jean-Claude Romand se donne la mort à coup sûr? Emmanuel Carrère est un témoin privilégié de ce qu'a vécu Jean-Claude Romand: pour son roman "L'Adversaire", il a été en contact avec Jean-Claude Romand, par lettres interposées comme au parloir, voire au tribunal.
On dit que les romanciers sont un peu menteurs, qu'ils arrangent la vérité de façon à ce qu'elle soit vraisemblable. Que penser, alors, du personnage que l'écrivain met en scène dans son livre? "L'Adversaire" est l'exploration d'une évolution du rapport à la vérité d'un être humain né dans une famille qui avait ses valeurs en la matière, et qui a bâti ensuite sa vie sur un mensonge, entre autres pour être quelqu'un et être à la hauteur. Emmanuel Carrère, lui, cherche sobrement à coller à la vérité de son personnage, à ne pas le trahir. En particulier, il ne le juge pas, si difficile que ce soit. En revanche, il observe l'entourage qui, lui, ne manque pas de juger. Il en résulte un roman au réalisme glaçant, qui jette une lumière impitoyable sur tout ce qu'a fait le bonhomme, à la fois assassin (de sa famille et de ses parents, sans compter leur chien), escroc, adultère, menteur.
Menteur? Voilà qui pèse lourd dans l'addition. L'auteur met en évidence le fait que plus personne ne va le croire, jamais: pour le dire familièrement, dix-huit ans de mensonge, ça vous change un homme, surtout dans le regard de ceux qui ont été déçus. On ne croira guère, même, à ses demandes de pardon ou à son récit de rédemption par le Christ, à l'exception peut-être d'une visiteuse de prison qui ne connaît manifestement pas toute l'histoire. "Trop facile", semble dire le procureur lors de son procès, n'hésitant pas à prendre l'écrivain lui-même à partie: il est perçu comme le complice du délire mythomane du prévenu, un délire qui recourt aussi aux faux-semblants dérisoires, au moment où plus personne n'est dupe.
L'auteur montre aussi la misère d'un pauvre type qui, n'étant pas réellement employé par l'OMS, passe ses journées à glander sur des parkings d'autoroute, à errer ou à lire des revues à la bibliothèque de l'organisation onusienne. On le découvre aussi escroc, suggérant que sa fonction fictive de chercheur ayant l'oreille de Bernard Kouchner lui permet de faire des placements extrêmement avantageux en Suisse. Du coup, c'est l'entourage que l'auteur observe aussi, un entourage constitué de la famille et des amis et qui paraît ne pas se poser trop de questions quant au personnage – un personnage qui fonctionne de façon cohérente, mais avec sa logique à lui. Il sait susciter la confiance et sauver les apparences dans le pays de Gex où il vit, peuplé de fonctionnaires internationaux confortablement rétribués; et autour de Jean-Claude Romand, on ferme les yeux, de façon parfois à peine croyable.
"Ils auraient dû voir Dieu et à sa place ils avaient vu, prenant les traits de leur fils bien-aimé, celui que la Bible appelle le satan, c'est-à-dire l'Adversaire", explique l'auteur en page 28 de l'édition Folio de son roman: c'est ainsi qu'il faut comprendre le titre de ce roman vrai, qui va jusqu'à citer des extraits de correspondance et des poèmes d'amour de Jean-Claude Romand. Il y sera aussi question de Dieu, dans ce qui peut apparaître comme un grand écart: "J'ai pensé qu'écrire cette histoire ne pouvait être qu'un crime ou une prière", conclut l'écrivain. Crime ou prière? On a envie de répondre à l'écrivain, plutôt, qu'il a trouvé une troisième voie: celle d'une possible vérité sur cette terrible affaire où tout n'est que mensonge.
Emmanuel Carrère, L'Adversaire, Paris, POL Editeur, 2000/Folio, 2001/2005.
Lu par Accalia, Alain Bagnoud, Bibliolingus, BlueGrey, Calypso, Caroline Doudet, Catherine, Charmant petit monstre, Charybde2, Cid Vicious, Cynthia Van Lauwe, Géraldine, Ingannmic, Jean-Paul Degache, La Grande Stef, Les Chamoureux des livres, Livres à profusion, Marlène, Mathilde Ciulla, Mathilde Vandamme, Megan Deslongchamps, Songes littéraires, Sur mes brizées, Yuko, Zen Lilou.