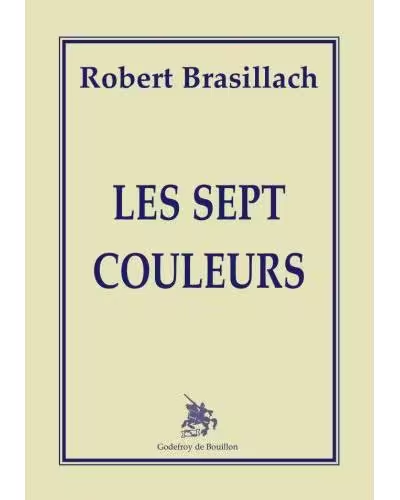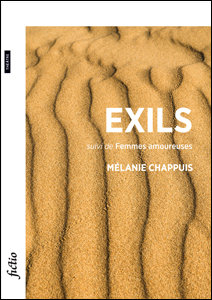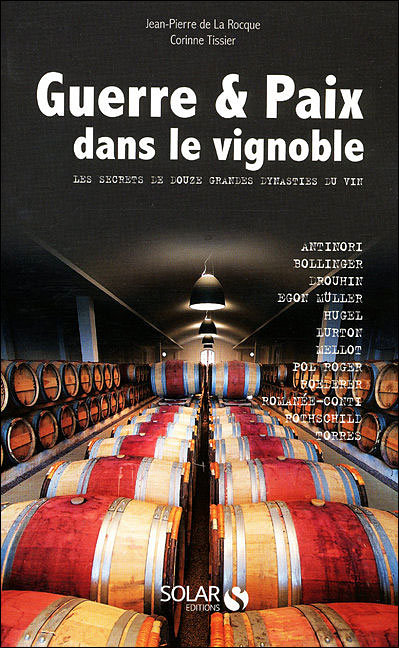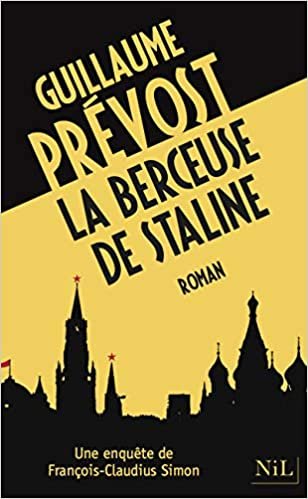Robert Brasillach – Le lecteur d'aujourd'hui ne sort pas sans un malaise certain du roman "Les Sept Couleurs" de Robert Brasillach. Malaise né de la reconnaissance nécessaire d'un talent indéniable (ce roman a du reste frôlé le Goncourt en 1939), irrémédiablement maculée par un substrat idéologique, celui du fascisme, dont on n'a pas fini aujourd'hui de dire et de sonder l'horreur.
"Les Sept Couleurs", ce sont donc sept des couleurs que peut adopter le roman, soit les formes de la narration. L'auteur les assigne à chacune des sept parties de son livre, écrite dans tel ou tel style: récit, lettres, journal, réflexions, dialogue, documents, discours. Force est de constater que de chaque forme, l'auteur s'attache avec talent à tirer le meilleur. Il en résulte une forme qui peut paraître globalement lâche, mais qui présente un intérêt expérimental certain et une cohésion quand même suffisante.
L'histoire? C'est celle de Catherine, courtisée par deux hommes, Patrice et François. Ces deux-là ne se rencontreront jamais, et représenteront deux caractères opposés: autant Patrice apparaît labile à force d'être mobile, intello et instable professionnellement, bohème pour tout dire, autant François, collègue de Catherine dans une grande entreprise aéronautique, représente la stabilité et la sécurité qu'elle recherche. Les deux jeunes gens se rejoignent cependant sur un point: leur fascination exaltée pour les fascismes, chacun de leur côté: Patrice connaîtra les versions italienne et allemande, et François ira combattre aux côtés de Franco en Espagne
Quant à Catherine, peu instruite, peu affirmée et consciente de ses lacunes, elle fait figure d'élément modérateur, les pieds sur terre, prudente et raisonnable, loin des débats politiques qui traversent l'entre-deux-guerres.
Il est permis de saluer encore l'univers pittoresque, balzacien à plus d'un égard, de la pension où Patrice a ses habitudes. S'y croisent des personnes hauts en couleur, tels cette domestique naine nommée Théodore ou ce personnage féru de spiritisme. On relève aussi les personnages des enfants Patrice et Catherine, qui portent par coïncidence les mêmes prénoms que les jeunes gens dont "Les Sept Couleurs" retracent la destinée: ne sont-ils pas le symbole de la jeunesse perdue? Les âges de la vie, et spécialement la trentaine, sont justement le thème de la partie "Réflexions".
... une partie où cette trentaine est vécue au temps des fascismes, que l'auteur paraît comparer au fil des pages. Et c'est là que s'impose le malaise.
Baladant ses personnages masculins sur les lieux où le fascisme, puis le nazisme et le franquisme, sont installés, l'auteur les décrit admiratifs face à ces régimes: camps de travail pour aryens où l'on semble vivre bien, jeunes gens porteurs d'un virilisme vu comme sain, substrat païen du mysticisme nazi. Cela, sans compter une description admirative des grand-messes nazies de Nuremberg. Sachant le bilan désastreux du nazisme, on ne peut s'empêcher que l'auteur n'a pas su, ou pas voulu, aller au-delà de la surface des choses: de la Florence de Mussolini ou du Nuremberg de Hitler, il ne montre que la façade. Cela, sans oublier la guerre d'Espagne, vue uniquement du côté franquiste, exalté (toute la partie "Documents").
Certes, Patrice fait mine de ne pas être dupe, par exemple en décrivant le Führer sous les traits d'un "triste fonctionnaire végétarien" (p. 138). Mais le lecteur ne peut s'empêcher de penser que l'écrivain n'a pas su prendre toute la distance critique suffisante face aux régimes montants de l'époque. En particulier, l'auteur ne met en scène aucun personnage frontalement opposé au fascisme, qui aurait équilibré le propos en installant une dialectique. Quant à l'antisémitisme de ces régimes et de leur contexte, il est à peine évoqué et paraît normal sous la plume de l'écrivain. En définitive, le lecteur ne peut s'empêcher de penser que mal caché derrière ses personnages, c'est l'homme Robert Brasillach qui vend ses idées. Cela, d'autant plus quand on connaît son engagement ultérieur dans la collaboration.
"Le talent est un titre de responsabilité", a déclaré Charles de Gaulle au moment de refuser sa grâce à Robert Brasillach, condamné à mort. Vrai: le malaise de la lecture des "Sept Couleurs" naît sans doute du constat d'un talent voué à l'admiration de ce qui s'est avéré un énorme gâchis. Un gâchis que l'auteur, journaliste qui plus est, aurait dû s'efforcer de voir venir s'il avait été visionnaire. "Les Sept Couleurs" était éventuellement recevable en 1939, mais ne peut plus guère être lu aujourd'hui sans un malaise certain, pour ne pas parler d'un vif dégoût.
 Robert Brasillach, Les Sept Couleurs, Paris, Godefroy de Bouillon, 2009/première parution en 1939. Préface d'Anne Brassié.
Robert Brasillach, Les Sept Couleurs, Paris, Godefroy de Bouillon, 2009/première parution en 1939. Préface d'Anne Brassié.